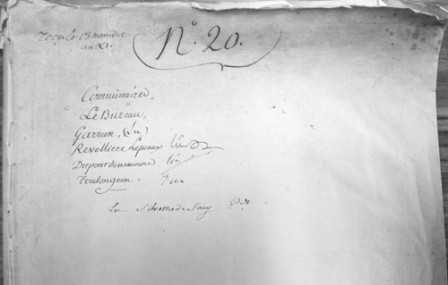
[21] Les animaux sont donc d’après toutes ces épreuves, sensibles au moral comme ils le sont au physique. L’erreur qui leur donnerait plus de feu, plus d’intelligence qu’ils n’en auraient en effet, est bien moins dangereuse, si elle ne l’est pas du tout, que celle qui leur ressortirait ces facultés. L’une ne peut que nous guider par les sentiments d’humanité, tandis que l’autre porte directement à la barbarie et tend à altérer la morale publique comme nous le verrons. D’ailleurs orner ces créatures de qualités aimables et précieuses ferait intéresser davantage les hommes à être justes et humains à leur égard.
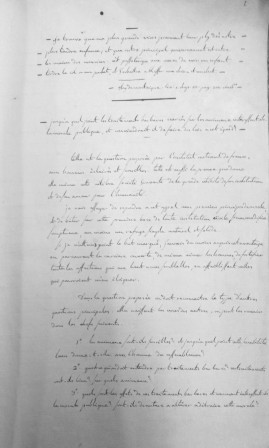
Qu’est-ce qu’on doit entendre par traitements barbares ?
D’après tout ce qui vient d’être dit sur la sensibilité des animaux, nous devons regarder comme traitements barbares exercés sur eux tous actes injustes et tyranniques des hommes, tendant à leur faire éprouver la douleur physique, le chagrin ou la douleur morale, enfin la mort, sans besoin urgent pour leur différence, ou même pour l’utilité qu’ils en retirent.
Devant les regarder comme nos semblables sous bien des rapports, sous celui de souffrir comme eux, de vivre comme eux en partageant les vicissitudes et éprouvant la mort ; nos compagnons, utiles sous bien d’autres rapports : cette grande maxime de morale écrite par la divinité dans tous les cœurs qui ne sont pas corrompus – ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’il te fut fait – devient vis-à-vis d’eux d’une application nécessaire autant qu’elle est juste.
Il s’agit de savoir maintenant si ces traitements ont lieu, sur quels animaux ils sont exercés et quelles gradations et variétés ont ces traitements. Nous avons dit plus haut que donner la mort à un animal sans nécessité urgente, était abstractivement parlant, un acte barbare, mais qu’en considérant le tableau de presque toutes les nations et surtout la dépendance réciproque et l’enchaînement de tous les êtres vivants, certains animaux étaient formés spécialement pour en détruire certains autres, que l’homme se plaçait volontairement avec les premiers.
[22] Ainsi, quoique l’homme puisse se passer de manger des animaux, il ne doit pas répugner au moraliste de rester au moins dans le doute, sur la légitimité de ce sacrifice et sous ce point de vue, tuer simplement et sans torture un animal pour s’en nourrir, ne serait pas un acte de barbarie ; mais bien tous les genres de tourments, d’injustices, de cruautés, de manque de foi, de privations exercés envers les animaux lorsqu’ils vivent sous notre domination. Parcourons rapidement une partie de ce tableau, les deux (illisible) que présentent ces traitements barbares.
Les sacrifices d’animaux qui ont suivi chez les peuples barbares, ou précédé les sacrifices humains sont les premiers actes féroces, réflexifs et volontaires. L’ignorance la plus stupide comme la plus orgueilleuse ne saurait les excuser. Ils sont dus à une superstition aussi absurde que cruelle. Cette épouvantable folie domine avec tant de violence sur les esprits dont elle s’est emparée, qu’elle a rendu cruel le peuple le plus doux de la terre après les Indiens, les Grecs.
C’est donc à ce monstre empruntant les délires de la religion que sont dues, sans nécessité, les premières barbaries exercées sur les animaux. Le prétendu intérêt des cieux a plongé le couteau d’abord dans le cœur des animaux innocents et puis dans celui de l’homme même. Le sang versé pour se rendre ses dieux propices est un crime qui a enfoncé tous ceux de ce genre.
Dans la Grèce antique ces sacrifices n’existaient pas, elle n’offrait aux dieux que des fruits de la terre. Ils ne s’y introduisirent que tard et difficilement, l’homme avait horreur de porter le fer dans le sein d’un animal destiné au labourage et devenu le compagnon de ses travaux. Une loi expresse le lui défendait sous peine de mort.[1]
Une fois que cette barrière fut renversée par toutes les causes qui avec le temps rongent et détruisent les meilleures institutions, les lois les plus sages, l’homme accoutumé à ces sacrifices eut peu d’efforts à faire pour traiter durement pendant leurs vies, les êtres auxquels il avait le courage de donner la mort.
[23] A ces sacrifices en faveur des dieux se sont joints les combats d’animaux contre animaux, d’hommes contre animaux. D’abord pour donner au peuple le génie belliqueux, et par ces spectacles, l’habitude du courage ; celle de voir de sang-froid verser le sang, pour avoir moins d’horreur et de répugnance de répandre le sien en combattant ses ennemis ; puis cette habitude devenue plaisir et spectacle nécessaires.
Les combats d’homme à homme pour atteindre le même but furent institués principalement chez les Romains, car le combat des animaux cessant par habitude de faire le même plaisir, ceux des gladiateurs plus inhumains, plus cruels, conséquemment plus de goût de ce peuple qui devait combattre et subjuguer la terre, leur furent joints.
C’est ainsi que marchant de l’habitude à la barbarie, la sensibilité s’éteint dans le cœur des hommes, ils arrivent par l’éducation à l’immoralité. Voyons si notre conduite moderne et actuelle vis-à-vis des animaux s’est améliorée ? Non, elle est pire, nous sommes barbares envers eux dans nos plaisirs, dans les services qu’ils nous rendent, dans l’emploi que nous en faisons pour notre nourriture, dans celui de notre instruction scientifique ; et en moral et en physique.
Dans nos plaisirs.
Je vois encore des animaux dressés à combattre d’autres animaux sans l’intérêt actuel de leur nourriture ou de leur déférence, je vois comme dans l’ancienne Grèce [2] des coqs combattant des coqs pour le plaisir et les jeux ruineux des Athéniens. Je les vois mourir les uns par les autres, sans motifs pour eux, être excités à la colère, à la fureur, à la rage de détruire son semblable, être armés de fers par nos mains, nos sens n’être point émus de compassion pour des animaux dont on trompe la destinée et la bonne foi, n’être point satisfaits par ce spectacle barbare et vouloir, si je peux m’exprimer ainsi, par un motif faux et menteur, moraliser aussi les animaux, pour nous soulager de la honte de notre propre immoralité.
Si ces barbaries ne s’exercent pas en général envers tous les animaux, c’est que notre supériorité de ruse, d’adresse et même de force sur les leurs, ne va pas au point de nous les faire tous atteindre et dominer : ceux que la nature semble (illisible) [24] plus particulièrement à nos besoins, à notre société, à nos plaisirs, sont de ceux que nous maltraitons de préférence.
Pour me servir des expressions de J.J. Rousseau[5], nous coupons notre chien, notre chat, notre cheval. Nous façonnons les animaux au gré de nos caprices et de nos plaisirs.
La Chasse, de quelque façon qu’elle soit pratiquée, est une barbarie, toutes les fois que la terre ne refuse pas à l’homme sa nourriture par la façon d’une industrie acquise déjà et mise en œuvre. Atteindre, prendre vivants, tuer ou attraper d’innocents animaux par le fer et le feu, les tromper par des amours perfides, leur faire souffrir la captivité ou la mort par des blessures, par des douleurs atroces, c’est exercer sur les animaux un traitement barbare.
La chasse aux yeux de la morale n’est légitime que pour la détention des animaux destructeurs eux-mêmes de nos guérets, de nos grains, de nos tombeaux, de notre individu. C’est alors le véritable droit de la guerre, alors, mais à regret, on doit les détruire, les chasser avec la mesure de la justice, et se dire que ces animaux obéissant à leur instinct sont excusables de vouloir se nourrir, là, où leur subsistance paraît être assurée. Le sexe le plus doux partage notre insensibilité, qui n’a entendu dire à des dames : « Nous nous promenâmes dans la foret et sans nous être fatiguées à suivre la chasse, nous eûmes le plaisir de nous trouver à la mort du cerf », c’est-à-dire (suivant St. Foix)[3] qu’elles avaient eu le plaisir de voir un animal tombé de lassitude, que l’on tuait et dans les regards et les larmes devraient nous faire sentir notre férocité[4], cet exercice est dit-on pour les rois, une image, comme une école de la guerre. Un tel paradoxe, et d’une telle immoralité, avait besoin pour être soutenable d’être au moins justifié par le succès, mais l’Histoire, mais l’Europe actuelle démontrent ce faux principe et en détruisent la fausse application. On voit des chefs de nations être toujours à la chasse et toujours vaincus, tandis que la renommée en proclame, qui, humains, pacificateurs, législateurs, sont toujours victorieux et ne chassent jamais.
[25] Pêcher surtout avec des instruments piquants, meurtriers, lorsque des grains, des légumes, des fruits, peuvent nous suffire ; lorsque d’autres animaux par leurs jeux, leurs courses peuvent contribuer à nos plaisirs ; faire éprouver à ces animaux une douleur vive avant de leur donner la mort, est un traitement barbare.
Les chiens, en qualité de nos amis, de nos compagnons fidèles, et ceux qui nous approchent de plus près, sont aussi ceux dont nous abusons le plus pour nos plaisirs. Ici, je les vois privés d’une nourriture suffisante pour la leur donner en récompense de leur docilité, de leur adresse, de leur gentillesse, les rendre bons gardiens par des chaînes, obéissants à coup de foret, agiles, fins chasseurs par inanition ou mauvaise nourriture ; partout leur faire échanger leurs passions naturelles contre d’étrangères et d’outrées.
Non contents de les maltraiter ainsi, nous leur coupons la queue et les oreilles, nous les privons quelques fois du caractère affectif de leur sexe. Nous exigeons d’eux pour le plaisir de la chasse, des courses exténuantes, après lesquelles, renfermés comme des criminels, ils attendent pour le lendemain et pour récompense, mêmes traitements, mêmes outrages, mêmes dangers, souvent des blessures et la mort. Enfin, même barbarie de la part de ses maîtres qu’ils caressent encore. La joie de cet animal en sortant de sa prison atteste autant le plaisir qu’il ressent d’une liberté illusoire et de courte durée, que la manifestation de son naturel chasseur.
Dans les campagnes isolées, chez le paysan solitaire, ces traitements barbares sont moins en évidence parce qu’ils sont moins nécessaires. L’intérêt du maître, sa moralité mieux affermie qu’ailleurs parce qu’elle a moins de relations, conséquemment moins d’assauts à soutenir, s’accordent avec le bon naturel du chien. Mieux traité, plus réellement aimé, il est aussi moins vicieux et plus exact à remplir les devoirs que sa sociabilité avec l’homme lui impose.
Dans les villes d’une grande étendue, dans ces foyers immenses de corruption, dans les capitales comme Paris, qu’est-ce que l’œil observateur du philosophe aperçoit à tout instant ? Une multiplication effrayante de chiens qu’on a la barbarie de ne pas prévenir en les détruisant encore jeunes.
[26] Chacun en présente de centaines, isolés, affamés et dangereux, agacés sans cesse par des enfants ou des oisifs, excités à la fureur et au combat sans motif que celui des hommes grossiers et durs qui ne trouvent du plaisir que dans ces scènes de fureur. Chaque maison est salie par leurs ordres, dans chaque étage, dans chaque chambre, depuis le portier jusqu’au malheureux qui habite le sixième étage, on est assourdi par leurs tristes aboiements et révoltés par leurs insolents jappements.
Cette effrayante population de chiens, favorisée par des maîtres barbares ou insouciants, cette fureur de faire naître des animaux, là où leur subsistance n’est point assurée, pour les rendre malheureux, les voir morts de faim, périr par milliers dans les chaleurs, dans les hivers rigoureux, ou bien devenir enragés ; ne sont-ce pas des actions barbares autant que périlleuses exercées envers les animaux, puisqu’en multipliant ainsi les causes, on doit multiplier les effets ?
Ce n’est pas tout encore : l’homme défigure tout, transporte, change les espèces, dégrade leur nature ; il pervertit leur instinct, leur nature ; il les rend vicieux par ses vices et trompe leur destinée. Il attèle des chiens à des chars disproportionnés autant pour son plaisir que pour son utilité ; il leur fait traîner ces charriots chargés d’enfants, de denrées de légumes ; il hâte leurs marches, déroutées de leur inclination, à coups de fouet ; il les bride comme des chevaux. On voit souffrir d’un œil sec ces pauvres bêtes abusées ainsi dans leurs mœurs, détournées de leur véritable instinct.
On les voit remplir dans ces tourments, des fonctions monstrueuses et étrangères. On les voit succomber en haletant et sans se plaindre sous les (illisible) qui les écrasent et les liens nouveaux qui les garrottent. C’est un traitement barbare aussi neuf en France, qu’il est bizarre et révoltant.
Mais, dira-t-on, peut-être, il y a des pays comme dans le Kamtchatka et d’autres dans lesquels des chiens font le service de trait des chevaux, pourquoi ne le feraient-ils pas ailleurs ? Un abus et une barbarie ne doivent jamais excuser et légitimer d’autres. Là où il n’y a ni chevaux, ni rennes, ni bœufs, ni ânes, ni mulets, il est peut-être permis, au moins excusable, d’user dans ces fers de ces animaux pour voyager, si une éducation analogue, jointe à une force physique suffisante se réunissent pour ce service. Mais là où il y a tout ce qui est nécessaire pour trainer, porter et voiturer, sans obligation de recourir à ces animaux, c’est une barbarie de s’en servir à de telles fonctions.
[27] Les oiseaux qui servent vivants à nos plaisirs criminels, servent par leur mort à notre nourriture, ne sont pas mieux traités par notre industrie inhumaine. Ils se multiplient à l’excès et cette fécondité, cette abondance hors de la mesure donnée par la nature et par un besoin relatif multiplient leurs maux, comme leurs destructions. Les enfants, prompts à suivre et à outrer les exemples, leurs font souffrir mille tourments. Ils dévastent les nids, séparent ainsi cruellement les petits de leurs parents, ne sont point attendris par leurs cris plaintifs ou par leurs becs impuissants, ils tendent des pièges douloureux, les mettent en captivité, les étouffent par caresses et par des soins sans intelligence, leur arrachent les plumes, leur coupent les ailes, souvent le bec et les ongles, les enchaînent dans toute la force du mot, et par une éducation douloureuse, leur font acquérir une habileté d’esclave qui ne peut amuser que leur tyrannie et ne vaut pas celle que la nature dans les bois, les champs, les bosquets, leur a départie en pleine liberté.
Point d’arguments admissibles pour prouver qu’on les rend quelques fois heureux. On crée les cages, les portes, les fenêtres ; Brisez les entraves, les chaines, les liens et ces animaux nés domestiques répondront pour la plupart avec raison, à vos bons traitements par une fuite précipitée. On voit des enfants attacher des fils, des ficelles à la cuisse, à la jambe de ces animaux pour les faire voler sans les perdre, mais trompés dans leurs espérances les jambes, les cuisses se rompent ; et les cris douloureux de ces innocents animaux attestent l’ignorance barbare de ces enfants.
Dans cet âge où l’homme commence et se développe, ces émeutes sont familières et continuelles. Si les enfants ne dénichent pas les oiseaux, ils leurs dérobent leurs œufs. Non pour en faire un repas, ce qui pourrait être excusable, mais pour en faire une destruction par un jeu de hasard qui les amuse.
Vis-à-vis des insectes, des papillons, des scarabées et autres, leur barbarie a les mêmes éléments, ils ne les détruisent pas d’un seul coup pour en débarrasser l’air, les arbres ou les habitations, ils cherchent [28] que du plaisir, et ce plaisir est une cruauté. Aux uns, ils arrachent une aile ou deux, puis les abandonnent souffrants et languissants. Aux autres, ils écrasent la tête entre deux papiers pour admirer les effets bizarres du jet de leur sang sur le papier qui en est ainsi coloré. D’un côté, ils lient les cuisses à des hannetons pour en jouir comme des oiseaux volants et avec le même succès, c’est-à-dire en leur rompant les jambes ; de l’autre, ils les creusent, leur cachent le dernière sur des cartes ou autres bases mobiles ou immobiles, et jouissent jusqu’à leur mort et font jouir leurs parents silencieux des mouvements grotesques que ce supplice de plusieurs jours leurs font faire.
Par ce supplice lent, ils nourrissent sans cesse leur barbarie envers les autres animaux. Cette barbarie n’a été ni prévue, ni prévenue, ni réprimée par leurs parents mêmes. Eux-mêmes ont eu les mêmes amusements, c’est ainsi que d’âge en âge, de père en fils, l’habitude s’établit, se fortifie, nous domine par l’exemple et que les traitements barbares envers les animaux se lèguent par les faits, comme un héritage de crimes.
Ne voit-on pas encore dans presque tous les villages, célébrer tel ou tel événement, telle ou telle fête de patron par des barbaries qu’on a peine à concevoir de sang-froid. On suspend à une corde, on cloue à un poteau une pie vivante, ou une anguille, ou autres, puis un certain nombre de jeunes paysans défilent devant ces animaux cherchant à viser ensemble la tête, à leur ôter la vie, à coup de flèches, de pierres, de bâton, ou de sabre. Celui qui l’a obtenu enfin, après une longue et horrible souffrance, après un supplice hideux et barbare, a remporté le prix. Il est récompensé par ses camarades, les pères, les mères, les enfants applaudissent et demain ces enfants répéteront au petit ce qu’ils ont vu faire au grand. On appelle cette fête de bêtes féroces, couvrir l’oie, couvrir l’anguille, etc… et ne semble-t-il pas que ces animaux nés nos serviteurs comme nos malheureux esclaves sont devenus nos ennemis et que semblables aux sauvages (illisible) nous les traitons comme ils traitent leurs ennemis ?
Je ne finirais pas si je présentais une à une et sur chaque animal la liste de toutes les barbaries exercées sur les animaux, dans nos plaines. [29] Passons aux mauvais traitements exercés sur eux dans l’emploi que nous en faisons comme serviteurs de l’homme.
Emploi des animaux pour notre utilité comme serviteurs
Le cheval est de tous les animaux utiles à l’homme, celui qui en est le plus maltraité. Le plus ordinairement, on commence par lui rendre son sexe masculin inutile. Le plus souvent et comme au chien nous lui coupons les oreilles et la queue. C’est ainsi que nous traitons nos amis.
La belle stature du cheval, son égalité, sa souplesse, le tableau des dangers qu’il court ou qu’il a couru, de la victoire qu’il partage avec son maître, sa grande utilité, son attachement à l’homme, ses grâces, sa bonté, ne le garantissent point de son injustice. […]
[30] Comment est-il possible que le peuple réputé doux, plein d’humanité et de générosité, que le Français né très sensible, puisse contempler froidement dans les grandes villes surtout des chevaux maigres, affaiblis, malades, voiturer des charges de bois, de plâtras, de pierres et physiquement au-dessus de leurs forces, voir raviver ces forces par l’irritation douloureuse et pour ainsi dire convulsive, occasionnée par des coups de fouet ?
Comment cette nation qui devrait donner l’exemple d’humanité à nos voisins, le (illisible) inutilement d’eux à cet égard ? C’est que sa légèreté, sa mobilité naturelle, l’empêchent d’insister et réfléchir longtemps sur un objet qu’elle a senti autant et mieux qu’une autre. C’est que l’habitude est un Tyran domestique chez tous les hommes, qui masque, affaiblit ou déroute notre sensibilité. C’est que des subalternes sans intérêt individuel, féroces par mauvaise éducation, sont chargés du soin et de la conduite de ces animaux dans lesquels ils ne voient qu’instruments actuels et amovibles de leurs intérêts relatifs, de leurs salaires. C’est que l’avarice, qui ne calcule que profit, a d’avance calculé celui qu’il a obtenu comme marchant avec cet animal malheureux et ne voit dans lui par quelques jours de vie de plus qu’il lui laisserait par ses soins, quelques accroissements [31] légers à des intérêts dont il a déjà vingt fois profité, et qui ont couvert avec usure le prix honteux qu’il a mis à son acquisition par quels traitements barbares ?
C’est sans doute les idées relatives à ces traitements qui ont donné lieu à l’anecdote suivante, dans le commencement du règne de Louis Seize. Si je ne me trompe, il fut donné ordre à un des agents commerciaux d’une des échelles du Levant d’acquérir à tout prix une jument arabe, renommée par son feu, sa bonté et ses autres qualités. On murmura qu’elle devait être livrée pour une très grosse somme. Le marchant arabe touché du sort futur de sa jument, son seul bien et sa compagne chérie, autant qu’ému par l’idée d’une séparation douloureuse, ne voulut plus tenir le marché arrêté, mais non encore terminé, et en présence de l’agent français, il s’adresse à la jument et lui dit : « Viens, ma belle, je n’ai rien au monde, j’aime l’or et en ai grand besoin. On m’en offre beaucoup pour te céder, pour te vendre, mais je ne veux plus te quitter. Reviens avec moi partager dans ma cabane, mon orge, mes fruits, mon eau. Ne va pas chez une nation où l’on t’attachera, te renfermera, te battra, où l’on n’aura pas ma tendresse et mes soins pour toi. Chez des hommes qui te revendront lorsque tu ne pourras plus être utile ». C’est ainsi qu’un Arabe nous donne des leçons d’humanité !
L’âne, l’ânesse, le bœuf, la vache, la chèvre, la brebis, le chameau, etc… sont plus ou moins maltraités, selon le rang de leur utilité, de leur emploi, mais participent tous à nos barbares traitements. […]
[32] Leur emploi pour notre nourriture
Indépendamment de la pêche, de la chasse et de l’égorgement journalier d’animaux pour suffire à notre voracité, il est dans l’emploi que nous en faisons des actions raffinées dans ce genre dont je vais, en frémissant, donner en bref quelques détails, nécessaires pour ceux qui les ignorent.
Pour avoir une poularde et un chapon on crève les yeux à une jeune poule et à un poulet. On les nourrit de force et hors de son leur appétit et de leurs besoins réels. Cet excès de nourriture, joint au repos forcé qu’ils gardent par leur aveuglement, les engraissent tôt jusqu’au point nécessaire à la délicatesse consacrée et recherchée par la gourmandise. Alors on leur donne la mort ; on ôte de plus au poulet les parties de la génération, ce qui le rend plus parfait dans son emploi comestible.
Ailleurs, on cloue les pieds, les jambes des oies sur une planche, on les ploie très près du feu, on les fait manger surabondamment en les engorgeant de force cet excès de nourriture, ce repas forcé et douloureux, sans doute aussi le chagrin, dont l’effet principal porte sur le foye, font gonfler énormément et grossir ce viscère ainsi désorganisé aux dépens des autres. On hâte quelques fois par des coups de verges données sur ces victimes le gonflement et l’accroissement des denrées. Lorsque l’animal extenué est prêt à succomber à ses souffrances, on l’égorge, on l’éventre pour avoir son foye ainsi disproportionné, ainsi empoisonné de feus acquis par la douleur et la fureur du chagrin. On l’appelle foye gras, on en fait des pâtés ou autres mets recherchés.
Dans quelques cantons du Royaume de Naples, dans la ville de Naples surtout, lorsqu’une truie a mis bas, on lui lie fortement les tétines de manière qu’elles reçoivent et retiennent plus de lait et de sucs nourriciers qu’elles n’en peuvent et doivent transmettre ou employer pour elles-mêmes, on gouffre et un accroissement prodigieux dans ces organes en sont les suites. Au bout de quelques jours ces tétines ont acquises par les souffrances de l’animal et dépens de ses autres parties le degré de perfection requise. Alors cette bête est égorgée. On lui enlève encore toutes chaudes quelquefois ces tétines objet d’un commerce immoral, pour satisfaire une gourmandise aussi cruelle que malsaine.
[33] La plupart des cuisiniers placent de gros poissons, des brochets vivants, des écrevisses aussi vivantes dans des vases pleins d’une sauce âcre et préparée et sans avoir au préalable fait mourir ces animaux, ils les font séjourner dans ce bain de douleurs jusqu’au moment, très éloigné souvent, où ils les font chauffer vivants encore, bouillir et cuire. C’est pour les attendrir.
J’ai vu et j’en frémis encore, j’ai vu étant tout jeune, un homme d’une éducation distinguée, d’une physionomie douce et d’un rang élevé, descendre dans la cuisine d’une auberge et dire « Vous autres, comme ne savez pas faire des fricassées de poulets tendres et délicates, donnez-moi deux jeunes poulets vivants, je vais vous apprendre votre métier ». Il prend aussitôt un de ces animaux et en présence d’hommes et de filles étonnés, le découpe froidement en quartiles tout vivant, et dit « plumez-le à présent et nous aurons un bon manger ». Ce jeune homme était chasseur, il était militaire. Prêt à me trouver mal, je n’eus ni la force ni la curiosité de voir la fin de cette nouvelle barbarie. Les cuisiniers sans doute auront profité de la leçon et mis en pratique une méthode si simple, si commode pour eux d’attendrir un poulet… en voilà bien assez sous ce point de vue.
Leur emploi pour notre instruction
On cherche encore, on se confirme des instructions anatomiques, physiologiques, dans le sein des animaux vivants. On fait des recueils, des amas de papillons, de scarabées, etc… pris vivants et martyrisés longtemps avant leur mort. Est-il permis, philosophiquement parlant à l’homme studieux, dont la sensibilité doit être la première qualité et chez lequel elle doit être au moins présumée, de chercher à argumenter ses connaissances, hâter le progrès de sciences qui y sont relatives, par le sacrifice gradué et lent, par des expériences impitoyables sur des animaux vivants et innocents ? Ne point se contenter d’une saine et longue expérience, véritable et seule source de ces progrès ? Je sais bien que des savants recommandables ont suivi cette route encore trop fréquentée. Je sais aussi que le droit du plus fort répond à cette question. Mais disséquer vivantes, éprouver par des tourments toute la sensibilité de créatures innocentes qui se livrent à vous avec confiance, ne doit point être une action sans effets sur les affections morales de ceux [34] qui se livrent à ce genre d’expériences. L’utilité scientifique balancera-t-elle la conduite morale ? Il reste à savoir si, pour le bonheur des hommes et de la bête, il est plus avantageux d’être savant à ce prix, que d’être humain sans être instruit par cette voie ; impitoyable qu’ignorant dans cette partie : et s’il vaut mieux acquérir en découvertes dont l’utilité est au moins illusoire ou disputée, qu’en moralité réelle et d’un secours journalier ?
Les hommes sensibles et véritablement bons ne balanceront point dans le choix des avantages proposés. Par une suite inévitables de ces traitements barbares sur les animaux, il doit en résulter des maux dont la filiation est immense et bien peu calculé l’état de désorganisation morale et physique dans lesquels sont les animaux avec nous, les rendent vicieux et malsains ce qui qui n’a pas été un bien moins bon de notre servitude. Il n’est point bon de vraisemblance aussi, qu’assez pour nourriture des animaux ainsi torturés, c’est exercer, sans le savoir, sur nous et nos semblables, les mêmes traitements.
Les animaux étant sensibles et mourant dans la fureur et la rage du désespoir ont leurs faux vices dénaturés, empoisonnés par leurs mouvements convulsifs et leurs passions malfaisantes excitées aux degrés d’intensité. Seront-ils ainsi sans inconvénients, sans suites funestes dans notre sang et notre honneur ? Comment espérer organiser sainement nos parties et nos fonctions par la désorganisation même des animaux ainsi suppliciés ? Ne doivent-ils pas dans cet état inoculer dans notre vitalité, dans notre vie sociale, le germe de maladies inconnues et peut-être connues, le germe des vices, de la fureur, de la vengeance, comme nous recevons le venin de la rage et autres ?
Les animaux ont des passions et l’influence de ces passions sur leur physique doit être comme chez nous une conséquence naturelle pendant leurs tournements et après leur mort les physiologistes ont consignés dans leurs écrits une suite de faits attestant les maux donnés à l’homme pour des blessures données dans le moment de la colère. M. Lescot cite quelques part l’histoire et l’observation d’un canard amoureux qui dérangé et contrarié dans ses amours fit une blessure à la jambe de son agresseur, la gangrène s’y mit et il mourut. C’est ainsi que ces effets, des tourments exercés sur les animaux, dans leurs organes et leurs passions, se transmettront dans un [35] suc lorsque nous en usons dans cet état comme aliments et qu’ils se vengent ainsi de notre barbarie.
A tous ces traitements barbares, je pourrais joindre la liste de bien d’autres et chaque observateur pourrait ajouter encore à cette liste, mais nous en avons assez présentés et peut être trop pour démontrer la barbarie des hommes exercée sur les animaux. Elle est avérée, elle est publique et privée, elle est dans nos coutumes, nos habitudes et nos mœurs. Il est temps d’examiner jusqu’à quel point elle intéresse la morale publique.
Jusqu’à quel point ces traitements barbares intéressent-ils la morale publique ?
Nous avons prouvé que les animaux étant sensibles au physique et au moral, avaient avec l’homme la plus grande analogie et la plus parfaite ressemblance sous bien de rapports. Devant nécessairement conclure de cette similitude que nos actions envers eux dévoient le même caractère et les mêmes motifs que nous devions qu’elles aient, envers nous de la part de nos semblables, nous avons vu que ces actions étaient barbares, par le tableau des traitements exercés sur eux par la plupart des hommes.
Pour achever de remplir la tâche imposée, il nous reste à voir les effets que chacune de ces actions principales doit produire dans la société. On établit la définition ou la notion exacte de la moralité ou des mœurs, d’un homme ou d’un peuple.
La moralité est le degré de l’amour de la justice et le degré d’habitude et de disposition d’un homme ou d’un peuple pour la pratique des vertus sociales.
La société se composant d’un nombre d’hommes ou d’individus, la moralité publique se compose des mœurs particuliers mais réunies, mais relatives de chacun des membres de cette société. La base des dernières forme celle de la première. Elles s’établissent et se consolident par leurs agrégations et par leurs rapports mutuels.
La morale publique n’est donc que la pratique générale des vertus sociales réciproquement et simultanément senties et exercées par le plus grand nombre des membres de la société.
[36] Ces vertus sont : 1. L’humanité ou l’amour et le respect pour l’homme ; 2. La bienveillance ou le désir de voir son semblable heureux ; 3. La charité ou le désir de soulager ses peines, ses besoins ; 4. La frugalité et l’industrie ; 5. L’honnêteté et l’exactitude dans les procédés ; 6. La véracité et la probité ; 7. La gratitude ; 8. Les sentiments généreux.
Ce n’est que par l’exercice et la pratique de ces vertus en toutes occasions, que l’homme peut en contracter l’heureuse habitude. Par conséquent, toute action ou sentiment, contraires à l’égard des animaux, doivent produire les mêmes effets à l’égard des hommes, en disposant l’homme à la même conduite à l’égard de son semblable, empêcher et détruire cette disposition et habitude vertueuse, rendra enfin barbare l’homme envers l’homme. Voilà le point en dernière analyse, jusqu’où les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent la morale publique.
Quoique tous enfants de la nature, hommes et bêtes, l’homme a une volonté plus libre, une puissance plus étendue, une liberté plus intellectuelle. Il peut donc plus facilement s’abstenir de tout acte vicieux. Ainsi, et sous ce point de vue, soit qu’on le voulût placer dans la classe des animaux proprement dits, soit qu’on doive le regarder comme une intelligence servie par défense[6] il est donc plus coupable de ce qu’il a plus de liberté et peut avoir plus de volonté de ne l’être pas, plus à plaindre aussi de ce que sa démoralisation coupe les racines de ces facultés.
Appliquons ces principes et faisons-les suivre des faits envers les animaux, ses actions envers les hommes.
Effets sur l’humanité ou amour et respect pour l’homme
Il est vraisemblable que l’homme n’aurait jamais mangé son semblable, s’il n’eut commencé par manger des animaux. Je ne dis point que ce dernier acte conduise au premier nécessairement, mais que l’un a précédé l’autre ou l’a préparé. Il y a eu des chasseurs, des pêcheurs avant qu’il y eut des anthropophages, le défaut de l’humanité vis-à-vis des animaux dispose et donne naissance à l’inhumanité vis-à-vis des hommes. Nous n’eussions vraisemblablement jamais dégradé notre semblable en santé, en lui ôtant les attributs de la virilité si nous n’eussions essuyé d’avance cette barbarie sur les animaux.
[37] Les habitants de l’Inde, cités plus haut, qui ne sacrifient aucun animal sont les hommes les plus doux, les plus humains, les plus hospitaliers et les plus pacifiques de la terre. Quelle plus sublime démonstration !
Mais, devant par une habitude générale et transmise par nos pères, manger des animaux, il est nécessaire pour l’intérêt de la morale publique de ne sacrifier à cet usage que ceux qui n’ont eu avec nous aucun rapport de services, de société, d’attachement et d’habitude. Il faut donc faire une distinction des animaux domestiques d’avec les autres, autrement nous sommes inhumains, après avoir été ingrats, et ces vices nés de l’habitude deviennent bientôt par elle applicables et s’exerceront à l’égard de nos semblables.
Laissons-nous mourir de vieillesse nos utiles animaux ? Leur continuons-nous jusqu’à la mort des soins payés d’avance ? Non ! sans doute, nous les sacrifions dans ces feux comme les autres et d’une manière plus cruelle, nous l’avons démontré. Celui qui a travaillé et fertilisé nos champs a le même sort que celui qui vient les gaspiller. Que dis-je ? Il a un sort mille fois pire puisqu’il passe de nos mains cruelles dans celles plus cruelles encore de ceux qui les achètent pour les revendre pour les tuer après une longue suite de travaux, tandis que les autres tués inopinément n’ont pas le temps de souffrir entre nos mains. […]
[40] Les enfants naissent bons, tous les hommes sages et observateurs l’ont observé et dit. Le cœur tendre des enfants se durcit par l’exemple, devient féroce par l’habitude. L’éducation consolide leur future immoralité. J’ai vu un enfant nouvellement retiré de la campagne, où il n’avait vu et éprouvé que soins et bons procédés envers lui et les animaux, apercevoir tout à coup, un cheval mort dont on enlevait la peau sanglante. Ce tableau lui fit une telle impression d’horreur qu’il perdit connaissance et prit une rage spasmodique accompagnée de convulsions, de cris et témoignages d’horreurs. Ces symptômes effrayants ne céderont qu’à la douceur du langage, à la musique et à l’effet d’un mensonge officieux et adroit, par le conseil d’un homme instruit. L’habitude chez cet enfant n’avait point encore altérée sa sensibilité naturelle, son humanité.
Oh ! Si nous fouillions dans la vie privée de celui qui est devenu dangereux à ses semblables, si nous remontions à sa première éducation, aux premiers exemples qui lui ont été donnés à l’égard des animaux, les crimes qui éprouvent notre raison et éclatent tout à coup dans la société, cesseraient de nous surprendre. Nous leurs verrions une gradation lente que la conduite barbare des hommes envers les animaux a fait naître, nous verrions cette conduite figurer éminemment parmi les causes de tous les malheureux et comme une des principales de son immoralité. Par cette voie nous découvrirons le monstre obscur avant d’apercevoir le scélérat public. […]
[43] Une mauvaise éducation envers les animaux fera dans la société des hommes durs, des êtres froids, insouciants, égoïstes, insensibles aux maux des autres, exigeant pour eux. Ils seront inutiles, s’ils ne sont dangereux.
[44] C’est alors que tous les hommes se regardant étrangers les uns aux autres, s’approchant sans plaisir, se quittant sans peine, fermant leur cœur par la défiance acquise à la douce amitié qu’ils méconnaissent, se mariant sans l’attrait du bonheur, s’éloignant de cette union dont ils ont appris à mal juger les douceurs, rompant froidement ce lien, faible dans leur morale, enfin ne voyant leurs semblables que dans un aspect vicieux parce qu’ils les voientt dans eux-mêmes, ne les jugeant que jaloux et envieux ; la société ne sera plus que comme elle l’est dans les grandes capitales, un mélange, un amas barbare d’êtres sans charité, une scène mouvante sans intérêt, un ferment de guerre intestine prête à s’allumer et qu’à peine de sages lois coercitives et faites exprès, pourront atteindre et réprimer. La morale publique sera sans cesse en danger, si elle n’est pas encore absolument détruite.
Leurs effets sur la frugalité de l’industrie
Lorsque, tout accoutumés à user des animaux comme des esclaves, comme des denrées, comme des meubles commodes ou inutiles, enfin comme des êtres qui seraient insensibles, notre cœur s’est enfin absolument ou presque fermé à la pitié pour eux et ensuite pour nos semblables, que nous coûtera-t-il pour tomber dans tous les excès de l’intempérance et dans ceux de la paresse et de l’oisiveté ? Comment regarderons-nous la frugalité ? Pour nous ce sera une chimère. Elle n’aura quelque ombre de réalité que lorsque, malades de nos excès, nous nous promettrons un instant d’écouter et suivre ses leçons.
Après avoir torturé par des supplices dont l’idée seule fait frémir, les animaux à notre usage, après les avoir éventrés, clonés, flagellés et découpés vivants, quelle barrière pourra nous arrêter, quelle morale pourra nous retenir dans les liens de cette vertu, et s’opposer à contenter nos désirs ? […]
[45] Masseurs, pêcheurs, bouchers, rôtisseurs, traiteurs, charcutiers, cuisiniers etc... deviendront un peuple nombreux et nouveau, dont la plupart des membres sont inconnus à nos campagnes frugales et industrieuses dans le vrai sens, en remplaçant les agriculteurs devenus de plus en plus rares, en dépeuplant d’animaux la terre et les eaux, ou dégarnissant nos champs d’hommes simples et encore vertueux ; voraces et surabondants, ils porteront une atteinte mortelle à la morale publique.
[46] La facilité de faire servir les animaux à ces fonctions que nous devrions remplir avec plus de facilité encore, et par un devoir naturel, l’emploi que nous en faisons à rapprocher les lieux et les distances les moins éloignés, doivent éteindre ou affaiblir cette activité, cette industrie simple et naturelle, entretenir l’oisiveté, vice contraire à la vraie industrie, influer sur la santé, conséquemment sur la morale et les passions. Forçant ainsi les animaux à plusieurs ouvrages futiles, à des travaux honteux, nous perpétuons le vice de la paresse, nous dépravons la morale publique après avoir maltraité les animaux pour l’alimenter.
Le pire de ces effets sera la jalousie excitée, l’envie et l’exemple donné à ceux qui ne peuvent se procurer les mêmes jouissances, ces passions, ces vices, reçus et transmis feront naître la convoitise et l’ambition. L’immoralité publique en sera donc la suite inévitable.
[…] Comparons la conduite sociale et civile d’un maquignon, d’un charretier avec celle d’un ami, un véritable amateur des chevaux ; celle d’un boucher, d’un piqueur, d’un braconnier, d’un cocher de fiacres, avec celle d’un Banian, d’un Indou, d’un sauvage même, d’un paisible berger de troupeaux de moutons, les uns accoutumés à mettre en usage le mensonge, accoutumés au sang, [47] aux outrages, aux apostrophes injurieuses et barbares, aux serments faits et faussés, aux paroles d’honneur, envers les animaux et les hommes, ont des mœurs analogues et avec peu d’exception. Ils agissent dans la société en conséquence de ces vices, de ces défauts. Ils influent en ce sens sur les mœurs de la société. Les autres, généralement doux, honnêtes, bons, exacts à leurs devoirs, pleins d’égards pour leurs semblables, parce qu’ils en ont pour les animaux, attestent la bonté de leur cœur, celle de leurs mœurs et leur influence heureuse sur la morale publique. […]
[50] Dans ce tableau de la dépravation des vertus sociales, je n’ai point voulu présenter la barbarie exercée sur les animaux et s’opposant à l’entier développement de ces vertus comme la cause unique qui tend à pervertir nos mœurs et la morale publique, mais j’ai dit qu’elle entre comme élément principal parmi tous les vices qui préparent et achèvent leur ruine.
Mais il y a dans la société des êtres parfaitement humains parce qu’ils le sont envers les animaux. L’humanité est chez eux une vertu qui divise ses bienfaits, de leurs semblables sur les animaux et des animaux sur leurs semblables. Cette vertu se soutient et s’établit par cette application alternative et réciproque : effets ou causes, causes ou effets. La morale publique gagne ou se préserve par ces transports mutuels et doit s’en glorifier. Mais l’erreur [51] est toujours accoté à la vérité, comme l’excès accoté à l’usage. Tel homme, telle femme, souvent isolés ou délaissés, pardonnables dans leur faiblesse entre les soins légitimes qu’ils doivent au compagnon de leur ennui et de leurs vies et que la probité réclame, se privent souvent du nécessaire pour nourrir un chien, des chiens, d’autres animaux. Excusables dans le sentiment, ils cessent de l’être dans son abus. L’humanité en eux devient une faiblesse qui ravissant quelques fois aussi, une nourriture suffisante et nécessaire à des enfants, altère et doit intéresser la morale publique. […]
[52] Les contrastes naissent les uns des autres, se prononcent par la force des résistances et la loi du choc des corps opposés ; plus les difficultés sont grandes plus la puissance qui les attaque et les surmonte devient courageuse et respectable, digne de notre admiration et de notre reconnaissance.
[…] Il nous reste à voir si la morale publique attaquée par les mauvais traitements exercés sur les animaux peut tirer des lois, quelque secours et si la législation s’emparant des fruits de la morale peut les utiliser en faveur de toute la société.
Conviendrait-il de faire des lois à cet égard ?
Nous venons de prouver que les mauvais traitements exercés sur les animaux intéressent la morale publique jusqu’au point d’affaiblir quelques vertus sociales, d’en détruire quelques autres et de verser sur toutes une influence dangereuse.
Nous avons dû voir que l’habitude née des erreurs, des préventions d’une mauvaise éducation privée et publique et surtout des exemples, était la cause immédiate de ces mauvais traitements et, conséquemment, une de celles de la perversité des mœurs.
Ainsi la morale, devenue insuffisante par elle-même pour lutter seule avec avantage contre ce torrent qui les renverse ; il devient facile de répondre à la dernière question proposée.
[53] […] Il n’y a que la sagesse et la force des lois, le pouvoir de les faire exécuter qui puissent y mettre un terme ; ainsi la morale, la législation et la puissance doivent se servir et combiner ensemble leurs moyens pour la confection d’un courage devenu si urgent. Il est temps de rectifier à cet égard nos mœurs, nos habitudes et d’appliquer à la morale publique qui s’en trouve bornée, des remèdes salutaires.
Il est temps de donner à cet égard aux Français, une réputation d’humanité qu’ils n’ont pas acquise, envers les animaux, ou qu’ils n’ont perdue que par légèreté et d’imiter en cela nos voisins, parce que les vertus n’ont d’ennemis que les vices.
Le mal est là. C’est lui qui, attaquant les racines des vertus les plus simples, les plus faciles comme les plus grandes, attaque aussi sourdement celles des meilleures institutions sociales édifiées par elles. Il s’introduit dans les foyers les plus obscurs de la médiocrité, comme dans les plus apparents de l’orgueil et du luxe. Il sape ainsi la base des meilleurs gouvernements et entre peut-être dans les causes cachées qui préparent les catastrophes sanglantes qui bouleversent les nations et rendent pour longtemps les hommes malheureux.
La plupart des hommes ignorent peut-être jusqu’à quel point les animaux étant sensibles, ils sont envers eux cruels et injustes. Il convient donc de le leur enseigner et de leur ôter ce prétexte à leur barbarie. C’est aux philosophes moralistes, c’est aux sociétés savantes, à préparer l’opinion et rassembler les matériaux de sa nouvelle éducation, c’est à un gouvernement sage à achever l’ouvrage.
Il faut des lois préservatives ou préparatoires. Il faut des lois conservatrices ou qui protègent les animaux. Il faut enfin des lois coercitives qui obligent les hommes envers eux et les punissent. […]
[54] Lois conservatives
Des règlements justes et vigoureux, pourtant obligatoires, qui déterminent précisément la manière, la mesure et la nécessité de la chasse et de la pêche, qui obligent les hommes à l’entretien et aux soins des animaux qu’ils ont en leur pouvoir, qui en fixent le nombre proportionnel ainsi que leur espèce, qui garantissent ces animaux des mauvais traitements, des procédés malsains [55] pour tous les objets d’utilité et d’agrément, qui les protègent contre des travaux au-dessus de leurs forces, ou qui sont étrangers à leur inclination et à leur destination, mais surtout qui fixent, définissent et établissent leurs droits, qui défendent avec rigueur les fêtes et réjouissances sanguinaires dans lesquelles les animaux sont lentement sacrifiés vivants, etc... doivent être établis, promulgués et faire l’objet des lois conservatrices ou qui protègent les animaux. Ces lois les regardent principalement.
Lois coercitives
Enfin des punitions proportionnées à tous les âges et dans tous les lieux, vengeant les animaux de notre longue barbarie, réprimant les infracteurs de leurs droits, doivent être l’objet des dernières lois qui obligent et punissent. Un sénateur dans l’aréopage fut puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui, fuyant de frayeur, s’était refugié dans son sein, c’était l’avertir qu’un cœur fermé à la pitié ne doit pas disposer de la vie des citoyens[7].
Le moment est favorable pour établir ces lois. C’est lorsque toutes les routes de l’administration publique sont éclairées et parcourues, qu’elle se rassoit sur les bases de l’équité et de la justice ; c’est lorsque l’opinion environne un sage gouvernement de toute sa puissance, ces lois que la valeur jointe au génie ont rendu à la France les arts et la paix intérieure, que les animaux doivent être heureux comme les hommes le sont.
Dans tous les objets que nous venons de parcourir, je suis loin de croire avoir atteint le but proposé. Mille vérités utiles pouvaient être dévoilées et présentées dans un sujet aussi riche. Mais il faudrait des volumes, un grand loisir et de grands talents. Je n’ai fait que les indiquer en les laissant apercevoir. Je crois m’en être occupé suffisamment.
J’ai démontré la sensibilité des animaux, présenté le tableau des traitements barbares exercés sur eux, trouvé le point jusqu’où ces traitements barbares intéressent la morale publique, par leurs degrés d’influence sur les vertus sociales qui la composent, enfin prouvé la nécessité de faire des lois à cet égard en indiquant les bases morales sur lesquelles elles doivent être établies, je crois avoir parcouru les branches du programme, si je n’en ai pas rempli l’objet.
[56] Il a fallu se laisser aller à quelques déclamations, puisqu’en traitant de la morale, il est trop nécessaire de blâmer et censurer.
Il a fallu céder au besoin de quelques répétitions devenues inévitables dans un sujet qu’il faut présenter sans cesse pour bien l’apercevoir.
Peut-être aussi y ai-je trop montré la chaleur que ma sensibilité envers les animaux développe et nourrit à chaque instant du jour : je ne crois point qu’on m’en blâme. Mes juges sont des hommes sensibles aussi. Leur moralité et leurs lumières fondées sur cette sensibilité garantissent la morale publique.
J’ai cru ne pouvoir pas assez faire pour satisfaire au besoin qu’ils ont et qu’ils prononcent si solennellement de voir améliorée cette morale publique en s’occupant des hommes par le sort des animaux. Ils prouvent que l’humanité est la première vertu dont un être sensible doit se glorifier.
Si j’ai contribué en quelque petite chose à alléger leur sollicitude, j’ai rempli mon but.
L’humanité est un sixième sens.
Notes:
[1] Pans plat in burthed…, tom. 2, p. 388
[2] Isocr (…), tom. 2, pag 390
[3] Emile ou de l’Education, pag. 1
[4] Dict Encyclop. des anecd., pag. 274.
[5] Xenoph de Venato, p. 994 et 995, Bartts voy des anach. Tom. 3, pag 32
[6] M. de Bonald dans son Discours préliminaire sur le divorce considéré … Au dix-neuvième siècle
[7] Helled, apud. Phoc, pag. 15.91 Barthel, voi du j. anarch. tom 2. pag. 325.