Animal sum, animalium nihil a me alienum puto
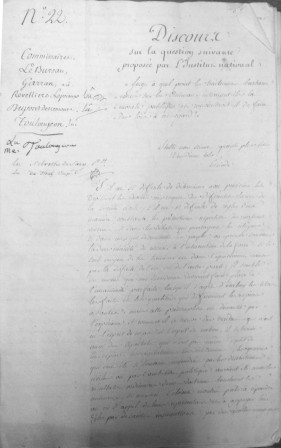
P. 2 […] la raison de Descartes ne peut qu’affliger la sensibilité. Les cris d’un animal qu’on frappe ou qu’on tue, semblables suivant son système aux sons d’une barre de fer que l’on forge sur une enclume ne retentissaient-ils donc jamais que dans les anfractuosités de ses oreilles ? Quelle erreur fut jamais plus contraire à l’humanité ! Et quelle erreur néanmoins a compté plus de partisans ! mais il suffit de penser d’après le cri de compassion que jeta l’aimable auteur de la Pluralité des mondes en voyant lancer un violent coup de pied à une chienne qui était près de mettre bas [sic] des petits[1], il m’est, dis-je, consolant de croire, de dire et d’écrire que ce célèbre cartésien et que la plupart des disciples de l’immortel auteur des tourbillons n’ont été ni convaincus ni persuadés de cette trop fameuse opinion de leur maître, et que l’esprit de système, peut être plus pardonnable alors qu’aujourd’hui, leur a fermé les yeux à la dangereuse conséquence du système des automates ; de plus si devant le sage tribunal qui doit me juger moi-même, je me suis vu contraint par ma conscience de faire les fonctions d’accusateurs public et d’invoquer la condamnation sur une erreur dangereuse pour les mœurs, je ne me crois pas moins obligé de demander son absolution. Lui, un grand homme dont l’esprit l’a conçue et propagée sans doute à l’insu de son cœur et qui mérite d’ailleurs l’admiration de tous les siècles, qu’il me soit permis de déchirer cette honteuse page de la philosophie de Descartes et d’y substituer le charmant impromptu que sa nièce, aussi spirituelle que sensible, fit un jour dans sa chambre de mademoiselle de Scudéry – son intime amie – à l’occasion d’une fauvette qui revenait tous les ans sur la fenêtre de cette demoiselle.
P. 3
Voici quel est mon compliment,
Pour la plus belle des fauvettes,
Quand elle revient où vous êtes,
Oh, m’écris-je alors avec étonnement,
N’en déplaise à mon oncle, elle a du jugement !
Ce n’était rien moins qu’un diable qui animait le chien noir d’Agrippa, et ce n’était ni un Dieu, ni une Déesse, ni un Bon Génie qui faisait agir la biche blanche de Sertorius, mais c’était tout simplement leur faculté instinctive mieux développée, mieux cultivée que d’ordinaire par l’éducation soignée qu’ils avaient reçue de leurs maîtres qui leur faisait faire des choses qu’on attribuait, fût-ce mal-à-propos, à la Magie. Ce n’est qu’en examinant les animaux de très près, qu’en vivant avec eux en ami et non pas en maître et qu’en les étudiant avec un esprit idolâtre de la vérité, qu’on peut soulever un coin du voile épais qui cache le principe mystérieux de leurs opérations, et ce n’est que par ces moyens que l’on peut se convaincre que la distance qu’il y a entre leurs instinct et notre raison n’est point incommensurable. Aussi je ne suis pas du tout surpris que l’éloquent Buffon n’ait vu aussi en eux que des horloges naturelles un peu plus ingénieuses que nos horloges artificielles ; car les plus grands admirateurs, du nombre desquels je me ferai toujours gloire d’être, sont obligés de convenir qu’il n’observait pas la Nature que de toute la hauteur de son génie et par conséquent de beaucoup trop loin. D’ailleurs, outre que les preuves dont il étaye son sentiment ne doivent l’apparence de la solidité qu’à la magie de son style et qu’il eut été incapable de répondre à cent objections qu’il ne s’est pas faites et qu’il était si facile de lui faire, la persuasion qu’il en avait lui-même était si faible [qu’il ?] paraît être d’un sentiment contraire dans cent endroits de son Histoire naturelle.
Il me serait bien doux de pouvoir ici entretenir mes juges de mes souvenirs les plus chers et de leur raconter la vie d’un petit chien auquel l’une de mes sœurs et moi nous devons plus de trois quarts des jouissances de notre enfance, mais ils ne seraient pas obligés de me croire et son histoire fidèle et honnête jusqu’au scrupule (p. 4) ne pourrait leur paraître qu’une fable ou qu’un roman. Au reste, quoique l’on dit et quoiqu’on puisse dire encore, il est plus aisé de faire voir ce que l’instinct des bêtes n’est pas que ce qu’il est effectivement ; sans vouloir épuiser cette mystérieuse question, je n’hésite point à soutenir que la décision de Descartes est inadmissible, parce que tout nous prouve et qu’il est hors de tout doute qu’elles sont comme nous plus ou moins sensibles, ou il suffit que nous sachions avec certitude qu’elles sont sujettes à la douleur sans l’avoir mieux mérité que nous ; et il suffirait même que nous en eussions quelque probabilité pour que nous nous fassions une loi de les traiter avec bonté et de leur faire le moins de mal qu’il est possible.
La reine de toutes les vertus sociales, la sainte humanité, embrasse tous les êtres sensibles. Qui que vous soyez, qui ne compatissez aux peines d’un de vos semblables que parce que vous réfléchissez que le même malheur peut vous arriver, vous vous trompez si vous prenez votre compassion pour de l’humanité et si vous la prenez pour autre chose que du véritable égoïsme, puisque dans votre semblable souffrant vous ne voyez que vous-même, menacé de souffrir un jour comme lui. Mais frémissez-vous à la vue d’un bœuf attaché à la porte ou aux fenêtres d’une boucherie, l’idée de l’affreux sort qu’il est prêt à subir est-elle pour vous un tourment ? Vous poursuit-elle longtemps et vous oblige-t-elle à déclamer contre les imperfections de notre malheureux monde ? Ne pouvez-vous vous trouver à côté d’une charrette trop chargée qu’un infortuné cheval tâche en vain, quoiqu’avec les plus grand efforts, de faire avancer vers un lieu élevé, sans appliquer aussitôt vos bras aux rais de la roue que vous côtoyez, et sans ajouter toutes vos forces à celles de ce cheval épuisé de fatigues ? ne pouvez-vous vous trouver auprès d’un homme dur qui frappe rudement et mal-à-propos une bête de somme, un chien, ou quelque autre bête sans lui faire des vifs reproches ? Ne pouvez-vous vous déterminer à donner la mort à une taupe, à un rat, ne pouvez-vous écraser un insecte nuisible qu’avec un effort pénible et un sentiment amer ? Alors vous pouvez vous flatter de posséder le plus précieux de tous les trésors, alors vous pouvez croire que la mère de toutes les vertus sociales fait sa résidence dans votre cœur : la panzoophilie[2] est la seule matrice d’où puisse naître la vraie philanthropie et celui qui se dit philanthrope sans être panzoophile ne peut être qu’un égoïste hypocrite.
P. 5. A la gravité, la plupart des choses perdent en profondeur ce qu’elles gagnent en étendue, mais l’humanité devient plus profonde, plus active et plus brulante à mesure qu’elle embrasse plus d’ouvertures sensibles. La raison qui seule élève l’homme au-dessus des animaux, la raison qui l’a fait leur roi mais qui lui défend d’être leur tyran, cette raison qui nous rend si fiers et si dédaigneux à leur égard lorsque nous fermons les yeux à la bienfaisante lumière, ne nous fera t-elle pas dire, si nous l’interrogeons à la vue d’un agneau sous le couteau du boucher, trois fois malheureuse, créature, pourquoi ne suis-je pas à ta place ? Pourquoi n’es-tu pas à la mienne ? Qu’est-ce qu’as-tu fait en naissant pour être condamné à un sort aussi affreux ? et moi quel bien ai-je fait en recevant ta vie pour être moins malheureux, qu’il me soit permis d’ajouter que de tous les mystères de ma religion, celui-là a toujours été le plus obscur pour moi et le plus difficile à concilier avec la justice infinie de Dieu, et que je n’ai jamais essayé de sonder cet abyme sans m’écrier : ô altitudo !
Si la lumière de la raison en plein midi nous fait croire clairement que la pitié est la <…> à la conservation et à l’accroissement de laquelle la société doit s’intéresser le plus puisqu’elle porte la bienveillance, le désintéressement, la bienfaisance et toutes les vertus sociales, puisqu’elle voudrait tous les hommes heureux et que la seule pensée de la souffrance la fait souffrir, la même vertu, renforcée de celle du grand flambeau de l’expérience nous fait voir aussi que nous ne serions impitoyables envers les animaux sans le devenir en même temps envers nos semblables, que <…> dégénère bientôt en cruauté et que la cruauté est nécessairement amie de l’immoralité. Ceux qui ont étudié les passions sont convaincus que le combat de deux coqs ne saurait amuser un mauvais [homme] sans lui inspirer en même temps le désir de voir le combat plus sanglant d’une bête féroce contre une autre bête féroce et ceux qui ont médités les histoires sont persuadés que le combat d’un lion contre un taureau ne tarda pas de conduire les romains à celui d’un lion ou d’un taureau contre un gladiateur et que ce dernier spectacle les a conduits le lendemain à celui d’un gladiateur contre un autre gladiateur. Ne nous étonnons donc plus que dans le dernier siècle de la République ait poussé le goût de la cruauté jusqu’à se donner pendant leur repas cette dernière série de spectacles ; ne nous étonnons plus des ruisseaux de sang romain qui ont coulé dans les proscriptions de Sylla, d’Octave etc., ne nous étonnons plus de la coupe remplie de sang, du même sang que Catilina fit boire à tous ses conjurés, ne nous étonnons plus enfin que le Peuple roi qui ne l’était que par ses mœurs et par ses vertus soit devenu par sa cruauté et son immoralité un peuple de vils.
P. 6. Rien n’a surpassé la manie des anciens Romains pour les spectacles des gladiateurs que la fureur des espagnols pour les combats de taureaux : dans les bourgs et dans les villages elle est la même que dans les villes. Aussi ne peut-on lire sans frémir le récit des meurtres, que les espagnols ont accompli dans le nouveau monde sur les malheureux indiens et je ne puis m’empêcher d’émettre cette autre conclusion : aussi la redoutable inquisition a déployé chez eux une vigueur beaucoup plus terrible que dans tous les autres pays où elle s’est malheureusement introduite. Oui, je crois avoir signalé la vraie cause de ces deux grands malheurs : car tout se tient dans le mal comme dans le bien, et l’humanité ne peut être le premier mobile de celui-ci sans que le vice contraire à cette vertu soit le premier mobile de celui-là.
En vain les graves espagnols avides de ces tristes divertissements prétendraient-ils s’excuser en disant que ces spectacles leur offrent des exemples de bravoure et de valeur et qu’ils servent à entretenir parmi eux les vertus militaires ; car quelle bravoure et quelle valeur peut-on reconnaitre dans des hommes armés de lances et de poignards qui frappent sans pouvoir être frappés, qui s’ils sont à cheval présentent sans cesse le poitrail de leurs coursiers aux cornes du taureau et qui, s’ils sont à pieds, se sauvent dans des tonneaux lorsque le danger est imminent[3] ? Autant faudrait-il appeler brave un soldat qui dans un temps de guerre s’en prendrait et percerait de vingt coups de baïonnette un soldat ennemi qui n’aurait que ses bras pour armes défensives ; autant faudrait-il donner ce beau nom à un vil boucher qui assomme et qui égorge un bœuf incapable de se défendre.
P. 9
Quod genus hoc hominum ; quaeve hunc tam barbara morem permittit patria ?
Lequel d’entre eux n’appellera avec moi la justice au secours de l’humanité ? Lequel d’entre eux n’apercevra un grand vide dans les deux codes correctionnels et ne souhaitera ardemment que ces deux lacunes soient bientôt remplies ? lequel d’entre eux en un mot ne conclura que le gouvernement français ne saurait trop tôt tourner son attention et sa sagesse vers les moyens de réprimer ces dangereux désordres et faire peser sur eux des lois assez sévères pour les noyer dans le sang où ils vivent et aussi se multiplient.
La plupart des législateurs anciens, parmi lesquels je puis citer celui que le grand Bossuet appelle le plus ancien des historiens, le plus sublime des philosophes et le plus sage des législateurs, n’ont pas dédaigné de faire des lois en faveur des animaux. Mais après les philosophes de l’Inde, qui dès le temps le plus reculé ont couru dans cette carrière, mais qui ont dépassé le but en voulant l’atteindre, c’est chez les peuples les plus éclairés de l’antiquité, c’est chez les grecs qui ont été conçues, méditées, promulguées les lois les plus sages en faveur des animaux. Plusieurs auteurs modernes ont pris plaisir à citer et à louer cette loi des Thessaliens qui prononçait la peine de mort contre quiconque oserait tuer une cigogne ; et le judicieux et éloquent auteur de l’Esprit des lois semble avoir approuvé et même admiré les deux sentences de mort que l’Aéropage d’Athènes porte contre deux monstres à figure humaine, dont l’un avait tué un moineau qui s’était réfugié dans son sein pour éviter les serres d’un épervier qui le poursuivait, et dont l’autre avait crevé les yeux à son oiseau ; on est étonné – dit ce grand homme – de la punition de cet aréopagite lequel avait tué un moineau poursuivi par un épervier et refugié dans son sein ; on est surpris que l’aréopage ait fait mourir un enfant qui avait crevé les yeux de son oiseau, qu’on fasse réflexion qu’il ne s’agit point là d’une condamnation pour crime mais d’un jugement de mœurs dans une République fondée sur les mœurs (esprit des lois).
Je n’ignorerai pas ce qu’a dit là-dessus le plus célèbre écrivain du dix-huitième siècle : « non, je ne suis point surpris – dit-il dans son commentaire sur L’esprit des lois – de ces deux jugements atroces, car je n’en crois rien ; et un homme comme Montesquieu disait n’en rien croire, quoique on reproche aux athéniens beaucoup d’inconséquences, de légèretés cruelles, de très mauvaises actions et une plus mauvaise conduite, je ne pense point qu’ils aient eu l’absurdité aussi ridicule que barbare de tuer des hommes et des enfants pour des moineaux. C’est un jugement des mœurs, dit Montesquieu, quelles mœurs ? Quoi donc ! n’y a-t-il pas une dureté de mœurs plus horrible à tuer dans chaque compatriote qu’à tordre le cou à un moineau ou à lui crever l’œil ?
P. 11. qu’on n’aille pas croire au reste que je me prépare à prêcher l’abstinence des indous et des pythagoriciens à laquelle néanmoins je ne puis m’empêcher d’applaudir et à laquelle je n’hésiterais pas un instant de me soumettre si ce sacrifice non sanglant fait à la pitié et à l’amélioration de notre caractère et de nos mœurs, pouvait mettre fin à tous les sacrifices sanglants que nous faisons à notre gourmandise : pour ne point tenter l’impossible, je me contenterai de dire avec un grand poète :
Dès longtemps l’habitude à vaincre la nature
Mais elle n’en a pas étouffé le murmure.
Soyez donc leurs tombeaux, vivez de leur trépas
Mais en consommant un fruit ne les accable pas
L’Eternel le défend, la pitié protectrice
Permet leur échange et non pas leur supplice.
En admettant donc que le créateur a créé les animaux pour notre utilité et pour nos plaisirs, et qu’il a accordé à l’homme la permission de se nourrir de leur chair et de leur ôter la vie quand lui est ou lui parait être inévitable mais utile, il n’en sera pas moins vrai de dire que le bon sens et la justice autant que l’humanité veulent qu’en leur donnant la mort on les fasse souffrir le moins qu’on le peut, car ou notre raison n’est qu’un être de raison, ou après l’avoir interrogée dix mille fois sur ce cas, nous devons croire sans doute à ses dix mille réponses qui affirmeront toutes également que la douleur crie vengeance contre celui qui la cause en vain, et qu’elle le rend par conséquent criminel aux yeux de Dieu et des hommes.
P. 12. De ce dernier principe de morale, non moins évident, non moins incontestable que les autres que j’ai fait servir de base à mon discours, il s’ensuit que tout gouvernement juste doit ordonner aux bouchers sous des peines sévères de donner aux animaux qu’ils tuent la mort la moins douloureuse ou comme l’amputation de la tête fait d’un seul coup paraît malheureusement être la moins douloureuse de toutes les morts violentes que l’on connaisse, il est visible que dans cette supposition la guillotine est le seul instrument de mort qui puisse être toléré dans les boucheries.
Il ne s’en suit pas moins évidemment de tout ce que j’ai dit que tout gouvernement ami des mœurs et par conséquent que tout gouvernement républicain qui selon Montesquieu doit faire des mœurs son principal ressort, doit réduire les bouchers au plus petit nombre possible, doit appeler sur eux tous les yeux de la police et doit soustraire à ceux du public l’intérieur des boucheries et jusqu’à la plus petite effusion de sang.
P. 14. Il est possible que la pitié portée aussi loin que je voudrais la pousser paraisse excessive et que l’on me n’objecte qu’en toutes choses, l’excès ne vaut pas mieux que le défaut : on pourra m’objecter qu’une pareille pitié ne pourrait qu’efféminer les hommes en éteignant dans leur cœur la bravoure, la valeur, l’intrépidité et le courage et qu’elle ne pouvait manquer de devenir funeste à une république ; je réponds d’avance que la pitié n’est pas plus susceptible d’excès que l’amitié, ou que du moins l’excès dans ces deux sentiment divins est également beau, également fructueux, également honorable. Je dois ajouter qu’une pareille pitié doit nécessairement être la plus implacable ennemie du despotisme et de la tyrannie comme l’amante la plus passionnée de la liberté et que le cœur qu’elle échauffe autant qu’elle l’amollit doit être inaccessible à la crainte. Comment pourrait-elle, en effet, ne pas s’indigner contre l’oppression et ne pas plaider la cause de l’opprimé ? Comment pourrait-elle se lasser de parler en sa faveur tant qu’il lui resterait la moindre espérance de lui être utile ? Et comment enfin dans son désespoir, pourrait-elle s’empêcher de dépenser toutes les forces de ses poumons pour appeler à son secours et faire trembler ou rougir son injuste et vil oppresseur, elle qui ne peut entendre un gémissement sans gémir, elle qui oublie ses propres peines pour partager et pour alléger celles qu’elle voit hors de soi ? Eh ! De qui et de quoi en vérité pourrait avoir peur la conscience pure et tranquille, la conscience irréprochable qu’elle embrasse de ses pures flammes ? Quels plus beaux exemples de courage et de civisme pourrait-on trouver dans les cent mille in-folio de l’histoire que ceux qui nous ont donné plusieurs partisans de la métempsycose ? Qui ne sait que Pythagore après ses longs voyages se condamna à vivre loin de sa patrie pour ne pas courber son col sous le joug de Polycrate qui en avait usurpé le gouvernement pour le gouverner en despote ? Qui ne sait que plusieurs républiques de la Grèce lui demandèrent des règlements et des lois ? Qui ne sait que Apollonius de Tyane après avoir visité comme lui les Brahmanes des Indes, les Mages de Perse et les Gymnosophistes d’Egypte voulut aussi voir Rome, quoiqu’au péril de sa vie, pour connaître, disait-il, quel animal c’était qu’un tyran ? Qui ne sait avec quelle intrépidité il déclama contre la tyrannie, se laissa conduire de sa prison au redoutable tribunal de Domitien qui voulait le juger et condamner à mort avec quelque apparence de justice et avec quelle présence d’esprit et quelle fierté il répondait à toutes les questions de ce monstre sanguinaire ? Trouverait-on dans Caton d’Utique et dans Brutus un plus profond mépris et une plus forte haine (p. 15) du despotisme que dans le sage de Samos et dans celui de Tyane ? et reconnaitra-t-on dans aucune des actions d’Alexandre le grand plus d’héroïsme que dans celle du philosophe indien Calanus montant avec un visage serein sur un boucher qu’il ordonne d’allumer pour mettre fin à une vie qu’il ne pouvait plus rendre utile à ses semblables. Les Espagnols et les Anglais, peut-être moins humains, moins accessibles à la pitié que les Français, sont-ils meilleurs soldats que ces derniers ? Il n’y a sans doute que le délire qui pourrait rendre excusables ceux qui soutiendraient l’affirmation. Sont-ce donc les combats de taureaux qui ont fait remporter six cent victoires aux armées invincibles de la République française ? Non, non, c’est la haine de la tyrannie, c’est l’amour de la liberté qui ne sont nulle part si actifs que dans un coin où brûle le feu céleste de la pitié et de l’humanité. Loin de tous les rois, loin de tous les magistrats, loin de tous les législateurs, enfin la fausse et funeste opinion qu’il faille brider la pitié, et si la trop fière Albion a rendu un grand service à la France, à l’Europe et même aux deux hémisphères de notre globe en leur offrant l’inestimable présent de la vaccine, puisse la République Française rendre bientôt à l’Angleterre et aux quatre parties du monde, un beaucoup plus grand service encore, en injectant dans tous les cœurs la pitié envers les animaux, et en ajoutant un nouveau traité essentiel à la morale universelle.
Notes:
[1] On lit dans les mémoires pour servir à l’histoire de la vie et des ouvrages de M. de Fontenelle par l’abbé Trublet, l’anecdote suivante : Fontenelle étant un jour allé voir le père Mallebranche aux p. p. de l’oratoire de la rue Saint Honoré une chienne qu’on nourrissait dans sa maison et qui était pleine, entra dans la salle où ils se promenaient et vint caresser le père Mallebranche et se rouler à ses pieds. Après quelques mouvements inutiles pour la chasser, le philosophe oratorien lui donna un grand coup de pied qui fit jeter à la chienne un cri de douleur et à Fontenelle un cri de compassion. « Oh quoi – lui dit froidement le père Mallebranche – ne savez-vous pas que cela ne sent pas ? ». « Cette historiette, dit Fontenelle un de ses amis, peint parfaitement le père Mallebranche, mais elle vous peint aussi vous même. Elle prouve votre bon naturel, on a beau dire ; les bêtes ont une âme et vous avez de l’âme ». Fontenelle prit très bien cette plaisanterie et n’en fit que rire.
[2] Je ne me suis permis ce nouveau mot que j’ai tiré de trois mots grecs dont l’assemblance [sic] signifie l’amour ou la bienveillance envers tous les êtres vivants que parce que je n’en ai pas trouvé d’autres dans notre langage pour exprimer la même idée.
[3] Je tiens d’un soldat du régiment des gardes Wallons en Espagne qui a été plusieurs fois le témoin involontaire des grands combats de taureaux à Madrid, qu’il a toujours vu ruisseler le sang des taureaux et des chevaux, qu’il n’a jamais vu couler la moindre goutte de sang humain.