reçu le 13 messidor an. XI Commissaires : Le Bureau : Garran, La Révellière-Lépeaux, Dupont (Denemours), Toulongeon, Silvestre de Sacy.
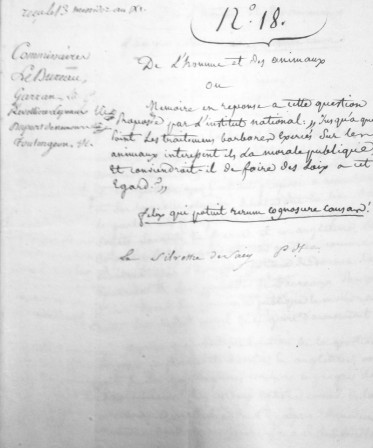
De l’homme et des animaux ou Mémoire en réponse à cette question reposée par l’institut national : « Jusqu’à quels points les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent ils la morale publique et conviendrait-il de faire des lois à cet égard »
Felix qui potuit rerum cognoscere causas
[2] Légitimité, on peut induire qu’elle est toujours sous l’empire des préjugés et des habitudes machinales.
Avant d’examiner si les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent la morale publique, peut-être convient-il de rechercher si la morale privée peut les avouer, ou les permettre. Car tout ce qui blesse la morale publique peut ne pas blesser la morale privée ; mais ce qui blesse la morale privée blesse nécessairement la morale publique, voyons donc si la première est ou n’est pas intéressé dans l’objet dont il s’agit ici.
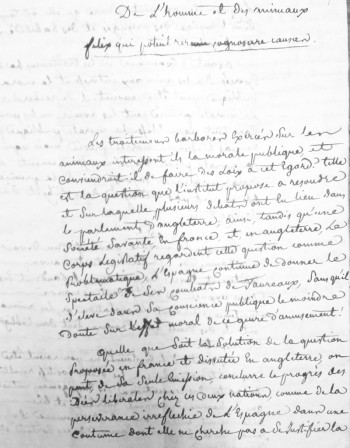
S 1
Pour que la morale privée fit un devoir à l’homme de s’interdire tout mauvais traitement envers les animaux il faudrait supposer dans ceux-ci des droits dont ces mauvais traitement seraient la violation. Or, les animaux ont-ils des droits que l’homme soit dans l’obligation de respecter ?
Ces droits, s’ils existaient, ne pourraient être que des droits naturels ; car les droits positifs résultent des pactes, des convections, des engagements mutuels que les hommes prennent entre eux et bien certainement entre l’animal et l’homme, il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais de ces sortes de transaction.
[3] Celui qui s’engage ses services sous la condition d’un salaire proportionné a le droit d’exiger ce salaire, comme j’ai le droit d’exiger ses services : c’est un devoir en lui de me les rendre comme c’est un devoir, en moi, de lui payer le salaire dont nous sommes convenus ; mais ce droit et ce devoir respectifs sont l’effet immédiat d’une convention. Si cette convention n’avait pas eu lieu, je n’aurais aucun droit d’exiger les services que j’exige et celui qui me les rend n’auraient pas non plus le droit d’en exiger le salaire.
Tous les droits positifs émanent de la même source soit qu’ils résultent des diverses transactions que les particuliers font chaque jour entr’eux, soit qu’ils dérivent des lois civiles et politiques ; car ces lois ne sont autre chose que des conventions ou des engagements auxquels se soumettent tous les individus qui composent la société. S’ils n’étaient pas susceptibles de se soumettre à ces conventions ou de se lier par ces engagements, ils n’auraient aucun droits qui en sont la conséquence.
Cette condition fondamentale du droit positif n’existant point de l’animal à l’homme ; il est clair que leurs rapports mutuels ne peuvent jamais donner lieu à cette espèce de droit et que par conséquent ils ne peuvent jamais, l’un envers l’autre se rendre coupables de sa violation.
Telle est la position de l’homme envers les animaux et des animaux envers l’homme : ils ne sont [4] témoins de rien de positif les uns envers les autres parce qu’il ne peuvent stipuler entr’eux aucune obligation positive : il faut donc, en traitant de leurs rapports naturels, faire abstraction des droits et des devoirs qui, parmi les hommes résultent des lois établies, des engagements pris ou contractés, et hors desquels plusieurs écrivains ont pensé qu’il n’y aurait ni droit ni devoir d’homme à homme à plus forte raison de l’homme à l’animal.
S 2
Mais si les animaux n’ont aucun droit positif s’en suit-il qu’ils n’aient aucun droit naturel ? Aucun engagement, ni aucune lois ne me lie à un individu d’une autre nation que la mienne ; nous ne nous sommes rien promis l’un à l’autre ; aucune obligation n’a été stipulée entre nous, cependant hors le cas d’une légitime défense, je ne me croirai point autorisé à le tuer ou à le maltraiter. Je respecterai en lui ses droits naturels, et s’il y a dans l’homme des droits naturels qui commandent ce respect en l’absence des droits positifs, pourquoi n’en serait-il pas de même des animaux ? Pourquoi n’auraient-ils pas aussi des droits naturels que nous serions dans l’obligation morale de respecter, malgré leur incapacité à se créer des droits positifs ?
C’est que l’existence de ceux-ci est la seule preuve de l’existence des autres. Nous admettons des droits naturels dans l’homme, parce que la faculté de les réaliser en droits positifs, nous démontre que ces [5] droits existent dans sa nature, qu’ils y sont en puissance, car, si elle ne les reformait pas implicitement, comment aurait-il pu les rendre explicites ? Serait-ce une attribution qu’il se serait donnée, une création dont il se serait enrichi ? Mais l’homme ne peut rien se donner ; il ne peut que mettre à profit les dons qu’il a reçus : il faut donc, pour qu’il acquière des droits positifs, qu’il y ait en lui des droits naturels dont les premiers ne sont, en quelque sorte, que la traduction et ceux là commandent le respect pour l’homme, indépendamment de toute convention et de toute loi positive. Je blesse nécessairement ces droits lorsque j’attente à sa vie, à sa liberté, à sa propriété.
Mais il n’en est pas de même des animaux : ceux-ci ne pouvant jamais s’élever à aucun droit positif, avouent par cela même qu’ils n’ont aucun droit naturel, car s’ils étaient pourvus d’un droit naturel quelconque se trouveraient-ils toujours dans l’impuissance de le réaliser ou de le rendre positif ? Cette impuissance n’est-elle pas une preuve certaine que cette espèce de droit n’existe pas en eux ? Pourquoi donc voudrait-on qu’ils fussent respectés et que la conscience morale se trouvât intéressée dans les traitements auxquels on les soumet ?
Ajoutons que l’existence d’un droit implique nécessairement celle d’un devoir. Le droit de faire respecter ma personne ou ma propriété est indivisible du devoir de respecter celle des autres et il en est de même de tous les droits : il faudrait donc pour admettre [6] ceux-ci dans les animaux, qu’ils fussent susceptibles des autres et ils ne le sont pas. Le chien qui me suit, ou qui veille autour de mon habitation, le cheval qui me prête son dos, le bœuf qui laboure mon champ, ne remplissent pas des devoirs en remplissant ses diverses fonctions. De quelques actes que se compose le système de la conduite animale, elle n’offre que des faits et rien de plus ; et par cela même qu’il n’entre aucun devoir, ni aucune obligation dans ce système, nous pouvons et nous devons le regarder comme exclusif toute espèce de droit.
Ce n’est qu’en confondant des rapports partiellement différents et par une véritable erreur de jugement que nous chercherions à introduire dans nos relations avec les animaux des considérations de justice et de moralité qui n’y sont pas naturellement et auxquelles il serait absurde d’en faire l’application parce qu’elles s’y trouveraient sans motif légitime. Quelle que soit notre conduite envers les bêtes, nous ne pouvons jamais violer des droits qu’elles n’ont pas, ni par conséquent être justes aux criminels sous ce rapport, car où il n’y a point de violation de droit, il n’y a point d’injustice.
Il est donc évident que les mauvais traitements exercés sur les animaux n’effectuent point la morale privée ; mais ne serait-il pas possible qu’il en fut autrement de la morale publique ? C’est en ceci que consiste proprement le véritable état de la question que nous allons essayer de résoudre.
[7] S 3
Il serait sans doute assez difficile de tracer une ligne de démarcation entre la morale privée et la morale publique : tout ce qui blesse la première, comme nous l’avons déjà dit, blesse nécessairement l’autre ; mais la morale publique plus délicate, en quelque sorte, que la morale privée, peut être affecté de certaines phases qui n’effectuent nullement celle-ci, ou qui même sont parfaitement conformes à ses principes.
Les rapports, par exemple, que deux époux peuvent avoir entr’eux n’ont rien de contraire à la morale privée, elle leur en fait même un devoir toutes les fois que des raisons légitimes ne leur commandent pas de s’en abstenir. Néanmoins s’ils se permettent de les afficher, ou de les donner en spectacle ils outrageraient la morale publique parce qu’ils blesseraient les sentiments et les idées de décence et de pudeur que cette morale a sanctionnés et qu’elle est intéressée à maintenir.
On peut donc regarder comme contraires à la morale publique tous les actes dont la manifestation ou la publicité tendent à infirmer, à altérer, ou à détruire les sentiments que cette morale fait un devoir de conserver, de propager et dont le dépérissement corromprait ou dénaturait les mœurs du peuple.
Parmi ces sentiments, celui de l’humanité occupe sans doute le premier rang ; car, s’il était possible d’en dépouiller entièrement les hommes, il n’y aurait plus dans leurs relations que le froid calcul de l’égoïsme et quoique la raison éclairée put leur démontrer que le [8] ménagement de leur propre intérêt, exige le ménagement de celui des autres, cette démonstration n’aurait jamais l’effet du sentiment qui la devance et la supplée : elle n’équivaudrait qu’imparfaitement à cet instinct, ou à cette sympathie, qui nous mettent à la place de celui qui souffre, nous porte à le soulager par le besoin que nous éprouvons de nous soulager nous-mêmes.
Il est donc bien certain que si la manière dont on traite les animaux, ou le spectacle des traitements auxquels on les soumet, pouvaient altérer ou détruire. Cet instinct précieux, cette sensibilité sympathique qui nous intéressée aux souffrances de nos semblables ils auraient beau n’avoir en eux-mêmes rien d’injuste, rien de criminel, rien de contraire à la morale privée. La morale publique n’en serait pas moins intéressé à les réprimer. Cette répression qu’on ne pourrait pas déduire de la nature des animaux se déduirait de celle de l’homme-même, car, en respectant les animaux, c’est l’homme qu’on respecterait.
Mais est-il vrai que les mauvais traitements envers les animaux puissent altérer ou détruire dans l’homme le sentiment généraux de la pitié, le rendre inhumain, féroce, ou moins compatissant envers ses semblables ? Voilà ce qu’on croit communément. Mais il en est de cette opinion comme de bien d’autres qu’on admet des quelles se présentent, sans se donner la peine d’examiner si elles ne sont pas le pur effet du préjugé et si l’on est véritablement fondé à les admettre.
[9] S 4
Eh quoi ! Me dira-t-on, vous voulez qu’on puisse tourmenter des animaux vivants, se repaître du spectacle de leurs souffrances, sans qu’il en résulte aucun altération de la sensibilité morale ? Celui qui n’est pas touché des souffrances qu’éprouvent les animaux le sera-t-il de celles qu’éprouveront ses semblables ? Ne portera-t-il pas dans ses rapports avec ceux-ci les mêmes dispositions à l’insensibilité, à la férocité, à la barbarie ?
D’abord pour savoir ce que souffrent les animaux il faudrait que nous connaissions parfaitement leur nature et nous n’avons sur cet objet que des hypothèses plus ou moins probables.
La plus ancienne de ces hypothèses est celle de Descartes. On sait que les cartésien regardaient les animaux comme des automates auxquels ils n’accordaient ni intelligence ni sensibilité. Ce système que Descartes avait emprunté du médecin espagnol Pereïra, acquit une grande célébrité dans les temps et donna lien à une foule d’écrits en vers et en prose.
D’autres philosophes se sont élevés contre cette doctrine et ont gratifié les animaux de toutes les facultés que nous remarquons dans l’homme : il n’y a, selon eux, d’autre différence que du plus au moins. Les bêtes ont, comme nous, la sensibilité, la pensée, la réflexion, le raisonnement ; mais leurs besoins étant plus bornés que les nôtres, ne leur permettant pas de développer ces facultés au point où nous les développons. Cette opinion est celle de Condillac : on la trouve [10] exposée dans son traité des animaux, où il réfute celle de Descartes et de Buffon.
Celui-ci n’admet ni l’automatisme de Descartes, ni le spiritualisme de Condillac : il accorde aux animaux la sensibilité, mais il leur refuse l’intelligence. S’il faut l’en croire, les animaux sentent, mais ils ne pensent pas ; car le sentiment n’est pas, selon lui, le principe de l’intelligence.
Ces trois hypothèses nous paraissent les seules qu’on puisse former sur la nature des animaux ; car ils sont des machines, comme l’a prétendu Descartes, ou des êtres inférieurs en intelligence, comme le veut Condillac, ou enfin, des êtres réduits à la seule faculté de sentir, comme le soutient Buffon. Quelque système qu’on adopte on rentre nécessairement dans l’une de ces trois opinions : nous n’examinerons pas quelle est la plus probable, car, notre objet n’est pas de déterminer ce que sont les animaux ; mais seulement de rechercher si les mauvais traitements qu’on exerce sur eux intéressent ou n’intéressent pas la morale publique.
Or ils ne pourraient s’intéresser qu’autant qu’il résulterait, comme nous l’avons déjà dit, de ces mauvais traitements, quelque altération de notre sensibilité sympathique pour nos semblables ; quelque dégradation de l’instinct généreux de la pitié. Nous savons que tel est l’effet que produisent les mauvais traitements exercés sur l’homme, mais sommes-nous aussi certains qu’il en suit de même de ceux qu’on exerce sur les animaux ?
[11] Dans l’hypothèse de Descartes, par exemple, les animaux n’étant que des automates, il est bien clair que de quelques manières qu’on les traite, il n’en peut résulter aucune détérioration de sensibilité. Pour un vrai cartésien, il n’y a pas de différence entre frapper un animal et frapper une pierre : cet acte ne peut donc altérer en rien l’instinct de sa pitié pour l’homme et alors en quoi pourrait-il intéresser la morale publique ?
Dans le système de Condillac, les animaux étant ce que nous sommes, ayant les mêmes facultés que nous, mais dans un moindre développement, les mauvais traitements qu’on exerce sur eux doivent avoir les mêmes conséquences, c’est-à-dire qu’ils doivent produire l’oblitération de la sensibilité sympathique, la disposition à la cruauté, à la barbarie. Si les mauvais traitements exercés sur l’homme ont ces sortes de résultats et si les animaux sont effectivement ce que nous sommes, la même cause doit produire les mêmes effets. La morale publique serait dont intéressée dans ce système à prévenir ou à réprimer les mauvais traitements qu’on pourrait se permettre envers eux, comme elle est intéressée à prévenir ou à réprimer ceux qu’on se permet envers l’homme : comme celui-ci les animaux devraient être mis sous la protection des lois.
L’infériorité qu’on avoue et qu’on reconnait en eux dans ce système, ne pourrait pas être alléguée comme un motif de désintéressement pour la morale publique ; ce serait, au contraire, une raison pour elle d’y prendre un plus vif intérêt.
En effet, la morale d’un peuple qui adopterait cette hypothèse, ne devrait pas se borner à interdire tout mauvais traitement envers les animaux, il faudrait encore, pour être conséquente à sa doctrine, qu’elle en fit l’objet des soins [12] compatissants et généreux de l’homme ; qu’elle appelait sur eux le même intérêt, la même commisération, que sur les individus de notre espèce, à qui la nature a refusé le développement de leurs facultés, ou chez lesquels des accidents particuliers en ont altéré l’exercice et qui par cette raison nous sont inférieurs en intelligence.
L’homme dans ce système se trouverait le tuteur né des autres animaux : ce serait à lui à suppléer par ce que la nature lui aurait donné en plus, à ce qu’ils auraient reçu en moins ; car, quelle horrible injustice ! Quelle exécrable cruauté n’y aurait-il pas à se prévaloir de cette supériorité pour les tourmenter et pour les détruire !
Dira-t-on que tel est le système de la nature ? Mais s’il en est ainsi, quel droit avons-nous à la bienveillance des êtres que nous supposons supérieurs à nous dans la hiérarchie universelle des êtres ? Pourquoi nous regarderions-nous comme les objets privilèges de leur bonté tutélaire ? L’effet de leur supériorité sur nous pourrait-il différer de celui de la nôtre sur les animaux ? Au lieu de nous les supposer indulgents et propices ne faudrait-il pas nous considérer comme dévoués à tous les caprices de leur barbarie ?
Si les animaux sont ce que nous sommes ; s’il n’y a d’eux à nous d’autre différence que du plus ou moins ; s’il est encore vrai que cette différence nous autorise à les traiter comme nous les traitons, pourquoi n’en serait-il pas de même dans notre espèce ? N’y a-t-il pas aussi de plus et de moins parmi les hommes ? Les uns ne sont-ils pas supérieurs aux autres en force, en intelligence, en raisonnement, en développement de [13] toutes les facultés qui nous constituent ? Il s’ensuivrait donc qu’au lieu d’être tenus d’employer cette supériorité à l’avantage des autres, ils seraient autorisés à s’en prévaloir à leur préjudice, qu’ils pourraient légitiment profiter de leur ignorance pour les tromper, de leur sottise pour les asservir, de leur faiblesse pour les opprimer ? C’est ce qui n’arrive que trop souvent, mais si tel était le système de la nature, pourquoi ce spectacle nous révolterait-il ? Pourquoi le regardons-nous comme une dissonance dans l’ordre universel, puisqu’il serait parfaitement conforme aux lois de cet ordre ?
Voila les difficultés dans lesquelles on se trouve entrainés. Lorsqu’admettant une parfaite identité de nature entre les animaux et nous, on croit pouvoir justifier par notre supériorité, la manière dont nous les traitons. Il faut dans cette hypothèse qu’un plus grand développement de facultés légitime la fraude, l’oppression et la barbarie qu’il donna à celui qui en est donné le droit de disposer arbitrairement de ceux qui ne le sont pas ; au bien, il faut reconnaitre que les animaux ont des droits particuliers à la bienveillance de l’homme, qu’il leur doit, en quelque sort, le tribut de sa supériorité ; que, par conséquent, au lieu de la maltraiter, comme il le fait, au lieu de la réduire en servitude, de leur ôter la vie pour se nourrir de leur chair ou pour se parer de leurs dépouilles, il doit au contraire, respecter leur indépendance, favoriser leur multiplication quelque incommodité qu’il puisse en recevoir, car les animaux étant ce que nous sommes n’y ayant entre eux et nous d’autre différence que du plus ou moins. Maltraiter l’animal, c’est maltraiter l’homme.
[14] Cette alternative, également répugnante à la raison, est peut-être une des plus fortes objections contre cette hypothèse ; car notre conscience morale étant révoltée de la tyrannie que le fort exerce sur le faible, le supérieur sur l’inferieur et d’un autre côté les ménagements pour les animaux entrainent des conséquences tout aussi choquantes ; il est clair qu’on ne peut pas admettre cette contradiction dans le système de la nature, et que par conséquent l’hypothèse qui l’y introduit en donne nécessairement une fausse interprétation.
Mais la même difficulté ne se retrouve-t-elle pas dans celle qui, refusant aux animaux l’intelligence, leur accorde néanmoins la sensibilité ; car, s’ils peuvent sentir, ils peuvent souffrir et s’ils peuvent souffrir, ne faut-il pas pour exercer sur eux de mauvais traitements, surmonter cet instinct sympathique de la souffrance dont la morale publique est intéressée à prévenir l’altération ?
Nous répondrons qu’il est impossible de déterminer les attributs de la sensibilité séparée de l’intelligence, car nous sentons et connaissons en même temps et nous ne pouvons pas dire ce qui l’intelligence ajoute aux différentes modifications de la sensibilité. L’enfant au berceau donne des marques de douleur ; il est cependant présumable qu’il ne souffre pas, ou que, malgré ses vagissements, il souffre bien moins que l’homme qui a le sentiment et la conscience de ses maux : peut-être la douleur n’est-elle que dans la pensée, et peut-être n’y a-t-il de réellement souffrant que l’être qui pense : on sait qu’une forte distraction suspend les douleurs les plus vives ou empêche de les sentir : un soldat dans le mêlée ne s’aperçoit pas [15] de ses blessures ; il n’en éprouve pas la douleur, parce que le soin de sa défense absorbe toute sa pensée, et la sépare pour ainsi dire de sa sensibilité ; ce n’est que lorsqu’elle est rendue a celle-ci que commence la souffrance : il en est de même des enthousiastes et des fanatiques, chez lesquels un délire extatique produit cette espèce d’isolement de la pensée.
Il est donc très possible que la douleur proprement dite ne résulte que de la combinaison de l’intelligence avec la sensibilité, ou de l’attention que la première donne aux impressions que l’être reçoit et qu’il faille leurs concours mutuel pour en déterminer le phénomène. S’il en était ainsi les animaux n’ayant que la sensibilité dans leur économie, se trouveraient par cela même privés d’un des éléments de la souffrance, de manière qu’ils ne l’éprouveront point, ou s’ils étaient encore susceptibles de l’éprouver par la sensibilité seule, ce ne serait que dans la proportion adoptée à cette faculté et dans un mode indépendant de l’extension que lui donne en nous le partage de l’intelligence.
Peut-être est-ce le concours de celle-ci qui légitime l’application de la pitié, application déplacée et sans motif. Si l’impression affectait la sensibilité sans que l’intelligence en prit connaissance et en souffrit elle-même peut être, pour avoir des droits à la commisération, faute que la douleur prenne un caractère morale et qu’elle ne soit pas purement physique, d’où il suivrait que la nature des animaux ne pouvant jamais lui donner ce caractère, elle n’aurait chez eux aucun droit à notre pitié. Si elle l’obtenait de nous, ce ne serait que par une sorte de surprise et sans que nous fussions autorisés à la lui accorder.
[16] Quelque singulier que puisse paraitre cette opinion, nous pouvons tirer du mode même dans le quel s’exerce notre pitié envers l’homme des inductions qui la justifient. En effet les plus violentes douleurs physiques dans l’homme ne sont pas celles qui déterminent l’affection la plus sympathique ; il faut, par ainsi dire, qu’elles s’adjoignent des considérations morales pour produire le phénomène de la compassion.
Jamais un poète dramatique s’est-il avisé de mettre sur la scène une femme en travail d’enfant, un homme tourmenté d’un violent excès de goute, ou se roulant dans les convulsions d’une colique nephretique ? Ce sont pourtant des circonstances où la sensibilité physique est très douloureusement affectée et si nous sympathisions avec ces sortes de douleurs, si elles déterminent la compassion proprement dite pourquoi le poète ne placerait-il pas des personnages dans des pareilles situations ? Pourquoi se trouveraient-elles exclues de l’art par excellence d’émouvoir les affections sympathiques ?
C’est que la douleur purement physique n’a pas par elle-même le privilège de la sympathie: elle est pour ainsi dire bornée au lieu qu’elle occupe ; à l’individu qu’elle tourmente: quoique intérêt qu’on y prend on n’y participe point comme on participe à la douleur morale, on la voit, en quelque sorte, mais on ne la sent pas. Elle ne fait pas, si je puis m’exprimer ainsi, écho dans les âmes aussi remarqués que dans les témoignages d’intérêt qu’on donne à ceux qui l’éprouvent, on ne leur dit pas qu’on la partage, qu’on se met à leur place, qu’on souffre ce qu’ils souffrent, parce qu’on ne peut pas, en effet, s’associer à ce genre de souffrance ; la pitié qu’elle [17] inspire ne résulte pas de ce qu’on sent en soi-même quelque chose qui lui ressemble.
Il est donc bien évident que les douleurs physiques ne développent point hors de leur sphère d’activité, cette espèce de contagion sympathique que déterminent les souffrances morales. Voilà pourquoi l’art dramatique ne fait entrer que celles-ci dans ses compositions et dédaigne ou néglige les autres.
Remarquez encore avec quelle indifférence on entend dans la Société le récit de ces maladies qui ne sont pas ce qu’on appelle dangereuses, mais qu’on sait cependant être de nature à faire cruellement souffrir: il faut qu’elles puissent entraîner la perte de la vie pour qu’on en soit réellement touché parce que alors elles effectuent tous les intérêts moraux ; mais tant que ceux-ci ne sont pas compromis, la pitié, si toute fois elle a lieu, se retient dans les bornes les plus étroites et voilà pourquoi l’insensibilité pour le mal des dents est passée en proverbe quoique ce soit peut-être la plus intolérable de toutes les douleurs physiques[1]. Il est donc à peu près certain que si l’homme en était réduit à la sensibilité physique, il perdrait absolument la faculté de compatir : il ne s’intéresserait plus aux maux des autres et les autres ne s’intéresseraient plus aux siens. Il n’y aurait plus dans nos rapports mutuels cet échange et pour ainsi dire cette solidarité de peine et de plaisir, qui nous unissent par une chaine invisible, nous crée, en quelque sorte, une vie commune parce qu’elle nous initie dans celle des autres et initie les autres dans celle dont nous vivons nous-mêmes.
[18] Ce partage de vie, cette communauté sympathique d’existence dont la nature de l’homme renferme les éléments et qui se manifestent dans ses rapports avec ses semblables, vous ne les retrouverez point dans ceux que les animaux ont entr’eux. Ici toutes les existences sont isolées et circonscrites, pour ainsi dire, dans leur individualité, elles n’offrent jamais le phénomène de la compassion. S’apercevait-on, en effet, qu’ils prennent les uns aux autres, cet intérêt que nous prenons à nos semblables ? Leur en voit-on donner quelque signe ? S’apitoyaient-ils sur les souffrances des autres ? Cherchent-ils à les soulager ? Qu’un cheval ou qu’un bœuf soient malades dans une écurie, leurs plus proches voisins paraitraient-ils touchés de leur situation ? Leur en donneront-ils quelque témoignage ? Ne continueront-ils pas de vider la crèche ou la râtelier sans s’inquiéter de la position de leur camarade ?
Cependant, à moins d’admettre l’hypothèse de Descartes, la faculté de compatir devrait se trouver en eux comme en nous. Si elle dérivait de la sensibilité physique et si les maux qui effectuent cette sensibilité en déterminent l’exercice puisqu’il n’y a rien de tout cela dans les animaux, nous ne pouvons pas dans l’homme faire honneur à la sensibilité physique de la faculté de compatir, ou de partager sympathiquement les maux des autres. Il faut nécessairement le rapporter à quelque autre principe à quelque chose de particulier à la nature humaine.
[19] Si les souffrances que nous supposons dans les animaux étaient un objet propre et naturel de pitié ; si elles méritaient que nous leur fissions l’application de cette commisération que nous ne refusons que trop souvent à nos semblables, pourquoi la nature ne leur en aurait elle pas accordé l’instinct généraux ? Pourquoi les animaux seraient-ils insensibles aux maux les uns des autres ? Si ces maux étaient, en effet, dignes de cet intérêt dont une exagération sentimentale voudrait les gratifier, n’est-ce pas dans les animaux même que nous devions en trouver le principe et l’application ? Le but de la nature, en l’instituant n’eut-il pas été qu’ils en reçussent les témoignages, et pouvons nous leur en donner d’aussi fréquents que ceux qu’ils pourraient. S’en donner eux-mêmes ? Sommes-nous placés de manière à remplir les vues de la nature, à cet égard si telles avaient été ses vues ?
Nous sommes donc fondés à croire qu’il n’est pas dans ses intentions que la pitié se porte sur les animaux ; qu’elle s’égare en prenant cette direction, et qu’il n’y a que l’homme qui puisse légitimement en réclamer l’exercice. Cette conclusion se déduit de l’hypothèse qui accorde aux animaux la sensibilité comme de celle qui n’en fait que des machines, ou des automates. Les conséquences de l’hypothèse de Buffon ne différent point à cet égard de celles qui résultent de l’opinion de Descartes.
S 5
Pour sentir la vérité de ce que nous venons de dire, nous n’avons qu’à examiner combien les souffrances doivent [20] différer, dans les mêmes circonstances, selon qu’elles sont ou ne sont pas accompagnées d’intelligence. Et nous verrons que la plupart de celles que nous supposons dans les animaux sont illusoires.
Prenons pour exemple le bœuf dont nous venons de parler : on ôte d’abord à cet animal la faculté de se reproduire, mais il ignore absolument cette mutilation. Jamais elle n’excite ses regrets ; jamais rien ne lui rappelle douloureusement son impuissance : il n’y a donc ni barbarie, ni cruauté dans la castration de cet animal et il en est de même de tous ceux qu’on soumet à cette opération.
On impose ensuite le joug à ce même bœuf ; on lui fait traîner le charre, mais on ne voit pas que cette condition excite ses plaintes, ses murmures, qu’il en soit humilié, souffrant et comment en souffrirait-il ? Ce que nous appelons condition, état de la vie, n’existe pas pour lui ; car cette notion résulte de la comparaison de diverses situations et pour les comparer il faut les connaître ; or, cette connaissance il ne l’a point : il ne sait pas, comme nous, ce qu’il est, ni ce qu’il pourrait être : il est donc indifférent à toutes les situations et dehors la dureté que nous supposons dans celle où nous le voyons est absolument imaginaire.
Nous pouvons en dire autant de l’ingratitude que nous trouvons à le vendre après des longs services, car il n’a mis aucune intention à ses travaux ; il a trouvé des sillons comme un arbre porte des fruits et il n’y a pas plus d’ingratitude à vendre le bœuf qui ne peut plus labourer, qu’à couper [21] l’arbre qui cesse de produire.
Passe pour le vendre, dira-t-on, mais le tuer ! Vous auriez raison, s’il y avait autre chose en lui que la sensibilité physique, s’il pouvait s’élever à la notion intellectuelle de la mort et de la vie ; mais tout cela n’existe pas pour lui : il n’y a dans son trépas qu’une sensation physique, sans conscience de ce qui la précède ni de ce qui la suit. Est-ce là de quoi motiver un intérêt quelconque ?
Supposons maintenant que l’homme soit l’objet des traitements que nous venons d’analyser dans leur application à la brute, et nous verrons l’extrême différence que produira cette transposition dans la nature de ces traitements.
Qu’on dépouille un homme de sa virilité dans le temps même où il ne peut pas être sensible à cette perte, c’est-à-dire au berceau ; il n’en sera pas de lui comme de l’animal, qui n’ayant jamais la connaissance de cette mutilation n’en éprouve aucun dommage : l’homme aura la conscience et ce pénible sentiment de son impuissance ; il se trouvera dégradé à ses propres yeux et à ceux des autres. Cette idée empoissonnera son existence, vous aurez donc fait, en le mutilant, un acte de la plus insigne barbarie, de l’atrocité la plus révoltante.
Soumettez ensuite cet homme à l’esclavage comme vous y soumettez l’animal, le premier pouvant se former l’idée d’une condition libre, et la comparer à celle à laquelle vous le réduisez, souffrira de celle-ci ; la contrainte seule pourra l’y retenir et il aspirera toujours à s’en délivrer, ou à briser ses fers, tandis que l’autre y sera totalement indifférent.
[22] Que vous vendiez votre cheval, votre bœuf ou votre âne, ils ne se doutent pas qu’ils sont l’objet de ce trafic ; le marché se conclut en leur présence et ils n’en sont pas plus instruits que nous ne le sommes de ce qui se passe dans d’autres planètes. L’homme, au contraire, sait qu’il est la chose vendue et que cette transaction est une violation du droit qu’il a reçu de la nature de disposer de lui-même, d’ordonner sa vie selon les circonstances et d’avoir une volonté propre et indépendante.
Dans la mort violente de l’animal, il n’y a comme nous venons de l’observer, qu’une sensation physique et rien de plus, car les notions intellectuelles de vie et de mort lui sont étrangers : vous ne pouvez donc pas affecter en lui des idées qu’il n’a point. On ne peut pas dire qu’il perd quelque chose en perdant la vie puisqu’il est incapable d’y mettre un prix ou de savoir ce qu’elle est ; il ignore également l’état qu’il quitte et celui où il va passer ; il lui est donc indifférent d’exister ou de cesser d’être, et dehors il est également indifférent d’accélérer ou de retarder l’époque de sa destruction.
L’homme, au contraire, sait qu’il existe et qu’il doit cesser d’exister. Son intelligence embrasse les différentes époques de la vie et sa volonté en détermine l’emploi. La nature en lui donnant ce pouvoir lui a évidement donné la propriété de sa vie, car on ne dispose pas de ce qui n’est pas à soi l’animal dans sa jeunesse ne se fait pas un plan de conduite pour les âges postérieurs ; il ne se dit point, comme l’homme : je ferai telle chose, je prendrai tel état.
[23] Et pourquoi ne se dit-il pas tout cela ? Parce qu’il n’a pas la disposition de sa vie, parce qu’elle n’est pas sa propriété ; il ne peut donc pas la voir, en quelque sorte, se dérouler devant lui, ni par conséquent, se créer un avenir : c’est un avantage réservé à l’homme et qui implique en lui, non seulement l’usufruit, mais encore, s’il est permis de le dire, la nue propriété de la vie.
Vous attentez donc à cette propriété sacrée lorsque vous attentez à la vie de l’homme, ou à sa liberté, car, dans le premier cas, vous l’en dépouillez et dans l’autre vous lui en ôtez la disposition : c’est toujours attenter à sa propriété, c’est l’usurper ou la détruire ; mais dans les mêmes procédés envers les animaux il n’y a ni soustraction, ni usurpation de propriété ; car, en disposant de leur vie pour notre avantage, ou en la leur ôtant, nous ne leur ôtons rien qui soit proprement à eux.
On voit donc que ce qui est mauvais traitement pour l’homme ne l’est pas pour les animaux, et qu’attacher aux actes qui le constituent relativement à l’homme, les mêmes idées, ou des idées analogues, quand il s’agit des animaux, c’est avoir les plus fausses notions des choses ; c’est confondre ce qui doit être soigneusement distingué ; c’est s’en rapporter aux sens, à leur première impression, sans permettre à la raison de chercher les différences qui peuvent s’introduire dans les mêmes sensations par la différence des objets.
On voit encore que cette différence tient aux modifications du principe intelligent qui, dans l’homme, rend [24] ces mauvaises traitements injustes, odieux, atroces, barbares et que celui-ci ne doit pas, comme on le croit vulgairement, à sa faculté de sentir, ses droits à la pitié, mais à sa connaissance, ou à sa faculté de connaître ; ce n’est pas sa sensibilité physique qui motive les égards et les ménagements dont il est l’objet, c’est sa dignité morale : c’est celle-ci qui commande le respect pour l’homme. C’est de cette source sacrée que dérive le sentiment que nous nommons humanité, dans lequel n’entre pas seulement le désir de secourir, de soulager, d’arracher aux souffrances ceux qui l’inspirent ; mais de les soustraire à l’objection d’empêcher leur avilissement, de contribuer à leur perfectionnement moral, à l’anoblissement de leur être.
En effet se croirait-on quitte envers l’humanité en s’occupant seulement du bien-être physique de l’homme ? Ne serait-ce pas, au contraire, méconnaître ce sentiment généreux, et l’offenser dans ses plus chers intérêts, que de procurer ce bien-être, comme il est possible de le faire, au prix de la dégradation morale ?
Si l’intérêt d’humanité que nous prenons aux autres, se rapporterait à leur sensibilité physique, et n’avait d’autre but que le management de cette sensibilité ; il devrait nous être parfaitement indifférent qu’ils prissent tel ou tel moyen pour en satisfaire les besoins ; pourvu que ces besoins fussent satisfaits notre intérêt, pour eux le serait aussi : pourquoi [25] donc voulons-nous qu’ils s’abstiennent de poursuivre ce résultat par la vue, par le crime et, en niant, par tous les actes qui blessent leur dignité ?
Cette réserve dans la poursuite des biens et dans la fuite des maux n’est-elle pas le vœu général de l’humanité ? Le ménagement de la sensibilité n’est donc ce qu’elle a principalement en vue puisqu’elle le subordonne à la considération plus élevée de la dignité morale.
Les animaux, ne participant point à cette dignité, ne peuvent pas prétendre aux égards, aux ménagements et au respect qu’elle motive pour l’homme : il n’est donc pas dans l’ordre naturel des choses que le sentiment de l’humanité s’étende sur eux. La sensibilité physique dont on les suppose pourvus et qu’il est difficile de ne pas leur accorder n’en peut pas seule légitimer l’application, puisque l’homme même cesserait d’en être l’objet s’il n’était qu’un être sensitif : nous pouvons en conclure qu’étendre le sentiment de l’humanité aux animaux c’est, comme nous l’avons déjà dit, lui donner une fausse direction ; c’est profaner, en quelque sorte, ce sentiment, en le prostituant à des êtres que la nature n’a pas formés pour participer à cette noble attribution de son plus bel ouvrage.
[26] S 6
Nous pourrions sans doute borner ici la discussion, nous en tenir à ce que nous avons déjà dit et regarder notre tâche comme terminée ; mais oublions tous ces raisonnements, toutes ces analyses ; ne nous prévalons d’aucune des inductions qu’ils fournissent pour résoudre négativement la question proposée, cherchons en uniquement la solution dans les faits et dans l’expérience.
De quoi s’agit-il ? De déterminer si les mauvais traitements exercés sur les animaux intéressent la morale publique. Nous avons fait voir qu’ils ne pourraient l’intéresser qu’autant qu’il en résulterait pour nous quelque diminution ou quelque altération de la sensibilité morale ; or, il est facile de prouver que la supposition de cette altération, par ces mauvais traitements, est une supposition gratuite, un préjugé vulgaire.
Un homme ne devient pas tout à coup atroce et barbare envers ses semblables c’est par des actes successifs de dureté, d’inhumanité, d’injustice, qu’il acquiert l’affreux pouvoir d’être à volonté cruel, inhumain et féroce. On peut donc regarder comme l’effet naturel des mauvais traitements envers l’homme, la diminution ou l’altération de cette affection sympathique qui nous intéresse a ses maux et nous les fait partager ; mais peut-on tirer la même conséquence des prétendus mauvais traitements exercés sur les animaux ?
[27] Si ceux-ci avaient les mêmes résultats que les autres, si la différence, entre les objets de ces mauvais traitements ne mettait pas une différence absolue dans leur conséquences morales ; s’il y avait entr’eux quelque rapport, ou quelque analogie, les chasseurs, les bouchers et tous ceux qui par état maltraitent ou détruisent les bêtes, finiraient par se dépouiller de tout sentiment de bienveillance et d’humanité envers leurs semblables. L’habitude de ces mauvais traitements les dénaturait au point qu’ils se feraient un jeu de tourmenter et d’assassiner les hommes. C’est cependant ce qui n’arrive point. Tout le monde peut avoir connu des chasseurs et des bouchers aussi humains, aussi compatissants, et quelques fois plus que ceux qui les accusent de ne pas l’être. S’ils ont, en général, moins d’aménité dans les formes, moins de politesse dans les manières, c’est que leur genre de vie, les tenant éloignés de la société, les voue à une sorte de rusticité qui ne prouve rien contre la moralité de leur caractère, car on peut être très humain avec cette espèce de costume et très dur, très cruel avec des formes très polies.
On ne cesse cependant de répéter que les bouchers sont moins humains, moins sensibles que les autres hommes, mais où sont les faits à l’appui de cette assertion ? A-t-on compulsé les greffes criminels pour savoir si cette classe offre plus d’assassins, plus de malfaiteurs que les autres ? Si cette inculpation n’était pas uniquement l’effet du préjugé, si l’expérience l’autorisait et la justifiait, pourquoi souffrirait-on dans la société un état dont la dégradation morale de l’homme serait la conséquence ?
[28] Remarquez que le chasseur ne partage pas le reproche qu’on fait au boucher, ce qui serait une véritable inconséquence s’il y avait quelque fondement à ce reproche ; mais, comme il est gratuit, on a pu en excepter les premiers sans se compromettre ; ceux-ci ne tuant ordinairement les animaux que pour leur plaisir, la chasse étant le divertissement des riches oisifs, des rois, des princes, des grands seigneurs, on a cru devoir à leur rang de ne pas les inculper comme les autres et l’on s’en est tenu a calomnier un état nécessaire et des citoyens utiles !
Voilà comment les préjugés sont justes et conséquents. On ne fait pas attention que si les bouchers méritaient l’imputation dont on les gratifie nous le méritions aussi, nous qui sommes leurs complices en nous repaissant de la chair des animaux qu’ils ont tués, en l’étalant sur des tables où se rassemblent de nombreux convives, en nous excitant mutuellement à la manger. L’habitude et la fréquente répétition de ce spectacle et de cette nourriture ne nous rendrait-elle pas cruelles et féroces envers nos semblables, si de la prétendue cruauté envers les animaux on pouvait conclure la cruauté envers les hommes ?
Mais tout le monde peut se convaincre par sa propre expérience qu’il n’y a rien de réel dans cette supposition. Jamais en me levant d’une table ou par ma voracité je m’étais rendu le complice du meurtre de plusieurs animaux. Je ne me suis senti moins bienveillant envers mes semblables, moins disposé à les servir, moins enclin à la pitié, à la commisération, a tous les sentiments d’humanité, et quoiqu’en puissent dire, les secteurs [29] du régime pythagoricien, j’imagine qu’il n’en est qu’autrement de tous ceux qui, comme moi, sont de fait et de volonté carnivores.
Il est donc bien certain que nos sentiments moraux ne sont ni détruits ni altérés par l’habitude où nous sommes de nous nourrir de la chair des animaux, et cette habitude nous associant, pour ainsi dire, à ceux qui les tuent, nous sommes forcés d’admettre la même non-altération dans ceux-ci, car il y a solidarité entr’eux et nous : la dégradation de leurs sentiments entraînerait nécessairement celle des nôtres. Puisque cet effet n’a pas lieu pour nous, il ne peut pas l’avoir pour eux ; il est donc faux et chimérique.
S 7
Si l’action de maltraiter ou de tuer les animaux, car les tuer c’est sans doute les maltraiter, supposait de l’inhumanité ou de la barbarie dans ceux qui l’exécutent, il faudrait en conclure que ceux qui affectionnent tendrement les bêtes sont les êtres les plus humains et les plus sensibles : comment se peut-il donc que Caligula qui poussait la bienveillance pour son cheval jusqu’à le faire manger à sa table et à le faire boire dans des coupes d’or, fut cependant un monstre de cruauté ? Etait-il bien humain encore cet Auguste qui fait périr un gouverneur d’Egypte pour avoir mangé une caille ? Ne pourrait-on pas en dire autant d’Alexandre, grand ami des bêtes, puisqu’il fit bâtir une ville à l’honneur d’un chien qu’il avait perdu dans l’Inde, et une autre à la mémoire de son cheval Bucéphale, que, par cette [30] raison il appela Bucéphale ? Etaient-ils bien humains ces Espagnols qui, dans le Nouveau Monde, donnaient une haute paye et des brevets aux chiens qui s’étaient le plus signalés à poursuivre et à dévorer les infortunés américains ?
J’en demande bien pardon à ces dames qui croient donner une grande preuve de leur sensibilité, en se passionnant pour des chiens, des chats ou des serins, mais ces exemples et une foule d’autres qu’on pourrait y ajouter ne permettent pas de souscrire à cette prétention ; il serait bien plus naturel d’en tirer la conséquence opposée et il n’est personne qui n’ait été à portée d’observer combien il y avait ordinairement à se méfier de cette exagération sentimentale.
Si la bienveillance pour les bêtes ne prouve pas qu’on soit humain et bienveillant envers les hommes, s’il est au contraire très ordinaire de trouver cette disposition unie à la dureté de cœur, à l’inhumanité, à l’insensibilité pour les maux de nos semblables, pourquoi voudrait-on que l’absence de cette intérêt de bienveillance pour les animaux fut la preuve d’un défaut de bienveillance ou d’humanité pour les hommes ?
Si le sentiment de l’humanité n’était pas indépendant des bons ou des mauvais traitements que l’homme peut exercer sur les animaux ; s’il y avait quelque rapport entre la manière de traiter ceux-ci et les égards qu’on doit à l’autre ; si ce qu’on appelle cruauté envers les [31] animaux rendait, comme on le suppose, ceux qui l’exercent cruels et féroces envers leurs semblables, je voudrai bien qu’on m’apprit comment l’espèce humaine aurait pu sortir de l’état de la barbarie pour passer à un état de civilisation quelconque, car il est de fait que tous les peuples ont été d’abord chasseurs ; or, ce genre de vie loin de permettre quelque amélioration dans leurs mœurs, devait, dans la supposition que nous examinons, les rendre de plus en plus atroces, et les confirmer, pour ainsi dire, dans leur férocité. Comment donc l’humanité aurait-elle pu se faire joue dans leur âme ? Comment serait-ils devenus humains sociables, compatissants, dans un état qui n’aurait tendu qu’à les modifier dans le sens opposé, c’est-à-dire qu’a les rendre féroces, inhumaines, impitoyables ?
Dans le plus haut degré de civilisation même ne verrait-on pas s’éteindre tout sentiment d’humanité, si le spectacle des mauvais traitements exercés sur les animaux pouvaient l’altérer ou le détruire ? Pour un chien qui dort sur des coussins et qui reçoit continuellement les caresses de sa belle amie, combien n’en est-il pas qu’on néglige, qu’on assomme de coups ou qu’on tient l’enfermés dans l’étroite prison dont ils rongent les borreaux ?
Est-on plus indulgent envers le cheval qu’on condamne à porter ou à trainer de lourds fardeaux ? Est-ce le traiter bien humainement que de lui mettre un frein dans la bouche, un harnais sur le dos, et de le piquer ensuit de l’éperon, ou de le déchirer à coups de fouet ?
[32] Si de cette conduite de l’homme envers les animaux on pouvait tirer quelque induction pour celle de l’homme envers l’homme, s’il y avait quelque rapport, quelque analogie, quelque affinité de l’une à l’autre et si ce n’étaient pas deux choses totalement dissemblables, on serait [sic] la possibilité de maintenir quelque trace de bienveillance et d’humanité dans les sociétés les plus civilisés ? Comment introduire quelque générosité dans les mœurs, quelque libéralité dans les idées, sous l’influence toujours active d’un principe constant de barbarie et d’inhumanité ?
La position des peuples civilisés serait, à cet égard, bien moins favorable que celle des peuples sauvages, car ceux-ci se bornent à tuer les animaux ; ils n’ont pas comme nous, l’art de les réduire en servitude, or, dans la série des mauvaises traitements envers l’homme, l’esclavage et certainement le pire de tous, parce qu’il est le plus corrupteur, c’est-à-dire, celui qui altère le plus dans notre âme les sentiments de justice et d’humanité : il s’ensuit que si l’on pouvait conclure de l’animal à l’homme, il y a longtemps qu’au lieu de nous pâlir et de nous humaniser, nous serions arrivés ou dernier terme de dépravation et de barbarie.
Les Espagnols, auxquels on ne cesse de reprocher leurs combats de taureaux, sont-ils plus inhumains ou plus barbares que les autres nations de l’Europe chez lesquelles n’existe point ce bizarre costume ? S’aperçoit-on que l’attrait pour ce genre de spectacle ait donné à ce peuple un caractère dur et féroce ? Il n’a donc pour [33] l’effet qu’on lui suppose, car, s’il était de sa nature de porter à l’inhumanité, ou à la barbarie de l’Espagne ne compterait [sic] plus parmi les nations civilisées ; ce serait un peuple cannibale, anthropophage, avec lequel il aurait fallu interrompre toute relation de voisinage et d’amitié. Cependant les voyageurs, eux-mêmes qu’ils approuvent le spectacle de ces sortes de combats qu’ils appellent horribles, conviennent que les Espagnols sont généreux, humains, compatissants envers les malheureux ; qu’ils ne le cèdent en rien pour les affections domestiques aux peuples qui n’ont pas de combats de taureaux et chez lesquels on déclame contre cette espèce de divertissement.
Si les animaux n’ont aucun droit dont les prétendus mauvais traitements exercés sur eux soient la violation ; si l’idée qu’on attache à ces mauvais traitements, en les assimilant à ceux dont l’homme est l’objet est une idée fausse et s’il est démontré par l’expérience que de l’habitude, ni du spectacle de ces pretendus mauvais traitements, on ne peut induire aucune disposition à maltraiter l’homme ; aucun penchant à la cruauté envers ses semblables ; aucune dépravation de l’instinct sympathique des souffrances humaines, en un mot, aucune altération du sentiment de l’humanité, pourquoi voudrait-on que ces prétendus mauvais traitements intéressent la morale publique ? Sur quoi baserait-on l’intérêt qu’on voudrait qu’elle y prit ? Quelle raison pourrait-on donner de son intervention dans une phase qui, renfermée par la nature dans l’ordre physique, est dans son principe et dans ses conséquences absolument dénué [34] de toute influence morale ? Mais tâchons de prouver combien s’égarent ceux qui sollicitant la pitié pour les animaux, croient, par cela même, nous rendre plus humains et plus compatissants envers les hommes ?
S 8
En appelant l’intérêt sur les animaux, en voulant que la pitié s’étende sur eux, on ne change point la nature des choses ; on ne fait pas que ne pouvant point traiter de gré à gré avec ces êtres, il ne faille les tourmenter et les réduire en servitude pour en obtenir les services que nous en obtenons ; on ne fait pas non plus qu’il ne faille d’en engorger pour s’approprier leur dépouilles et pour se nourrir de leur chair : or, nous familiariser avec cette inconséquence, nous habituer à croire que les animaux méritent la pitié, la commisération et cependant à voire ensuite qu’on les traite comme nous les traitons n’est-ce pas nous suggérer, pour ainsi dire, la même inconséquence envers nos semblables ? N’est-ce pas nous habituer à conclure de l’animal à l’humain ? À croire aussi qu’il a des droits à la pitié, aux égards, aux ménagements et cependant à le traiter ensuite d’une manière tout à fait contraire à cette opinion ?
Ce n’est donc pas en appelant l’intérêt sur les animaux qu’on peut espérer de renforcer et de consolider l’intérêt pour l’homme. S’il est un moyen d’assurer l’inviolabilité de celui-ci c’est, nous osons le dire, de le rendre exclusif ; c’est d’admettre que l’homme et les animaux différent par leur nature respective ; que l’une motive les égards, les ménagements, le respect et l’autre la disposition arbitraire des individus qu’elle constitue.
A quelque degré que l’homme puisse s’avilir par le vice, par le crime, par tous les excès qui peuvent les déshonorer, nous lui devons encore dans cette situation des égards que nous ne devons pas aux autre êtres ; nous ne pouvons pas en disposer arbitrairement, ni le [35] soumettre à d’autres traitements que ceux que la loi a déterminé ; il conserva donc même dans son plus grand avilissement des droits au respect et à quoi pouvons nous rapporter ce respect pour l’homme qui survit à toutes les dégradations, à toutes les scélératesses, à toutes les turpitudes, si nous ne le rapportons pas à l’excellence et à la dignité de sa nature ?
Il y a donc dans la nature humaine une excellence et une dignité dont les autres natures sont dépourvues. L’homme est un être considérable aux yeux de l’homme : c’est par là qu’il l’intéresse, qu’il lui inspire des sentiments de bienveillance et d’affection car comme l’a très bien observé Rousseau : « on peut juger du prix que chacun met au bonheur de ses semblables par le cas qu’il parait faire d’eux, il est naturel qu’on fasse bon marché du bonheur des gens qu’on méprise ».
Mais les animaux ne font aucun cas les uns des autres ; ils ne se donnent aucun prix ; ils ne sont donc pas susceptibles de s’intéresser réciproquement, de compatir aux maux de leurs semblables, de se dévouer généreusement pour eux aussi ne le font ils pas. Or, que devons-nous conclure de cette absence d’appréciation et de considération respective qui rend les animaux indifférents au sort les uns des autres ? C’est qu’il n’y a rien dans leur nature qui mérite d’être apprécié, rien de considérable, que par conséquent c’est une nature sans dignité et que c’est là ce qui nous dispense de toute l’espèce de ménagement envers eux.
Admettre les animaux au partage des affections, des ménagements et des égards qu’on doit à l’homme c’est avilir implicitement celui-ci : ce n’est pas élever les animaux à la condition de l’homme, c’est faire descendre l’homme à la condition des animaux : en cherchant à faire traiter les bêtes comme l’homme, on tend, sans s’en douter, à faire traiter l’homme comme les bêtes.
Ajoutons que toutes nos affections sont circonscrites par leur nature et qu’elles n’ont toutes un objet déterminé ; en les étendant [36] à d’autres nous n’augmentons pas leur capacité, ni leur énergie. Nous les affaiblissons, au contraire, et pour avoir voulu leur faire embrasser des objets qui n’entraient point naturellement dans leur sphère d’activité, nous les rendons moins énergiques pour ceux qui leur sont immédiatement appropriés : ainsi des enfants sont l’objet naturel de l’affection d’un père ; mais celui qui voudrait étendre l’amour paternel aux enfants des autres et qui croirait augmenter cette affection pour les siens en la généralisant, finirait par la neutraliser.
Il en est de même de l’amour de la patrie : c’est l’attachement particulier pour le peuple ou pour la nation dont on fait partie : il est circonscrit par sa nature à ce peuple, à cette nation ; lui faire embrasser les autres c’est le détruire.
Nous pouvons en dire autant de l’humanité : l’homme dans les vues de la nature est l’objet exclusif de ce sentiment ; c’est donc l’exagérer que de l’étendre aux animaux et cette exagération loin de tourner au profit de l’homme, loin d’augmenter pour lui le développement et l’intensité de cette affection doit produire en elle ce relâchement qu’apercevant toutes les affections à mesure qu’elles se partagent et se subdivisent en embrassant une plus grande quantité d’objet.
Si la raison n’éclairait pas sur les dangers de cette aberration sentimentale, comme il n’y a point de bornes à l’exagération, on ne s’en tiendrait pas à réclamer la pitié pour les animaux : bientôt on voudrait qu’elle s’étendit à d’autres êtres auxquels on trouverait de la sensibilité et même de l’intelligence. Nous en voudrions au point qu’il y aurait de la barbarie à fouler les végétaux.
La morale publique loin d’approuver cette dissémination et, pour ainsi dire, cette évaporation de la sensibilité morale est, au contraire, intéressée à la prévenir ; car en étendant cette sensibilité par des fausses applications aux êtres qui dans l’économie de la nature n’ont pas été destinés à en recevoir le tribut [37] on affaiblit nécessairement son principe et la morale publique intéressée à le conserver dans son intégrité est pour cela même intéressée à sa concertation : elle a donc un intérêt opposé à l’application de la pitié aux animaux, il lui importe que cette application n’ait pas lieu, et donc il est évident qu’aucun des traitements dont ils peuvent être l’objet ne peut intéresser ; que par conséquent il n’y a point de la loi à faire à cette égard.
Malgré tout ce que nous avons dit pour prouver qu’il n’y a point de barbarie dans les prétendus mauvais traitements exercés sur les animaux, cette opinion, nous le sentons, ne satisfera point un grand nombre de lecteurs, parce qu’elle attaque une de ces idoles de l’entendement dont parle Bacon, un de ces préjugés opiniâtres qui résistent à toute la force du raisonnement : peut-être nous accusera-t-on nous-mêmes de barbarie et d’insensibilité ; mais cette considération ne doit pas empêcher un ami de la vérité de s’élever contre les erreurs accréditées. Le devoir de la philosophie n’est pas d’encenser, ni de caresser les préjugés de la multitude, mais de les dévoiler et de les combattre : voilà pourquoi le vrai philosophe a besoin de lumières pour découvrir les erreurs de son siècle, de courage et de générosité pour les attaquer, de désintéressement et de vertu pour supporter les calomnies, les injustices et les persécutions que lui attire cette espèce de pugilat… Les ennemis de la philosophie ont une tâche bien plus commode et bien plus facile à remplir.
De l’homme et des animaux
felix qui potuit rerum cognoscere causas
Salaville
Maison des Dames St. Marie rue S. Jacques à Paris
Notes:
[1] On sait que ceux qui vont sur mer pour la première fois, éprouvent ordinairement des nausées, des maux de cœur, des vomissements et se trouvent dans un état de extrêmement souffrant ; eh bien, loin de compatir à leur situation, les vieux marins s’en moquent, rient de leurs angoisses parce qu’ils savent que cet état n’est pas dangereux et que tout se borne a souffrir physiquement.