[(1)] Monsieur,
Je me fais, pour vous obéir, un devoir de vous l’envoyer, tout inutile qu’il est, le Mémoire que la Classe à votre prière, a eu la bonté de me confier, il y a plus d’un an. J’ai bien largement usé de la permission que vous me donniez de la part de la transcrire à mon aise, sans me fixer aucun terme. Il ne m’a pas fallu moins que ce temps-là, pour en venir à bout : je n’ai fini que depuis quelques jours, tant le chagrin m’abat et l’ennui me subjugue : la plume, de découragement, me tombe à chaque instant des mains et cependant ce discours la même aurait suffi pour indiquer que j’avais su autrefois la tenir, tout disgracie qu’il peut être.
Au reste, s’il était encore pour moi des consolations, votre honnêteté sans doute m’en eut procuré une des plus touchantes par l’intérêt que vous voulez bien prendre à un homme de lettres, ou plutôt un Auteur, somme de bien, vous vous justifiez le digne héritier d’un nom cher à la littérature. Vous joignez au service toutes les précautions que peut inspirer la délicatesse ; il n’est pas possible, autour de politesse et d’humanité de votre Lettre, à votre procédé, aux attentions dont vous l’accompagnez, de ne pas reconnaitre la noblesse de l’âme et du savoir. Si j’étais capable d’être ou faire encore quelque chose, ce serait à vous que j’aimerais à m’adresser pour m’en fournir l’occasion. Mais l’état de mon esprit et de ma santé ne me permettent plus que d’être le reste de mes tristes jours votre reconnaissant admirateur. Agréez mes remerciements et respectueux hommages.
Delanoë, Ancien prof.
(Porrentruy, 29 juillet 1806)
[(2)] À Monsieur
Monsieur Daciez Secrétaire perpétuel de la Classe d’Histoire et Littérature ancienne.
À Paris
[(3)] Le 23 Germinal
Renvoyé à l’auteur du mémoire n. 25
pour décision Citoyen Secrétaire,
la classe du 18 prairial an 13
Je me vois dans une espèce de nécessité de venir, au milieu de vos savantes méditations, vous distraire un moment par cette Lettre dont je vous prie d’abord de me pardonner l’importunité.
Dans les premiers mois de l’an 10, j’avais lu dans le journal des débats cette question comme proposée pour sujet du prix de Morale de l’an II : Jusqu’à quel point les traitements barbares exercés contre les animaux intéressent-ils la morale publique ; et conviendrait-il de faire des lois à cet égard ?
Quoique depuis la nouvelle organisation de l’Institut, la Classe de Morale fût censée ne plus exister, cependant mon travail étant fait et croyant que ce qui avait été solennellement annoncé au Public ne serait point révoqué, j’ai remis plus d’un mois avant le terme fixé, un Mémoire à la poste ; ou plutôt, ne sachant pas au juste, après tous ces changements que je connaissais peu, à qui l’adresser, je l’avais fait insérer parmi les dépêches de la Préfecture sous l’adresse du Ministre, pour être remis à l’Institut.
Depuis cet envoi jusqu’à présent je n’ai vu dans les journaux aucune mention de ce prix indiqué pour l’an II un des Secrétaires de l’Institut, à qui j’avais écrit en vendémiaire dernier pour répéter mon ouvrage, a eu la complaisance de me répondre, que le prix sur le sujet en question serait adjugé par la classe d’histoire dans votre séance du 2 germinal ; et je n’en vois dans les journaux aucune trace : il parait qu’en effet le sujet et le prix ont été totalement oubliés et mis de côté ; auquel cas il me semble que rien ne peut s’opposer à ce que le Manuscrit soit rendu. J’ose donc me persuader que vous voudrez bien excuser la liberté que je prends de vous prier de faire chercher et mettre simplement à la poste, sous enveloppe à mon adresse, le Mémoire, de même écriture que cette lettre, ayant pour épigraphe 6 vers et demi (je crois) d’Ovide, commençant ainsi :
Quam mala consuescit, quam se parat ille cruori impius humano etc.
Précédé d’un avant propos, commençant par ces mots : trop souvent l’éloquence fut prostituée etc.
Vous ne serez pas étonné sans doute qu’un Auteur, qui a mis 6 mois à son ouvrage, quel qu’il puisse être, soit curieux d’en garder une copie : hors celle que je répète, il ne m’en reste qu’un brouillon informe et presque indéchiffrable.
S’il se retrouve et si de quelque manière que ce soit il a paru sous les yeux de la Classe d’histoire, oserai-je vous prier encore de m’apprendre quel jugement elle en a porté ? Favorable, il me voudrait un prix ; sévère il me donnerait une utile leçon ; et l’un et l’autre serait reçu avec une égale reconnaissance.
Je présume beaucoup peut-être de votre complaisance : mais en la mesurant au savoir et au mérite, je crains peu de me pomper ou de l’épuiser ; et je suis sur que la respectueuse confiance que m’inspire un vrai savant ne vous sera pas moins agréable que les justes hommages de notre admiration.
Daignez agréer, citoyen secrétaire, ceux d’un ardent amateur qui se ferait gloire d’être votre disciple.
Delanoë
Ancien Professeur
Porrentruy, 13 germ, an. 12
P.S. N’étant point de tout à mon aise, je désirerais fort que vous pussiez me renvoyer le dit manuscrit sous le contreseing du Ministre de l’intérieur.
[(4)] Au citoyen secrétaire de la Classe d’Histoire et Littérature de l’Institut
Au lieu des séances de la 3° classe
A Paris
Mémoire
Épigraphe : Quam mala consuescit, quam se para tilla errori impius humano, vituli qui guttura cultro rumpit et immotas praebet mugitibus aures ? Aut qui vagitus similes puerilibus haedum edentem jugulare potest ; aut aliter vesci cui dedit ipse cibos ? Quantum est quod desit in istis ad plenum facinus ?
Reçu le 15 messidor an XI Mis à la poste à l’adresse du Ministre de l’Intérieur le 15 prairial an XI Commissaires : Le Bureau : Garran, La Révellière-Lépeaux, Dupont (Denemours), Toulongeon, Silvestre de Sacy.
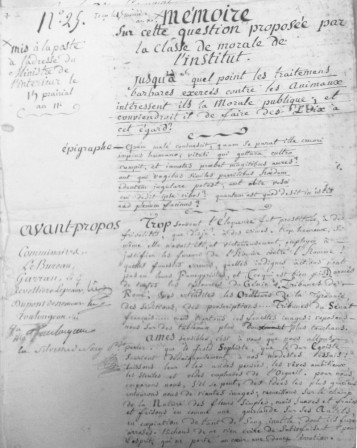
Avant-propos
Trop souvent l’éloquence fut prostituée à des frivolités, que dis-je ? À des crimes trop heureux, si même elle n’avait été, et victorieusement, employée à justifier les fureurs de l’homme contre l’homme ! Quelles funestes erreurs, quelles indignes actions n’ont pas eu leurs Panégyristes, et (ce qui est bien pis !) armés de toutes les ressources du Génie Tribunes de Rome, sous entendîtes les Orateurs de la Tyrannie, des séditions, des proscriptions… Tribune du Senat français… mais écartons ces funestes images : reposons-nous sur des tableaux plus doux et plus touchants.
Ames sensibles c’est à vous que nous allons parler, que le froid sophiste, que le dur égoïste sourient dédaigneusement à nos modestes essais : laissons-leur les arides pensées, les rêves ambitieux, les stériles et vides emphases de l’Orgueil. Pour nous, emparons nous, s’il se peut, des idées les plus gracieuses, entourons-nous de riantes images ; recueillons sur le champ de la Nature des fleurs simples, mais sauves et fraîches et faisons-en comme une guirlande sur ses autels, en expiation de tant de sang inutile, dont ils furent arrosés. Tâchons de ne rien écrire de satisfaisant pour l’esprit qui ne porte au cœur une douce émotion.
[2] Eh ! Pourquoi la partie de cet Univers la plus intéressante après le genre humain n’aurait-elle pas ses organes, ses patrons, lorsqu’elle a déjà, depuis tant de siècles, ses historiens célèbres ? Des Peuples innombrables d’Etres sensibles, utiles, aimables, en relation immédiate avec l’homme, destinés à partager avec lui la Terre, réclament son attention, sa justice, dois-je dire sa pitié ? Hélas ! Je n’ai que trop sujet de l’implorer ! Et l’obtiendront-ils ? Eux qui méritaient à tant de titres ses affections les plus tendres !
Assez, dans ces pièces académiques exercices de flatterie, jeux d’esprit indifférents au mensonge comme à la vérité, assez l’on a célébré, ou de ces héros, qui avec beaucoup de bruit et d’éclat ont fait beaucoup moins de bien peut-être, pour ne pas dire beaucoup plus de mal ; ou de ces prétendus savants dont les spéculations systématiques ou les inventions curieuses ont été bien moins utiles à la société que les découvertes, les exemples, les opérations, les méthodes fournis par les Animaux, en un mot tant de services réels qu’ils ont su rendre aux humains.
Consolez-vous, innocentes espèces, dignes d’un meilleur sort : voilà que par un acte solennel, authentique, et dans le siècle le plus éloigné de la barbarie, le plus intéressé à l’être parce qu’il en connait les suites, voilà que pour vous se déclare l’élite des plus savants hommes de la Nation la plus éclairée de l’Univers ! Un Sénat auguste de Sages, un Senat qui fournirait des soldats à plusieurs Athènes médite des lois en votre faveur, propose la réparation des torts et des outrages auxquels on vous croyait à jamais condamnés. Il veut que votre cause soit portée à son Tribunal, c’est-à-dire à celui de la raison la plus épurée et de la Philosophie la plus douce ; et ce sont les hommes qui par leur goût et leurs études doivent être les plus humains, qu’il invite à cette bonne œuvre ; c’est parmi ceux dont l’esprit doit être le plus cultivé, le sentiment le plus développé que l’on vous cherche des avocats ! Adoucir les mœurs, adoucir le sort des habitants de l’Univers, embellir et venger la Nature est-ce donc employer en vain le talent de la parole ? Ô plût à Dieu, que tant de plumes trempées sans cesse dans la fange ou le fiel ne voulussent occuper qu’à de pareils sujets leurs dangereux loisirs !
[3] Orateur des animaux, emploi touchant et pernicieux. Oh ! Que je suis loin de le dédaigner ! Buffon le trouva-t-il au dessous de ses talents sublimes, et son nom en est-il moins grand parmi les écrivains ? Interprète sacré de la Nature, tel est entre eux le rang qui le distingue et qu’il mérite à bien des titres ; mais le premier sans doute est son Histoire des animaux. Froids plaisants, aussi cruels que frivoles, vos vanteries ne me feront pas rougir d’une tache si noble et si douce. Vaudrait-il mieux, à votre avis, ôter d’un trait de plume le Dieu de la Nature que de lui rendre, dans les plus belles de ses œuvres, l’hommage d’admiration et de reconnaissance qu’elles inspirent ?
Oui, charmantes créatures, qui vivifiez la tableau de la création et la rendez plus intéressant à nos yeux dociles et courageux, compagnons des travaux de l’homme, souvent aimables et trop officieux artisans de ses plaisirs pour mériter d’en être les victimes, qui, j’ose le dire, en plaidant pour vous, même contre lui, je sers le genre humain ; et les Cicérons, les Démosthènes, ces beaux génies, ces grands hommes d’État n’eussent pas cru déroger sans doute en se chargeant d’une pareille cause : amis de l’humanité, c’est la vôtre.
C’est en son nom que nous allons réclamer, en voici le moment : ce moment de son triomphe, où, plus respectée que jamais, elle reprend ses droits avec un nouvel empire ; où la fureur même avec laquelle ils furent outragés les rend infiniment plus sacrés et plus chers ! Elle renaît du sein de longues souffrances ; tous ont passé par les épreuves de l’adversité ; et tous les cœurs amollis dans le crues et semblent disposés à s’attendrir ; la férocité même paraît s’humaniser ! Ainsi, lorsqu’on s’est retiré d’un gouffre profond, on se rejette de tout son poids en arrière de crainte d’y retomber. Ainsi des malheurs universels ont préparé le bonheur général ; et peu s’en faut qu’à la vue du président on ne bénisse le passé. Quelle douce inquiétude semble en effet tourmenter les esprits ! C’est à qui trouvera de nouveaux moyens de réparer les maux, de produire le bien non seulement autour de soi, mais sur toute la surface du Globe, comme dans tous les genres ; et le Génie de la bienfaisance est aujourd’hui plus actif, plus créateur que ne le fut naguère celui même de la désolation. Quel plaisir d’observer comment tout s’agite et se travaille en ce moment, pour enfanter la félicité du Monde ! Et quel favorable augure n’en est-ce pas, que ce programme même du sujet proposé, cette espèce de proclamation du corps le plus éclairé de l’Univers à tous ses habitants, énonçant le vœu solennel de rendre heureux tout ce qui respire !
Sans doute il est peu d’hommes aujourd’hui que la vue de l’Etre souffrant puisse laisser tranquille, parce qu’il [4] n’en est point qui n’ait [sic] appris ce que c’est que souffrir, même ceux qui l’avaient toujours le plus ignoré, point qui n’ait eu sa part de ces terribles crises, qui dans les âmes les plus glacées par l’égoïsme, les plus endurcies par la continuité des délices ont dû développer assez et fortement instruire la sensibilité.
Ô combien de fois la mienne, qui fut (grâce à la fortune) exercée de bonne heure, avait souffert pour vous, innocents Animaux ! Et jusqu’à présent j’avais cru souffrir sans espoir : la prescription était si ancienne, les préjugés qui perpétuaient vos malheurs si enracinés, l’habitude de vous opprimer et vous croire faits pour l’être si fortement et si universellement établie, que la seule idée d’une Révolution en votre faveur m’eut paru téméraire et presque extravagante. Mais du moment que dans ma solitude m’est parvenue la nouvelle de ce que l’on tente aujourd’hui pour vous, avec quel transport j’ai saisi l’occasion de vous offrir un défenseur de plus !
Je me soulage moi-même, en cherchant à vous venger. Malheureusement, j’ai lieu de me défier de mes forces : mais nous serons en nombre ; vous avez bien d’autres amis ardents et vous les méritez : j’aurai du moins la satisfaction de seconder l’effort commun.
Oui, réunissons-nous tous, ô vous qui partagez pour eux les mêmes sentiments. Renonçons, pour les mieux servir et mieux concerter nos moyens, à toute espèce de rivalité : que l’unique objet de notre ambition, soit un si grand bien à faire. L’orgueil de l’homme vient de rédiger un Code de ses droits pour l’opposer à ceux de ses prétendus Tyrans : osons lui présenter à lui-même, au nom de ses prétendus sujets, un chapitre de leurs droits, pour l’opposer à ses caprices tyranniques. Faisons en leur faveur une douce violence à ce Despote impérial, si souvent injuste, impitoyable, qui se venge apparemment sur ces impuissantes victimes des maux d’un esclavage imaginaire, qu’il ne doit qu’à ses vices. Toutes les fois que nous reporterons les yeux sur ces compagnes plus tranquilles par nos soins, à la vue de leurs habitants plus nombreux, plus libres et plus gais, ne recevrons-nous pas aussitôt un nouveau prix au fond de nos cœurs, prix infiniment plus doux que ceux de la vanité ?
Génie de l’un et de l’autre Pline, ancien et moderne, prête-moi cette plume que tu n’avais ajustée que pour leurs mains ! Je ne la veux qu’un moment, et pour cet unique usage.
____
[5] Mémoire
Si l’éloquence est l’expression vive des sentiments, plus que l’image des pensées, elle ne peut être étrangère à cette question ; ou même c’est elle qui doit la décider plus que la logique. Les Anciens étaient moins penseurs que nous, plus éloquents ; il y avait plus d’âme, moins d’esprit dans leurs discours ; et c’est pour cela qu’ils ont gardé la supériorité. Notre affectation d’extrême justesse dans nos raisonnements conduit souvent à des résultats très faux en pratique, comme la justice extrême à l’extrême injure, nos abstractions métaphasiques, nos procédés géométriques, nos subtilités analytiques effacent toutes les couleurs de l’imagination, dessèchent le cœur, refroidissent tous les beaux mouvements de passions, détruisent enfin toute la magie de l’éloquence, tout le charme des Arts et de la vie, désenchantent pour nous la Nature.
Jaloux de vous montrer Philosophe au-dessus des préjugés, si vous prononcez que la Bête est pure machine, dès lors plus de difficultés : vous la tourmentez en tous sens, la disloquez, démontez, brisez à fantaisie ; il n’est à cet égard de loi que le caprice. Oh ! Qu’une certaine Philosophie est commode ! Donnez-lui des Machines humaines à gouverner !…
Mais ce n’est pas, et très heureusement, d’après ce principe que, dans la pratique, se conduisent la plupart des hommes, même des Raisonneurs Cartésiens ; et ils ne le feraient pas impunément. Dès qu’ils voient couler le sang, entendent les cris plaintifs de la Machine souffrante, accompagnés de tous les signes convulsifs de la douleur, ils en sentent aussitôt pour ainsi dire le contrecoup sur leur âme ; ils ne peuvent se défendre, quels qu’ils soient, d’une certaine émotion plus ou moins forte, selon la trempe plus ou moins délicate de cette âme affectée. C’est la loi, dont le Philosophe n’est pas plus exempt que tout autre, établie pour la conservation des êtres ; c’est leur sauvegarde : correspondance et réciprocité de sentiments aussi sûre, aussi prompte que la communication des mouvements physiques. L’émanation, l’empreinte (pour ainsi dire) de la sensation douloureuse de l’un passe à l’autre aussi rapidement que la vitesse [6] d’un corps mû se transmet à un autre corps choqué. Quiconque se prépare à frapper, déchirer, tuer un être vivant, n’échappera pas à cette espèce de justice subite, même anticipée, et prévenant la consommation du délit pour l’empêcher plus efficacement. Il ne manquera pas d’éprouver intérieurement une certaine répugnance ; il aura à soutenir une espèce de combat contre lui-même ; il entendra retentir au fond de ses entrailles les cris de la victime ; et le chasseur le plus ardent, le boucher le plus aguerri ne sont point encore tout-à-fait à l’abri de ces atteintes. Qui serait au point de ne plus rien sentir, je le plaindrais fort ! Ainsi presque toujours la douleur que l’on veut causer, se réfléchit vers sa cause ; le trait revient sur la main dont il part ; et le mal, avant même d’atteindre à l’objet contre lequel on le dirige, retourne et réagit au sein du malfaiteur qui le conçut : admirable disposition de la Nature, qui dans l’outrage même, ou plutôt au devant, de l’outrage et dans la seule pensée place la vengeance !
Or, ce mouvement sympathique, inévitable, est l’avertissement énergique du sentiment, qui plus droit et plus juste souvent que la Raison même, vous crie de ne point achever. L’institut irréfléchi de la Pitié, je dirais volontiers la Conscience, réclame, se révolte contre votre brutalité : et si vous passez autre, si sans raison suffisante vous consommez l’action qu’elle réprouve, là commence le délit. On parle de loi : en voilà une ; c’est celle du Talion. La Nature, comme on voit, a déjà la sienne, universelle, irréfragable, imprescriptible comme elle : si pour retenir les emportements de la férocité, elle ne suffit pas, pourquoi les hommes n’y ajouteraient-ils pas leurs règlements et statuts positifs, suppléments nécessaires en tant d’autres occasions aux Lois non écrites ?
Si l’on recueillait au reste toutes celles qui ont été faites, en différents temps, chez différents peuples, pour diverses espèces d’Animaux, il en résulterait qu’il n’est presque aucune des espèces connues et tant soit peu remarquables qui n’ait été mise sous la protection spéciale de quelques lois expresses, ce serait cependant très mal répondre à la question dont il s’agit, et très mal en concevoir l’esprit que de proposer de les renouveler, une pareille idée réussirait peu dans notre siècle ; et ce n’est, certes, pas aujourd’hui qu’on sera tenté de donner dans ce genre de superstition non plus que dans aucun autre. Tâchons donc nous-mêmes d’éviter les excès, et ne soyons, s’il se peut, qu’humains et justes ; ce qui n’est pas toutefois si facile dans une matière qui n’est toute que de sentiment. Oserais-je demander grâce d’avance pour des mouvements, des écarts peut-être de sensibilité, dont il n’est pas aisé de se défendre ? Comment rester de sang froid, ou se tenir dans un juste milieu, à la vue de tant de souffrances et d’injustices ; à la vue de l’homme si malfaisant, quoique si peu fait pour l’être et de tant de mal surtout qu’il se fait à lui-même ? Mais ce n’est assurément pas ici du côté de la pitié, de la clémence, qu’il est à craindre que l’on passe les bornes ; [7] on parlera toujours bien plutôt par barbarie dans ce genre que par idolâtrie ; quand ils auraient, ces êtres si malheureux, quelques enthousiastes outrés, n’auront-ils pas toujours assez de persécuteurs ? Et contre les sophismes de ces derniers, à leurs fureurs, contre le double torrent de l’exemple et de l’habitude, que feront nos Discours ? Ne vous alarmez pas, tranquilles épicuriens : non, quelle qu’en puisse être ou l’excessive mollesse au jugement des uns, ou pour quelques autres la pressante énergie, ils n’amolliront ni ne briseront les Rochers : vous êtes à l’épreuve ! Qu’on me laisse donc m’abandonner à de douces illusions, toujours au moins innocentes et sans inconvénients pour la Société. Mais dût mon zèle pour ces infortunés paraître à certain lecteur, exalté pour le moins et chevaleresque, j’aime mieux (je veux bien qu’il le sache) en être à ses yeux le Dom Quichotte, qu’avec tant d’autres le Bourreau. Et d’ailleurs combien d’âmes honnêtes en revanche m’en sauront gré peut-être ? Car si nous sommes dans un siècle qui n’a que trop hérité des principes de cet égoïsme dédaigneux, de ce fier et sourcilleux Matérialisme impénétrable à nos tendresses pusillanimes, je sais aussi que c’est le siècle héritier de Buffon : et dans quel temps jamais, en traitant un sujet pareil, eut-on lieu d’espérer plus d’indulgence, ou même de faveur, que dans une génération pleine de ses continuateurs, de ses Rivaux, de ses Disciples ? Oui, c’est dans un siècle sans doute instruit par tant de leçons à l’humanité et qui doit se connaître enfin en vraie Philosophie, le siècle des éloges et des prodiges de la pitié, que l’écrivain courageux doit avec toute la franchise qui lui convient, toute la vigueur dont il est capable, attaquer de front et dans leur source des préjugés aussi pernicieux que barbares.
Oserions-nous d’abord nous engager plus avant dans cet examen sans avoir consulté cet éloquent Panégyriste des Animaux, celui qui les a le mieux connus, le mieux jugés, le plus relevés aux yeux de l’homme, qui les a remis à leur place dans la chaine des êtres ? Or, cet heureux confident de la Nature, qui paraît avoir si bien pénétré, si bien expliqué ses mystères, voici l’Oracle qu’il prononce, ou plutôt l’arrêt qu’il porte en son nom : voyons si c’est de son aveu.
La mort violente, nous dit-il, est un usage légitime, innocent, puisqu’il est fondé dans la nature et qu’ils ne naissent (les Animaux) qu’à cette condition.
Cruelle Philosophe !… J’avoue que, malgré mon respect, mon enthousiasme même pour ce grand homme, je ne me sens point du tout à cet endroit entraîné, comme [8] ailleurs, par son autorité, ni son éloquence, que je ne saurais ici l’admirer, encore moins le croire ; et que ce langage ne me plaît ni ne me persuade. Que l’on me pardonne de ne lire qu’en regret cette phrase dans ses ouvrages, surtout ce mot Violente, je voudrais qu’on m’en palliât au moins la rudesse : car parût-il preuve, logiquement parlant, que cette Proposition fût en quelque chose raisonnable et vraie, toujours soutiendrai-je qu’elle n’est point moralement bonne ; qu’il n’était prudent ni salutaire de l’avance ; et quelque démonstration que l’on pût en fournir. Je ne saurais, je le confesse, m’empêcher d’avoir toujours une sorte d’aversion pour l’acte et la main qui donnent cette mort violente. Quelque utile en effet que puisse être cette violence pour celui qui l’exerce, en est-elle moins, pour l’être qui la souffre, une injustice criante ? N’a-t-il pas, par le fait même de son existence (qu’il ne tient certes pas de moi, plus que je n’en tiens la mienne), n’a-t-il pas le droit d’exister comme moi ? Sa vie est sa propriété la plus chère, même la seule au milieu de l’empire illimité que s’arroge l’homme usurpateur ; il a d’ailleurs beaucoup plus d’intérêt à sa conservation : car je n’y perds, moi, par cette séparation appelée mort, qu’une vie improprement nommée, une ombre de vie extérieure et matérielle, non ce principe indestructible d’activité, qui m’est bien plus intime et fait seul ma vie réelle : mais cet Animal que j’assassine, il perd tout.
Est-il bien sûr en outre que cette mort soit de nécessité si absolue pour l’entretien de ma vie ? Des milliers, je ne dis pas d’hommes sobres, de sages, de savants, mais de sociétés, de sectes, de nations, déposerdient le contraire, ce ne sont pas seulement des communautés religieuses ; mais de très profanes par état, non seulement des Anachorètes que l’on a vus conserver par l’abstinence jusque dans l’extrême vieillesse une âme saine dans un corps sain, mais des Athlètes que l’on a vus de préférence user uniquement du régime végétal[1] pour entretenir la souplesse et la vigueur de leurs membres. On citerait pour ce système des peuples entiers.
Est-il bien sûr encore que, même pour donner la mort, cette violence soit absolument indispensable, inévitable ; et que même dans cette fatale nécessité, il ne soit pas possible de l’effectuer, cette mort, par un acte si prompt que tout inattendu, tout involontaire qu’elle est supposée de la part de celui qui la subit, elle puisse être censée néanmoins exempte de violence de la part de celui qui la donne ? Car on m’accordera peut-être, que si l’homme a quelquefois le droit d’ôter la vie, il ne peut dans aucun cas avoir celui de commettre d’inutiles violences ?
Mais violence légitime, innocente ! Quel accouplement de mots ! D’autres sauront les interpréter de manière peut-être à les assortir : pour moi je ne le puis, sans faire une violence terrible à mes idées et surtout à mes sentiments. Légitime, oui, peut-être en un certain sens, quoique bien moins encore que la mort du voleur qui m’attaque [9] à l’imprévu dans un bois, et que cependant mon cœur ne cesse de me reprocher, lors même que ma raison m’absout. Ils ne naissent qu’à cette condition : elle est bien dure ! Mieux vaudrait, pour la bête surtout, malheureuse sans dédommagement ni perspective ultérieure, ne jamais naitre, et ne pas faire de la vie ce triste essai, qui n’est pour elle que celui de la douleur et de la mort ! Mieux vaudra que de recevoir avec la vie le fatal privilège d’être éternellement vexée, moulue de coups, assommée, broyée sous les dents de l’homme[2] Ils naissent sous la condition de finir, oui : la nature veut la conservation, la reproduction, la succession : mais, veut elle précisément la Destruction, surtout violente ? Et serait-ce par la main de l’homme, qu’elle la voudrait ? D’un être qu’elle n’a fait ni violent, ni barbare : à qui même elle a donné une espèce d’horreur invincible pour le sang ? Où sont d’ailleurs les signes de sa mission pour ces assassinats ? Où sont les instruments terribles dont elle eut dû l’armer à cet effet, les dents, les griffes, la face épouvantable ? Ce n’est donc point une chose si clairement démontrée, que cette prétendue intention de la Nature, sur laquelle on prétend fondé [sic] l’usage de la mort violente.
Mais le célèbre écrivain a tant de peine lui-même à mettre d’accord ensemble son cœur et sa métaphasique, que peu de lignes après il se hâte de revenir sur ses pas, et semble vouloir corriger par des maximes plus douces ce qu’il y a de trop dur dans l’assertion précédente.
Comme nous, ajoute-il, les Animaux sont capables de plaisir[3] et sujets à la douleur : il y a donc une espèce d’insensibilité cruelle à sacrifier sans nécessité ceux surtout qui nous approchent, qui vivent avec nous et dont le sentiment se réfléchit vers nous, en se marquant par les signes de la douleur. (Discours sur les Animaux carnassiers, tom. 7)
Je commence à reconnaître ici l’homme et l’Orateur : il redevient éloquent, dès qu’il redevient sensible, parce qu’il parle vraiment alors le langage de la Nature. Plus haut, il n’était que raisonneur, ne consultant que son esprit ou plutôt l’esprit de système ; et c’est alors qu’échappe à son flegme stoïque ce terrible anathème contre tout ce qui respire. Dès [10] qu’il se jette dans les abstractions et les généralités, le brillant et sublime écrivain devient dur, aride, impitoyable ; du haut de son Apathie philosophique il voit tranquillement s’entredévorer, se heurter, confondre, anéantir les espèces ; et considérant ce renouement tout à son aise ; analyse le résultat de ces luttes sanglantes : c’est un flux et reflux d’existence, une transposition de molécules organiques, une nécessité du cours des choses, etc… Oh ! Que je l’aime bien mieux, lorsqu’il s’attendrit, lorsqu’il cherche à nous intéresser par tant d’objets touchants, peints avec toute la richesse et la vivacité du coloris, toute la chaleur du sentiment ; qu’il nous découvre toutes leurs qualités aimables, déplore leur infortune, s’indigne contre leurs persécuteurs ; lorsqu’il tâcha de retenir la main de l’avide chasseur prêt à foudroyer dans les bois le charmant écureuil ! C’est alors qu’il émeut, qu’il ravit, qu’il enchante ! C’est ainsi qu’il s’est fait tant de lecteurs et de partisans, même chez le sexe le plus délicat et le plus sensible ; non lorsque froid et sec algébriste, tout n’est pour lui que calcul, action et réaction, dissolution et recomposition, et qu’il semble ne voir que matière et mouvement dans la nature.
Au reste ce qu’il dit dans cette dernière citation est à peu près tout ce qu’on peut dire de raisonnable[4] à ce sujet, et ce sera mon texte : je ne ferai que le commenter.
La loi positive, la plus ancienne, la plus voisine du berceau de l’homme et de la Nature, est celle en vertu de laquelle leur commun auteur donne au premier homme la jouissance et comme l’usufruit à perpétuité de toutes les choses de ce Monde, avec la règle qui doit en prescrire l’usage.
Régnez sur tous les êtres vivants : Dominamini cunctis animantibus. Je ne vois point encore là de destruction ni de violence légitimée par aucun acte ou signe de volonté supérieure ; il ne s’agit encore que de domination utile et bienfaisante d’une part, de subordination affectueuse de l’autre, et non moins agréable que salutaire aux gouvernés ; nullement de pouvoirs nuisibles et destructeurs. Et ce qui le confirme, ce qui montre à cet égard l’intention bien marquée du législateur, c’est qu’immédiatement après, des vivres sont assignées au nouveau Maître, non sur la substance se ses sujets, mais uniquement sur les [11] produits de la terre[5] : et voilà que je vous donne toutes les plantes et les arbres pour vous nourrir.
Ainsi d’abord, immortel de sa nature, tant qu’il est digne de l’être, le père des vivants, quoique dans un séjour de délices, n’y doit entretenir que de végétaux sa vie inaltérable. Ce n’est que lorsqu’elle a cessé de l’être, qu’il est forcé ou tenté de changer d’aliments. Hélas ! Qu’est-ce donc, Mortes, que cette chair meurtrie, dont vous êtes avides ? Et n’a-t-elle pas quelque secrète analogie avec le crime et la mort, puisqu’elle ne convient à l’homme que lorsqu’il est susceptible de l’un et de l’autre ? Il n’est autorisé à donner la mort, que lorsqu’il la mérite ! Qu’il frémisse !… C’est lui qui l’appela sur toute la Nature !
Ce n’est cependant encore qu’à la suite du déluge, c’est-à-dire plusieurs siècles après, lorsque la Terre et ses productions profondément altérées et viciées dans leurs principes commencent à se ressentir de la dépravation de l’homme, et ne peuvent plus lui fournir des sucs aussi sains, aussi vigoureux, que lui sont donnés, en termes exprès, des aliments et règlements appropriés à ses nouvelles dispositions. C’est alors qu’à ses premières prérogatives sont ajoutés les tristes droits, d’abord d’imprimer la Terreur à tous les êtres animés : fit terror vester super cuncta animantia ; et celui, plus triste encore, de disposer de leur vie. Mais le premier pour sa défense : autrement, tous étant irrités contre le coupable auteur de la malédiction universelle, eut il pu résister à la nature entière conjurée contre lui ? Bientôt peut-être il eut succombé, lui et toute sa race, lorsque les animaux multipliés se seraient trouvés en force contre lui. Le second de ces droits est uniquement pour sa nourriture. L’usage clairement déterminé par les termes de la loi, exclut toute autre interprétation, et ne laisse aucun lieu à l’arbitraire. Il n’est point dit : qu’ils soient votre jouet ; mais votre nourriture : sint vobis in cibum. Comme souverain, qu’il use de ses sujets pour son service, même pour ses plaisirs innocents, rien dans la loi, qui les abandonne à ses caprices.
[12] Nourrissez-vous de tout ce qui vit[6] : voilà la concession et l’usage légitime. Nourrissez vous, ne torturez pas, ne détruisez pas sans raison et sans besoin : voilà la conséquence naturelle, implicitement renfermée dans la permission : sans quoi, elle serait abusive, autoriserait le brigandage, livrerait, à peine créés, les animaux à une proscription générale, et par le trop prompt ravage des ressources qu’elle semblait offrir et ménager à l’homme, produirait un effet tout contraire à celui qu’avait sans doute en vue le Législateur.
Tels sont, je crois, les seuls et véritables fondements de ce droit si vanté de l’homme sur les animaux, droit dont il se prévaut si arbitrairement. Quel autre en effet aurait-il ? Celui du plus fort, même, si l’on veut, du plus adroit ? Le premier, odieux aux yeux de la Raison et d’ailleurs assez contesté ; tous les deux, comme l’observe quelque part le fameux satyrique français, assez ridicules en présence d’un Lion, d’un Tigre, seul à seul avec son prétendu maître au coin d’une forêt. Mais la concession expresse de celui à qui seul appartient effectivement le souverain domaine, constitue, je l’avoue, un droit réel et positif.
Mais si, par cet acte, cette espèce de convention du souverain avec son mandataire, l’homme est établi le Maître, est-ce pour agir un Tyran ? Un roi n’a de pouvoir que pour conserver, défendre, entretenir, protéger, non pour dissiper, vexer, perdre. Le droit d’ailleurs n’autorise pas l’abus : de tous temps il fut des lois contre l’abus du pouvoir ; et lorsqu’il devient funeste, il est d’autant plus coupable, que de sa nature il doit être salutaire, et ne fut établi que pour l’avantage et le bonheur des subordonnés.
Mais cet abus de force, que les lois humaines répriment quand il s’attaque aux hommes et menace leurs sociétés, à quel degré intéresse-t-il la morale publique, quand il ne se manifeste qu’à l’égard des animaux ?
[13] A quel degré ? Pardonnez, lecteur philosophe, je vous ai prévenu que je n’étais tout simplement qu’un homme sensible, dont tout le talent et la logique sont dans son cœur. Au même degré serais-je tenté de répondre, et cela par les mêmes principes que ceux vantés en tant d’écrits célèbres, par humanité ; au même degré que tout acte contraire à cette vertu fondamentale, si fortement et si justement recommandée par vos Maîtres ; au même que tout ce qui la blesse et l’afflige, que tout ce qui l’outrage et l’avilit.
Toutes les vertus morales, à ne les considérer que naturellement, ont leur principe dans la sensibilité ; toutes en dérivent ; les relatives et sociales tiennent toutes au sentiment de la compassion : donc la question présente tient pour ainsi dire, à la racine même de nos affections, aux fibres du cœur humain ; donc c’est vous surtout, bien plus que les animaux, vous, hommes, qu’elle regarde : ménagez-les : respectez jusqu’à des êtres qui sont si loin de vous : c’est à vous-mêmes que vous le devez. Soyez humains même envers les Bêtes : n’est-ce pas vous dire assez ce que vous devez être à plus forte raison envers vos semblables ? Oui, ce sujet est plus grand, plus important, plus élevé qu’on ne pense : ce n’est que parce qu’il intéresse l’humanité toute entière, que cette Assemblée de Platons a cru devoir attacher à la solution demandée le prix le plus glorieux pour des hommes à talents, le plus flatteur pour des gens de bien, l’honneur de son suffrage !
On ne peut disconvenir qu’il n’y ait aujourd’hui même dans la Société parvenue, ce semble, à son dernier degré de perfectionnement, qu’il n’y ait, dis-je, encore une infinité d’usages, de jeux, exercices, métiers, de formes, pratiques, d’habitudes sanguinaires, tendantes à l’immoralité, exerçant à la barbarie, indignes de l’homme, que chez des Peuples civilisés on devrait l’interdire, qu’une éducation honnête devrait proscrire parmi des hommes bien nés ; auxquels par conséquent l’Autorité publique ne saurait être indifférente et qu’il serait utile peut être de modifier, changer, ou réprimer.
Je me garderai de mettre de ce nombre nos habitudes carnassières, et de blâmer l’usage de la viande, je ne rappellerai pas aux hommes d’aujourd’hui ces bons israélites vivant dans un Désert et pendant 40 ans d’aliments en apparence beaucoup moins substantiels que les végétaux, beaucoup plus légers et beaucoup trop même à leur goût[7] .
d’une espèce de distillation aérienne, et vivant sains, vigoureux, tant qu’ils ont la sagesse de s’en contenter leur prend l’envie de manger de la chair ? Un vent officieux leur en apporte de la plus succulente : mais ils périssent empoisonnés en nombre effrayant ; et le lieu de ce funeste essai (avis à la Postérité) est nommé le Tombeau de la convoitise !
[14] Je n’observerai pas à des français qu’il y a dans l’Asie des Nations entières chez qui l’usage de la chair est inconnu ; où[8] cependant les hommes ont une santé aussi ferme, une vie aussi longue que nous ; surtout un naturel excellent, doux, patient, modeste, sobre, susceptible de toutes les vertus ; et je n’en conclurai pas que ce besoin de la subsistance animale n’est donc pas aussi nécessaire qu’on le prétend à l’entretien de la nôtre. Comment en effet être des Peuples civilisés, aimables, sans rôtis, sans ragouts, sans gibier, sans poissons, sans tous les plaisirs de la bonne chère et tous les arts qui s’en occupent ? Ces stupides indiens, dans leur rustique bonhomie, voyent avec horreur les européens, parce qu’ils mangent de la chair !!! Aussi leur rendons-nous bien en mépris l’intérêt de l’aversion qu’ils nous portent : ce sont en effet des grossiers, sans goût, sans délicatesse, hors d’état d’apprécier le mérite d’une bonne table ; ce sont des Barbares !... ce que sans doute ils disent aussi de nous dans un autre sens, bien plus juste peut-être ! Mais nous sommes en ce genre trop loin, pour l’avenir sur nos pas : et puis la gourmandise n’aurait pas de peine à prouver pour elle et la majorité des suffrages, et l’antiquité de ses droits, & !… des hommes d’ailleurs beaucoup plus diserts que moi, parlant avec beaucoup plus d’autorité, ont en vain attaqué sa possession : en vain des Médecins célèbres ont averti les Peuples, au nom de leur santé, des avantages de l’abstinence et du régime végétal, comme plus sain, moins fermentant, moins corruptible : en vain à ces conseils la Religion a joint ses oracles : ses préceptes à cet égard ont toujours été les plus mal observés. Je ne me flatterai donc pas d’ébranler un système aussi bien établi, et ne m’aviserai pas d’attaquer un si cher privilège. Mais on me permettra (du moins de réclamer contre tant de méthodes maladroites, de procédés ineptes[9] d’accessoires et surcharges inutiles dont on aggrave la condition des Animaux déjà si détériorée par la fatale nécessité de mourir de nos mains. Enfin, c’est contre la plupart de nos façons d’agir envers eux et plus encore des maximes dont nous les autorisons que je devrais m’élever : mais je suis forcé de me borner.
Les animaux sont au second rang dans la création : donc l’injustice envers eux, au moins portée à un certain point, bien marquée, bien réfléchie, bien dénuée de motifs excusables, enfin accompagnée de quelque noirceur est, après les crimes d’homme à homme, criminelle au moins au second chef, à supposer qu’elle ne soit nuisible qu’aux animaux, et non pas à l’homme-même, à la société ; ce qui est rare ; car elle nuit toujours au moins par l’exemple. Ces divers habitants de l’Univers en sont ; après l’homme, le plus bel ornement ; ils y répandent la vie ; plusieurs l’abondance. La campagne, dont l’homme exterminateur détruit ou force les animaux à s’exiler, devient une solitude muette, inanimée, stérile, effrayante ; c’est son propre héritage qu’il dévaste et désole ; c’est à lui-même qu’il fait tort. Il se déshonore, se déprave et s’endurcit par ses brutales fureurs. Il se prépare des privations, des maux cruels par ses excès ; [15] il affame, appauvrit des provinces, des peuples, prépare la ruine des empires.
Ce n’est donc pas trop avancer de dire que les traitements barbares envers les animaux doivent être presque assimilés aux attentats envers l’humanité.
Car les uns et les autres partent des mêmes principes de dureté d’âme, de férocité, d’égoïsme, de stupide indifférence au même affreux plaisir à voir souffrir et le premier essai conduit si directement à l’autre, que des Bêtes à l’homme la cruauté n’a qu’un pas à faire. Quiconque a pu goûter une fois le sang, par une espèce d’irritation progressive, juste effet de ce poison brûlant, en contracte bientôt une soif qui le dévore : il se jette sur ses semblables : augmentez sa force avec sa faim, les peuples ne lui suffiront pas.
Ainsi, les premiers chasseurs furent les premiers oppresseurs de l’humanité : c’est en nettoyant les forêts, qu’ils apprirent à saccager les villes, à dévaster les Royaumes, et d’exterminateurs des animaux ils devinrent le fléau des Nations et les désolateurs de la Terre.
Ainsi, bientôt les peuples mêmes, des peuples entiers devenus chasseurs, par nécessité, du moins à ce qu’ils croient, furent par analogie, soldats avec très peu de besoins, moins encore de lumières, peu curieux des autres arts, c’étaient leurs principales et presque uniques occupations. Ils combattirent d’abord les races d’animaux indigènes trop multipliés, qui leur disputaient le terrain, puis les hommes ; il fallut, pour s’étendre, éclaircir alentour ; ou repousser les peuples voisins. Il n’y avait alors qu’une seule race d’hommes pasteurs ou cultivateurs paisibles ; celle qui, dans la ligne des premiers pères des humains, conservait la mémoire de l’auteur commun, avec le dépôt des idées saines et des sages préceptes qu’ils en avaient reçus. Tout le reste des peuples guerriers ne connaissait de mérite que la force, de métier que la milice ; et les hauts faits de guerre contre les animaux ou les hommes faisaient les seuls titres de noblesse.
Ainsi, ceux qui leur ressemblent le plus aujourd’hui, les sauvages, passent toute leur vie à la chasse et chez eux parallèlement il n’est pas d’autres moyens de se distinguer. Les plus habiles dans ces arts meurtriers sont ceux parmi lesquels un Père choisit son gendre, la Nation les chefs ; la considération se mesure sur les peaux de Bêtes, et les chevelures d’hommes enlevées.
C’est dans les bois, sous un maître peu différent de leurs hôtes ordinaires, que le jeune Achille fait ses premières armes. Aussi les mœurs des Héros de ce temps se ressentaient-elles un peu de leurs exercices et séjours habituels ; elles en avaient la rudesse ; couverts de la peau des Bêtes féroces, ce n’était pas quelquefois le trait de ressemblance le plus frappant qu’ils eussent avec elles. On sait que ces peuples à demi civilisés des premiers âges de la société, malgré les efforts des Poètes pour les embellir, n’étaient pas quelquefois fort humains envers [16] leurs semblables ; on sait aussi que les peuples du nouveau monde font leurs plus doux festins de chair humaine !
Ainsi, les uns et les autres, barbares anciens et modernes, se faisant à leur image leurs Dieux mêmes, durs, atrabilaires, jaloux, vindicatifs comme eux, se les peignirent avides de chair et de sang, leur immolèrent victimes sur victimes : Taureaux, Brebis, Génisses, Porcs, Chevaux, Poulets, Colombes etc. durent tribut à la gloutonnerie, non seulement des hommes, mais de leurs idoles ; bientôt, ce fut par hécatombes qu’on leur sacrifia [sic]. Enfin, s’accoutumant à ces boucheries sacrées et les sacrificateurs et les assistants, croyant, parce qu’elles ne leur coutaient plus rien, ne pas en faire assez pour leurs Dieux, cherchèrent un sang plus précieux et plus difficile à répandre. Égyptiens, Grecs, Phéniciens, Carthaginois (dirais-je les Gaulois ?) sur lesquels avaient encore fort enchéri les Américains, livrèrent de sang froid leurs enfants, leurs frères… et crurent d’autant mieux expier leurs forfaits, qu’ils les multiplièrent plus hardiment en l’honneur de leurs divinités ; c’est à force de se montrer en leurs noms implacables qu’ils prétendirent les apaiser. Quelques sages, apparaissant de loin en loin au milieu de cette barbarie, n’osaient combattre ces préjugés monstrueux, ni réclamer l’humanité : ils l’eussent fait en vain : il fallait qu’elle redescendît du Ciel ; et ce n’est qu’à cette Philosophie évangélique, qui seule a plus adouci les mœurs que toutes les leçons des moralistes anciens et nouveaux, qu’il appartenait de substituer à cette multitude d’animaux en tous lieux et tous les jours sacrifiés pour le seul usage de Temples, à ces fleuves de sang dont ils étaient sans cesse inondés et souillés, une victime unique, infinie, éternellement reproduite sur les autels.
Mais jusqu’alors, et jusque dans le sanctuaire les cruautés envers les animaux accompagnèrent ou préparèrent celles envers les hommes.
Ainsi, et presque chez toutes les Nations, l’homme qui fait métier et trafic de tuer et dépecer les animaux, chargé d’épargner ces meurtres aux autres membres de la société et leur fournir la quantité de chair nécessaire à la consommation générale, le boucher a toujours été jugé le plus propre à donner la mort à des hommes et remplacer le Bourreau.
Ainsi cette espèce de Populace, aussi féroce que stupide, que redoute l’homme bien élevé, grossier instrument de presque tous les forfaits des grands scélérats, semble se dédommager par sa brutalité envers les animaux de la contrainte que les lois imposent à sa férocité contre les hommes.
On n’a pas assez remarqué peut-être par quels essais les machinateurs révolutionnaires, qui se servaient de tout, la disposèrent à leurs desseins. On la fit préluder aux massacres de la Capitale par un massacre général à 20 lieues à la ronde de toutes les Bêtes fauves ; et par l’ardeur avec laquelle elle s’y livra on dût juger de ce qu’on en devait attendre. Les chemins, les fosses étaient jonchés de cadavres, qu’on laissait pourrir, sans qu’elle eut songé même à profiter de leur chair ou de leur dépouille. On voyait qu’elle s’était abandonnée au plaisir d’égorger, plus encore par cruauté, que par aucune [17] espèce de nécessité ou d’intérêt. C’était le premier appât qu’on jetait à ces meutes furieuses pour les amorcer et leur donner le goût du sang avant de les lancer sur une autre espèce de gibier.
Ainsi les premiers valets bourreaux des Catilinas de la Révolution, ceux qui apprirent au Peuple à dépecer vivants des membres humains, furent la plupart de ces hommes que leur profession accoutuma au courage[10] . Tous les coupe-têtes des différents époques étaient de cette espèce féroce, qui fait parmi les hommes comme une classe à part ; dont la figure même exprimant au dehors les habitudes l’âme ou l’influence d’un tempérament atrabilaire, dont le front ténébreux, les yeux enflammés, le regard sinistre respirent la fureur, glacent d’effroi le citoyen paisible ; de ces hommes que d’un coup de pied ou de bâton on voyait souvent dans une rue assommer à plaisir un pauvre animal, uniquement parce qu’il se trouvait devant leurs pas, s’acharner jusqu’à la mort sur un malheureux limonier hors d’haleine traînant une lourde voiture sur un pavé raide et glissant ; pour qui c’était un spectacle délicieux qu’une scène d’échafaud ; ou qui du moins, à défaut de celles-là trop rares à leur gré, s’arrêtaient à contempler d’un œil fixe et ravi une batterie sanglante sur la place ; et qui, loin de se prévaloir du nombre et de la force pour séparer les combattants, eussent tourné plutôt toute leur fureur contre le citoyen sensible accourant se jeter entre deux.
Et cependant cette multitude grossière, qui n’en est qu’à peine encore aux premiers éléments de la civilisation, cette fange de la nature humaine, quand elle est de sang froid et n’est pas remuée par des impulsions étrangères, ne paraît pas elle-même à l’épreuve de la pitié. Que, sur le pavé de la Capitale, elle entende crier ce chien frappé sans raison à toute outrance, qu’elle voie tomber ce cheval sous les coups de son conducteur ivre, au premier ébranlement involontaire des organes de la sensibilité, elle s’ameute à l’entourer par curiosité d’abord : bientôt vous voyez l’indignation éclater ; et même (disons-le en réparation d’honneur pour la Nature humaine) c’est le plus grand nombre que révolte l’injuste cruauté. Voilà l’homme qui reparaît !
Voilà ce Peuple qui massacre et pleure sur sa victime ! La voix de la Nature non dépravée perce à travers même toutes les habitudes contraires ; voix, qui de sa part est un ordre ; car elle n’a rien fait en vain : elle ne ment pas à l’homme ; et ce n’est pas elle qui l’induit jamais en erreur, mais la fausse interprétation qu’il donne trop souvent à ses maximes ; et quand au fond du cœur elle lui dit d’un ton de reproche : pourquoi fais-tu cela ? Il y a tout à parier qu’il a tort de le faire.
Ainsi, l’on sait combien les spectacles du Cirque, les combats des gladiateurs et des animaux servaient à endurcir et tenir en haleine certain courage féroce [sic] qu’avait retenu de son origine et conservé dans ses mœurs à travers plusieurs siècles d’invasions et de vengeances ce Peuple dur et fier dont les grands de Rome avaient besoin pour étendre et maintenir leur puissance.
[18] Ainsi, chez un peuple aussi pénétrant qu’humain, qu’on n’accusera pas, je crois, de manquer de lumières et dans un temps où sa réputation d’équité évoquait à son Tribunal les causes les plus célèbres et les Dieux de la terre, cet impartial et judicieux Aréopage condamnait à la mort un enfant injuste meurtrier de son Moineau, augurant de sa barbarie pour cet animal innocent et doux sa cruauté future envers ses semblables, si jamais ils se trouvaient à sa merci comme la faible volatile.
Même jugement[11] fut prononcé contre un Citoyen adulte pour avoir, contre son sein-même, étouffé une Perdrix, qui, vivement pressée par les chasseurs, s’y était refugiée comme dans un asile inviolable. Sans doute on craignit pour l’État la même perfidie, qu’avait montrée ce cruel envers le suppliant dont il avait si traîtreusement trompé la confiance.
Or, je pense, on ne soupçonnera pas ces Athéniens polis de rudesse ou de rigorisme. Il n’y eut jamais dans l’Antiquité de peuples dont les mœurs eussent plus de ressemblance avec les nôtres. Ils avaient sans doute, aussi bien que nous pour le moins, cette sensibilité exquise, ce tact aussi fin que sûr, ce sentiment des convenances et cette délicatesse dont nous nous piquons ; et c’est là précisément ce qui dicta la sentence : car la loi ne pouvait certainement avoir prévu de pareils cas ; et l’on peut croire que Solon, qui n’avait pas cru devoir en faire même contre le Parricide, n’avait pas surchargé son code de pareils règlements. Mais combien, dans ces premiers temps surtout, de faits et circonstances imprévus, où l’on ne pouvait attendre la loi, ni la qualification claire et précise du délit ? Le sens intime, l’équité naturelle prononçaient [sic] ; et plus voisin de sa source, l’instinct de la Nature, l’instinct moral, que n’égarait point encore de fausses subtilités, était alors plus pur sans doute. Les mœurs suppléaient aux tables de la Loi ; on n’avait point un énorme digeste, mais on avait plus de droiture et de simplicité. Ou plutôt il y avait la loi générale, claire incontestable, autant qu’intelligible à tous les hommes ; loi, la plus fortement imprimée et pour l’éternité, parce qu’elle l’est dans les cœurs, celle d’être humain. Cette parole intérieure, qui dans aucun temps ne fut muette, ne fais pas à d’autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît, nous le dit indistinctement pour tous les êtres sensibles, et chaque fois qu’on veut leur nuire. On ne fit donc alors qu’appliquer le principe universel au cas particulier et que l’on ne croie pas que ce fussent seulement quelques sages, quelques esprits mieux cultivés, quelques âmes plus élevées qui portaient de pareils jugements : non, c’était le suffrage de 500 magistrats du Peuple, citoyens de toutes les classes ; c’est-à-dire un nombre assez prépondérant, assez mélangé, pour être censé la voix publique. C’était l’instinct universel qui condamnait le coupable. Non, ce n’est pas un homme, se disaient tous ceux qui ne se sentaient pas capables d’une action pareille. Il serait dangereux parmi les hommes : qu’il meure.
[19] Je veux bien croire qu’il y avait en ce cas un peu de précipitation, un peu même d’exagération de sévérité d’une part, de pitié de l’autre ; mais elle est honorable à ce Peuple vif et léger, si l’on veut, mais délicat et juste par sensibilité, autant au moins que l’étaient par raison ces inflexibles Romains, qui se croyaient bienfaiteurs de tous ceux qu’ils n’exterminaient pas.
Ce n’est, certes, pas lui, ce Peuple ingénieux et doux qui, tout avide qu’il fût de spectacles, ne pouvant vivre sans spectacles, créateur même des spectacles, les a jamais aimés, les eut jamais supportés de la nature de ceux de Romains, et jamais il n’eut dit dans le même sens qu’eux, panem et circenses, du pain dans nos maisons, et du sang dans nos cirques : l’un est, à leurs avis, aussi nécessaire que l’autre.
On pourrait s’étonner qu’aujourd’hui ce soit précisément dans la ville du monde la plus éclairée, la plus polie, dans la véritable Athènes moderne, que s’exercent les plus indignes traitements contre les animaux : je ne dis rien des hommes : les souvenirs du lecteur n’y suppléeront que trop bien. Serait-il donc vrai que la dernière période de la civilisation ramenât par l’Egoïsme, à l’insensibilité et de l’autre bout du cercle à l’extrême opposé de la barbarie la plus brute ? On sait trop comment cette heureuse impassibilité philosophique par rapport aux animaux s’est soutenue dans la même ville à l’égard des hommes ; et comment sur le Volcan qui dévorait une partie de sa population, parmi des fleuves de sang on dansait, on riait, on courait avec la même frivolité, les uns aux Clubs les autres aux comédies, si même ce n’était pas aux tragédies révolutionnaires.
Il est certains peuples (bien différents, je l’avoue car ils n’ont ni comédies, ni sophistes ; quoique ces derniers paraissent en faire assez de cas ; peuples, ainsi qu’ils s’expriment, encore dans l’état de pure nature !) chez qui les premiers voyageurs n’ont point trouvé d’animaux domestiques ; et je le crois : on devrait s’étonner de les trouver encore eux-mêmes sur le globe, puisqu’ils ne sont occupés qu’à s’entredévorer ; on voit que je veux parler des Anthropophages. Ces hommes, sans affections, sans entrailles (pour avoir osé dans leurs entrailles ensevelir les chairs fumantes de leurs semblables !... pourraient-elles, après cela, être encore émues ?), ces hommes, qui respectent à peine les liens du sang et quelques-uns mangent leurs pères vieux, comment pourraient ils s’attacher à d’autres êtres vivants, qui leur sont bien plus étrangers ? Aussi passent-ils la plus grande partie de leur vie à la chasse (je pourrai dire) de leurs semblables, comme des Bêtes fauves.
Au contraire, je vois des Peuples chez qui l’on prend un soin particulier des animaux ; dont l’industrie semble être principalement occupée à les élever, les multiplier, à cultiver leur instinct, perfectionner la beauté des espèces et leurs facultés naturelles : or de ceux là, certes, on peut à coup sûr affirmer que ce ne sont pas les plus durs envers leurs semblables.
Bons Helvétiens, peuple agricole et pasteur, chez qui les troupeaux prospèrent, aux soins de qui l’Ange protecteur de l’Europe semble avoir remis le dépôt conservateur [20] des restes précieux de ces utiles espèces qui vint dépérissant, trop peu ménagées chez les autres Nations ; vous qui presque seuls en fournissez à toutes surtout à la France, où la diminution en devient de jour en jour plus sensible en raison des progrès de notre luxe ; vous qui partagez de si bon cœur avec ces hôtes reconnaissants vos toits et vos Montagnes ; oh ! Je ne suis pas étonné qu’elles soient devenues le rendez-vous des savants des sages, des hommes sensibles de toutes les Nations éclairées. Cet air de calme et de contentement, de franchise, de cordialité qu’on y respire, ce même caractère doux obligeant, affectueux qui se déploie au sein de vos foyers, dans vos cabanes et vos vallons[12] . Paisible, cette vie simple, innocente et pure, ce charme enfin qui, par des nœuds si forts attache au sol natal tous ses divers habitants c’est là ce qui vous attire aussi de toutes parts les étrangers ravis, comme si l’image du bonheur et quelques restes du Paradis terrestre se fussent, dans la tourmente du Déluge, fixés parmi vos rochers !
Vous êtes pour ceux qui vous visitent ce que vous êtes envers tout ce qui vous entoure, envers tout ce qui vous approche ; et ce n’est certes pas chez vous que d’atroces calculateurs en ont froidement imaginé ; pour unique remède à la pénurie des animaux et la disette des vivres, de diminuer en même proportion l’espèce humaine et d’en faire disparaître une partie pour fournir plus aisément à la subsistance de l’autre !
Et vous, soyez bénis, sensibles Orientaux, paix, abondance à vos campagnes, ô vous, qui, loin d’égorger, lorsqu’il est hors de service, le docile collaborateur qui sillonna vos champs, vous faites un devoir, un plaisir de lui payer dans ses vieux ans l’intérêt de ses longs travaux ; et désormais déchargé du joug, dans un tranquille et doux repos à l’Etable, le nourrissez à plein râtelier jusqu’au terme que lui marque la Nature ! Et vous en avez reçu le prix d’avance par le zèle de ses bons serviteurs ; vous le recevrez encore des héritiers de leurs emplois et de leur dévouement ! [sic].
Qui voudrait soutenir qu’il fut indigne du grand Alexandre d’élever un Mausolée au Compagnon de ses victoires et de lui faire des obsèques solennelles avec la magnificence qui permettait la fortune du conquérant de l’Asie ? Assurément, s’il est dans la vie des excès déshonorants pour sa mémoire, ce n’est point à celui d’une pareille reconnaissance que s’attachera la censure et le mépris de la Postérité. Ce même homme, qui ne peut refuser des larmes au fier et docile animal dont le courage avait cent fois pour lui bravé la mort, il en versera de bien plus amères sur le tombeau de son ennemi. Je déteste sans doute le meurtrier de Clytus ; mais je ne puis m’empêcher d’aimer le guerrier sensible, qui, touché des maux de chacun de ses soldats plus que des siens, par l’effet du même caractère, l’est aussi de la perte de son cher Bucéphale, laisse éclater ses regrets, honore sa mort, mais venge d’une manière terrible celle de Darius, mais pleure et se reproche toute sa vie celle de ses amis.
On me permettra bien même, je pense, d’applaudir plutôt à la sensibilité de cette femme qui dans son père élève un monument au bichon qu’elle aimait, qu’à la stoïque fermeté de celle qui, sur la place des exécutions, va louer une fenêtre pour voir tomber une tête illustre. L’une obtiendrait une place parmi les tableaux gracieux et touchants du peintre des Jardins ou de la Pitié ; l’autre ne mériterait que l’indignation d’un Juvénal ou de Gilbert.
Parmi ceux des animaux en qui l’on a cru remarquer [21] quelque chose d’approchant de ces qualités estimées dans les hommes sous le nom de vertus, il n’en est presque pas qui n’ait été chéri, soigné, révéré dans quelque lieu du monde et dédommagé de l’injustice générale par quelques tributs particuliers d’estime et d’amour.
Les anciens, plus justes que nous, croyaient voir quelque chose de divin dans les abeilles. En effet ces petits animaux qui, dans l’Univers, tiennent si peu de place, y sont un miracle vivant et perpétuel. Mais la merveille et son Auteur aujourd’hui ne nous occupent guère ; notre avarice n’y voit que le gain et ne les entretient qu’à raison du produit : on prenait d’elles autrefois un soin religieux.
Il est un petit oiseau fort connu, mais peu remarqué parce qu’il est modeste ; comme l’est d’ordinaire le mérite, cachant, ainsi que le Rossignol, sous un extérieur fort simple de rares talents, solitaire sans être sauvage, sociable au contraire et d’un naturel très communicatif, paraissant rechercher l’homme ; je veux parler du rouge-gorge. On dit que, chez certains Peuples du Nord frappés apparemment de son air mystérieux et recueilli, il est en vénération ; et je n’en suis pas étonné : j’ai souvent moi-même observé, non sans intérêt, ce coup d’œil affectueux avec lequel à travers les bois silencieux et sombres, il suit de branche en branche le voyageur tournant sur lui sans cesse un regard animé, tendre et curieux ; on dirait qu’à chaque instant, prêt à s’élancer vers lui, il hésite, balancé entre l’admiration et la crainte. Tout au contraire de la plupart des autres animaux, il se rapproche en hiver de nos habitations, et vient choisir avec une confiance, hélas ! Trop souvent téméraire, nos toits pour asile. Sans doute il est permis d’être touché de ces démonstrations de bienveillance ; et je partagerai volontiers quant à moi la faiblesse, si en est une [sic], de ces bons Peuples, qui, par un juste retour, ont pour lui des attentions particulières, s’empressent de lui fournir des aliments, croient eux-mêmes leur table plus saine et plus sainte ; quand ils voient ce petit convive y becqueter leur pain, regardent presque comme un sacrilège le mal qu’on voudrait lui faire et sa mort comme un accident de funeste augure. En quoi peut-être ils méritent bien autant que nos habiles oiseleurs qui se piquent de les détruire par milliers ; cruauté forte injuste d’abord, puisqu’il en est peu de moins nuisibles : ils ne vivent que d’insectes ; perfide et lâche, puisqu’ils sont également sans défiance et sans défense ; très inutile en outre, puisqu’à peine chacun de ces petits corps fournit-il à notre appétit vorace une mince bouchée plus garnie d’os que de chair ; j’ajouterai volontiers, coupable envers la société-même, en enlevant à l’homme une de ces agréables et salutaires distractions que lui ménage la Nature au milieu de ses travaux ou de ses voyages, et le privant de concerts, moins éclatants mais aussi mélodieux et plus doux peut-être que ceux même de Philomèle ; car le Rouge-gorge est de la famille. Et combien d’autres, ou volatiles ou quadrupèdes, fourniraient en leur honneur et contre nos injustices des observations pareilles ?
Ce ne sont là, direz-vous, que de ces traditions ridicules, qui se perpétuent sans aucun fondement parmi le [22] le peuple ; de puériles erreurs, fruits d’une grossière ignorance… peut-être : mais je ne sais si je les échangerais, bel-esprit de la Capitale, contre les froids et tranchants oracles de votre omniscience.
Ce superbe oiseau, qui, tout commun qu’il est, n’a peut-être pas, à tout prendre, de rival pour la beauté, la majesté du port et du maintien, l’art de se faire aimer et respecter des sujets qui l’entourent, dont même autrefois le courage fournit des spectacles intéressants à plus d’un peuple célèbre, le coq est aujourd’hui même encore en grande considération chez les Perses. Pour nous, trop supérieurs à toutes ces minuties, ou bien nous le mutilons pour le manger plus gras et plus tôt, ou nous le tuons pour nous dispenser de le nourrir après l’avoir énervé et dépravé dans le sérail où nous favorisons son libertinage au profit de notre intempérance[13] . Autrefois, ces Romains si sensés se piquaient de payer magnifiquement les services que leur avaient rendus par leurs cris ces oiseaux, dont aujourd’hui le nom pour notre froide malignité est une Satyre. Quant à nous, qui avons acquis bien d’autres lumières, nous serions honteux sans doute d’en faire autant ; par la raison, que les actes purement physiques et sans moralité d’une machine ne sauraient être méritoires !
Autrefois, on nourrissait, aux frais de l’État et dans les temples, ces cigognes, instruments de la bienfaisante attention des Dieux, qui purgeaient les campagnes des reptiles engendrés dans le limon du Nil.
Établies à Rome au faîte du Temple de la Concorde, elles en étaient un emblème et pour les citoyens un exemple vivant des vertus qui font le bonheur des familles et des États. Il n’y a pas longtemps encore que, par tradition ou par sentiment, elles étaient reçues avec bienveillance dans les pays qu’elles paraissent affectionner ; le domicile qu’elles s’y étaient ou choisi ou construit, était, même en leur absence, regardé comme inviolable, leur retour annuel attendu comme une heureuse époque. Mais, depuis que l’on s’est avisé, chez les peuples éclairés de l’Europe, de trouver que leur chair était un bon manger [sic], on a secoué tous ces vieux préjugés ; et ces touchants modèles de piété, de reconnaissance, ne trouvent plus ni grâce ni pitié : plus d’asiles pour les pères tendres ni les enfants respectueux. Insultées, poursuivies dans leurs antiques demeures, elles n’y reviennent plus ; et, repoussées de contrées en contrées, elles seront bientôt forcées de disparaître successivement de tous les lieux fréquentés par ces honnêtes humains, qui ne les admirent plus que par métaphore et figure poétiques.
Et cependant vous auriez si grand besoin de leçons à cet égard, elle est si rare parmi vous, Mortels, cette belle vertu, si noble, si touchante, la Reconnaissance ! Laissez-nous du moins la chercher parmi les animaux, et ne l’étouffez pas dans leur sang. Hélas, à n’opposer même que des Individus de votre côté, à des Espèces de l’autre, est-il bien sûr qu’il se trouvât de ceux-là parmi vous exempts d’ingratitude, autant au moins que de celles-ci parmi les animaux susceptibles de la reconnaissance la plus vive et la plus vraie ? Je rentre chez moi après une absence un peu longue : et déjà, devançant tous les gens de la maison, l’animal que j’y loge dans un coin sur la paille, et nourris de pain noir, est à mes pieds, éperdu, suffoqué haletant d’amour et de reconnaissance : elle étincelle dans ses yeux, elle se déploie dans tous ses gestes, elle parle avec énergie dans ses tendres plaintes et sa voix sanglotante ; il s’épuise, se [23] fond de reconnaissance, et les transports de la joie, tant les extrêmes en ce moment se rapprochent, semblent en lui prendre les caractères de la douleur, tous les regrets des jours passés loin de moi semblent se réveiller et se confondre avec le plaisir de me revoir : je crains qu’il ne se consume et n’expire à mes pieds de tendresse… j’ouvre la porte de mon cabine le Serin[14] à qui je donne tous les jours un peu d’eau fraîche, quelques brins d’herbes et quelques grains éprouve à ma vue les mêmes palpitations et me l’exprime par ses battements d’ailes, ses roulements de voix, ses efforts de poitrine pour chanter ma joyeuse arrivée et peut-être, partout ailleurs ne rencontrerai-je que des visages froids, de froides salutations, froides formules, froides étiquettes (me préserve au moins le Ciel d’embrassements perfides !) suppléeront au mouvement du cœur : et je ne dois pas essayer d’y pénétrer plus avant : le mien aurait trop à souffrir !
Sur tout autre cependant que sur celui de l’homme à l’emploi d’un bienfait est si poussant, qu’on a vu les Monstres-mêmes des forêts ne pouvoir en perdre le souvenir, tout le Monde connaît l’histoire si publique, attestée par différents auteurs, admirée de Rome entière, de cet esclave médecin d’un lion, et de ce lion sauver et depuis inséparable ami de l’esclave. Tous les traits pareils[15] . S’ils étaient recueillis, fourniraient à l’histoire naturelle des animaux une suite morale volumineuse encore peut-être, mais à coup sûr non moins précieuse que toute cette immense collection. En effet, de quelle vertu les animaux ne fourniraient-ils pas l’exemple aux humains, mais vertus pures et sans mélange ; tempérance dans la plupart et sobriété la plus sage, chasteté constante, invisible, docilité à toute éprouve [sic], fidélité inaltérable dans plusieurs [sic] ; modération, clémence, générosité magnanime dans les plus forts ; bienfaisance ardente, désintéressée[16] , fraternité la plus sincère dans un grand nombre ? En quel lieu les sociétés des humains offrent-elles un modèle de paix, d’union, d’égalité, de concorde aussi parfait que dans nos colombiers, où, tandis que l’Epervier ne peut rompre les phalanges des citoyens pressés qui se font les uns aux autres un rempart de leurs corps, l’homme seul, l’homme incapable d’être retenu par aucun obstacle, aucune considération, ne pénètre jamais que pour y porter toutes les horreurs d’une ville prise d’assaut !…
Ces innombrables colonies d’oiseaux voyageurs, les voit-on, pendant une longue traversée, rompre un moment le pacte d’union générale ? Tous partent, s’arrêtent, reviennent en même temps ; tous se dirigent du même côté, s’avertissent, s’entraident ; nul sujet de querelles, de guerre. Mais que l’homme s’aperçoive de leur arrivée, de leur passage, de leurs pauses en quelque endroit ; aussitôt des machines meurtrières et mille autres perfidies vont les exterminer, les disperser !…
En vain, pour combattre d’injustes préventions, répéterais-je sur les talents des animaux, leur beauté, leurs grâces et tous leurs droits à nos égards au moins et notre indulgence (pour ne rien dire de plus), ce qui a déjà si souvent et si bien été détaillé par tant de plumes non moins savantes qu’élégantes, surtout depuis Buffon, dans un siècle où l’on sait tout, où l’on parle de tout bien mieux que l’on n’agit et où l’on n’est que trop accoutumé à remplacer les mœurs par les connaissances. Mais sans parcourir toutes leurs facultés, tous leurs avantages depuis la trompe du judicieux éléphant jusqu’à la pompe aspirante du moucheron, ou l’état chimique de l’industrieuse [24] abeille ; sans m’amuser à dérouler sous vos yeux le peloton que tirent et dévident l’une de son sein, l’autre de sa tête l’araignée ou le Ver à soie ; sans inventorier les richesses de la robe d’un faisan, d’un perroquet, de l’oiseau-mouche, ou de l’aile d’un papillon, combien en général d’espèces si intéressantes qu’elles devraient obtenir grâce pour beaucoup d’autres !
Nous les aimons tant en peinture ! Il faut qu’elles ornent nos tapisseries, nos tableaux[17] , qu’elles embellissent nos paysages, qu’elles animent nos descriptions, nos poèmes ! Comment, lorsque nous les possédons en nature, les ménageons-nous si peu ?
Qu’est-ce qui nous charme dans cet heureux peintre des animaux, l’inimitable Lafontaine ? C’est moins l’art si délicat et le caractère unique de son style, que leur propre caractère, leur figure-même réfléchie comme dans une glace ; et cette aimable naïveté avec laquelle il a su nous représenter comme au naturel leur physionomie, leur maintien, leur ton, leurs attitudes, leurs peines, leurs plaisirs ; cette naïveté qui nous paraît la leur même, ou comme un extrait de ce qu’il y a de plus exquis dans tous leurs instincts ; qui nous fait absolument oublier l’écrivain, pour ne songer qu’à ses personnages ; en un mot ce sont eux, ce sont les bêtes-mêmes que nous voyons, que nous entendons, que nous admirons, ou plutôt que nous chérissons dans ses faibles : elles nous y gagnent, nous attachent, nous enchantent à tel degré, que nous leur permettons volontiers de nous y faire la leçon ; que nous les donnons à nos enfants dès leur plus tendre usage pour leurs premiers précepteurs. Eh ! Quand l’oracle même de la céleste sagesse nous renvoie à l’école[18] d’un insecte, seraient-elles donc si fortes à dédaigner pour les sages de nos jours ?
Mais au moins sont-elles innocentes : et quand elles n’auraient auprès de nous d’autre recommandation, cela seul ne devrait-il donc pas suffire auprès de l’homme qui doit être équitable, parce qu’il est raisonnable, qui doit être généreux parce qu’il est le plus fort ? Oui, cette innocente simplicité devrait toucher, désarmer les plus cruels. J’ai vu de ces hommes impitoyables, qui par esprit de parti, pour des opinions purement systématiques, se faisaient un jeu de créer d’un mot des milliers de malheureux, qui semblaient se baigner à plaisir au sang de leurs semblables, je les ai vus, par une étrange contradiction[19] ne pouvoir écraser un insecte hideux, ni souffrir qu’on l’écrasât en leur présence, et, par les mouvements convulsifs de leur visage, attester leur propre et véritable douleur à cette vue. C’est une des énigmes de ces cœurs ténébreux ; mais énigme cependant non tout à fait inexplicable. Inhumains envers les hommes, ils étaient sincèrement et sans hypocrisie humains envers les bêtes : leur jaloux orgueil était à l’aise avec elles, et leur ambition ombrageuse n’en avait rien à redouter ; ils ne trouvaient point là de Censeurs, de Rivaux ; aucune prétention, aucune contrariété, qui de cette part vint exaspérer leur naturel irritable. On sait que plus un homme est sensible, plus les passions chez lui sont vives et promptes à s’enflammer, plus les mauvais procédés apparents ou réels le révoltent et l’indignent. Ordinairement, nous croyons voir dans les actions des hommes qui nous offensent des raisons, des intentions qui justifient à nos yeux notre colère, nos ressentiments, nos haines ; nous leur prêtons des couleurs odieuses ; nous les voyons en nous-mêmes, et de plus à travers le microscope de la prévention ; ce dont nous nous sentons capables, nous les en jugeons coupables ; mais les animaux, (et cela est à leur honneur) nous ne pouvons [25] les juger ainsi, les voir du même œil ; ils ne sont ni envieux, ni injustes, ni vicieux à notre manière, avec notre malice, et nous sommes très intimement convaincus qu’ils ne mettent dans leurs actions ni la réflexion, ni le dessein, ni la malveillance et la noirceur que nous y mettons nous-mêmes de sorte que, hors les animaux nuisibles avec lesquels nous sommes dans le cas de la défense naturelle, la plupart doux, paisibles, timides, dépourvus de motifs et d’intentions malfaisantes, ne peuvent même dans leurs fautes envers nous, provoquer de notre part une juste vengeance.
Que penser, donc, quand nous voyons des furieux plus brutaux[20] que les brutes qu’ils maltraitent, s’acharner sans aucun motif apparent contre des animaux dociles, caressant les plus affectionnés à l’homme qui semblent n’exister que pour le recréer et lui plaire ? Mais il est de ces caractères farouches indomptables, que rien n’émeut, rien n’amollit, dont rien ne fléchit ta rudesse, qu’aucuns bons offices ne touchent [sic], que toute apparence de mérite offusque et choque, que les démonstrations même de bienveillance irritent… pour quelques os (et moins encore !) un chien s’attache : il volerait à la mort pour leur défense, pour leurs plaisirs : et ce dévouement, cet amour, comment sont-ils payés ? Par autant de rebuts, de brusqueries, de douleurs, qu’il compte de moments dans sa malheureuse existence !
Il arrive assez souvent que ce domestique infidèle, ce tendre l’un des plus utiles, ce vigilant gardien du logis, l’ami le plus sincère peut-être de la famille, et si terrible à ses ennemis, peut à peine trouver un coin où se reposer dans toute la maison, ici repoussé d’un coup de pied par l’un des maîtres, là harcelé des niches d’un enfant malicieux, plus loin blessé d’un coup de bâton par un valet brutal… J’avoue que, sur cet échantillon des mœurs de la famille, je ne puis m’empêcher d’augurer assez mal au chef lui-même, avec qui je présume fort que souvent les serviteurs, les fils, l’épouse ne doivent guère se trouver mieux.
La nature, en faisant l’homme le plus sensible des animaux, a pris soin de donner en même temps à plusieurs tout ce qu’il faut pour émouvoir cette sensibilité et par là établir entre eux et lui les rapports sympathiques les plus puissants, des correspondances nécessaires ; c’est, dis-je, à cet effet qu’elle leur a donné ces grâces intéressantes, cette douceur inaltérable, ce dévouement sans bornes, un regard plein d’affection, des caresses aussi vives que sincères que souvent les menaces même et la terreur ont peine à suspendre, qui appellent notre tendresse, soutiennent l’injustice de notre colère, s’efforcent de la fléchir, ou s’y livrent avec un abandon si touchant comme en expiation du malheur involontaire de n’avoir pu nous plaire assez : quel cœur de fer[21] y résisterait ?
Et cependant, ce sont précisément ceux qui ont le plus à souffrir de nos bizarreries cruelles ! Ce chien qui ne sait que flatter la main qui le frappe ; cette brebis, qui nous abandonne avec tant de sécurité son lait, sa toison, ses agneaux tout son être ; cette chèvre, qui prend avec une gaité si naïve ses ébats au milieu de nos enfants ; ce taureau, qui serait indomptable s’il ne sentait un penchant plus fort encore à soumettre sa vigueur à notre joug ; ce chameau, plus patient encore qu’il n’est robuste, qui soutient au milieu des plus rudes travaux, des courses les plus longues et les plus [24] continues, sous les fardeaux les plus pesants, la faim, la soif la plus absolue et endure des [sic] huit et dix jours sans se plaindre pour se prêter à nos intentions et mieux seconder nos projets ; ce brouillant coursier, qui semble n’être fier de sa souplesse, de son courage et de sa force, qu’autant qu’il les emploie à notre service ; tous ces animaux retenus par leur crédule instinct autour de nous, y sont, dans notre société perfide ou dans nos chaînes, infiniment plus malheureux en se sacrifiant à notre bonheur, que ceux qui vont, loin de nous, confinés, vivre au fond des plus stériles déserts.
Outre les animaux domestiques, il en est plusieurs même parmi ceux que nous traitons de sauvages, qui paraissent, malgré nos injustices, conserver pour l’homme une constante bienveillance et chercher les moyens de le servir même à son insu. Qui se serait avisé (par exemple) de mettre le lézard de ce nombre ? Cependant, ce petit animal, qui d’ailleurs de forme élégante, de couleur agréable, plein de grâce et de légèreté dans ses mouvements, aurait tout ce qu’il faut pour plaire à des yeux équitables, est encore, si l’on en croit Pline, non seulement admirateur empressé, mais ardent ami de l’homme. À sa vue il s’arrête dans une espèce de ravissement pour le contempler, s’inquiète, accourt s’il le croit en danger ; et si par hasard autour de lui, pendant qu’il dort sur le gazon, il voit errer la couleuvre, tourne, s’agite, lui court sur le visage pour l’éveiller, de peur que l’insidieux reptile ne se glisse dans sa bouche… oh ! Généreux bienfaiteur d’un ingrat despote, tu fais bien de choisir ces instants de son sommeil pour satisfaire envers lui ton bon cœur ! Puisse ton zèle si pur n’avoir pour toi d’autre inconvénient que l’oubli ! Mais évite, au moins, fuis nos cruels enfants !
Mais admettra-t-on des faits de cette nature ? Un bel esprit n’est pas aujourd’hui prompt à croire plus qu’à s’attendrir. Faits, dira-t-on, controuvés, imaginaires, hasardés, tels qu’il s’en trouve plusieurs dans les deux célèbres naturalistes grecs et romains, même quelquefois dans le Pline français et qu’ils ne sont pas donné la peine de constater ; mais qui prouvent seulement dans les auteurs ou leurs copistes, sinon leur crédulité propre, au moins leur complaisance à flutter [sic] celle du vulgaire et son goût pour le merveilleux. Oh, sans doute il ne faut, au temps où nous sommes, que des vérités même géométriques ! Et nous avons enfin des connaissances si parfaites, des idées si claires des choses, que nous pouvons dire au juste ce qui se passe et comment, au fond des bois, au sein des mers et jusqu’au centre du globe ! Mais enfin (pardonnez moi d’être peuple [sic] encore à cet égard) toujours aimais-je mieux d’agréables mensonges et ces embellissements romanesques, que votre froide apathie et vos sophistiques fureurs.
S’ils sont en effet si différents de la réalité, ces beaux romans de la nature, à qui s’en prendre ? Il est bien vrai que, rebutés enfin de vos injustices, devenus, à force de perfidies, d’embouches, de surprises, de cruautés, ombrageux, farouches, inabordables, quelque fût d’ailleurs leur instinct primitif, la plupart de ces concitoyens qu’elle avait donnés sur la Terre, nous fuient et prennent soin de nous éviter avec une fugueur qui ressemble à de l’aversion : ils paraissent éprouver, à notre rencontre, je ne sais quelle horreur… je vous le demande, est-elle fondée ? Que ne leur en coûte-t-il pas s’ils osent se hasarder encore à s’approcher de nos habitations ? Ne feraient-ils pas bien mieux vraiment de se fier à nous ? Nous, qui les amorçons par mille appâts et mille caresses, pour les emprisonner ou les égorger ! Lesquels, je vous [27] prie, ou de ces animaux ennemis qui les mangent tout simplement quand ils sont pressés de la faim, ou de vous, hommes pitoyables, en détruisent davantage ? Vous qui les arrêtez dans vos pièges, les atteignez avec des flèches ou du plomb, leur coupez la gorge lorsqu’ils vous lèchent, les faites rôtir empalés dans une broche etc. vous dont la cruelle adresse a su réduire en art tous ces moyens de leur nuire ; et de cet art de les tromper, les tuer, les apprêter avez fait mille et mille métiers des plus importants !
J’entends déjà la réponse ordinaire : ce ne sont que des bêtes. Oui : et vous prouvez très bien que vous êtes des hommes ! Mais si les hommes étaient aussi faciles à duper ? S’ils se trouvaient aussi bien à votre discrétion ?… Je ne vous demande pas ce qu’il en arriverait, je vous prie seulement de songer un peu à ce qui se passe en certains pays ; et de nous expliquer, par exemple, les motifs de ce loyal commerce de je ne sais quelles bagatelles, couteaux, miroirs, aiguilles et autres de même valeur dont on leurre et marchande ce qu’on appelle des noirs !
Tout est donc permis contre les bêtes ? Mais ces sauvages, comme il nous plait de les appeler, et qui affectivement ne nous ressemblent guère, ces innombrables nations dont il reste à peine des vestiges qu’était ce donc, s’il vous plaît, et comment les qualifier ? Les animaux du Canada ont des fourrures : les peuples du Pérou, du Mexique ont de l’or : nous convoitons l’un et l’autre ; et pour nous satisfaire, ceux-ci comme ceux là seront sacrifiés : qu’il ne reste pas, s’il le faut, sur cette autre moitié du monde, un être vivant !
Le témoignage presque unanime de la plupart des voyageurs dans les pays inhabités prouve que ce n’est point par l’effet d’une antipathie naturelle, d’un instinct irrésistible, que le plus grand nombre des animaux s’éloigne ainsi de l’homme ; que nous seuls les avons rendus sauvages et farouches et leur avons enfin, par de cruelles leçons, appris à se défier de nous. Ceux qui ont traversé des vastes régions infréquentées, qui surtout ont osé aborder des îles désertes, y trouvaient si familiers les animaux les mieux pourvus de pieds agiles, ou même d’ailes pour nous échapper dans un élément où nous ne pouvons les suivre et qui s’en servent si bien dans l’ancien continent ; ceux enfin qui, chez nous, paraissent les plus fugitifs, tels que le lièvre, la perdrix, ou leurs pareils, ils les trouvaient, dis-je, si confiants, si tranquilles à la vue de l’homme, qu’ils ne songeaient aucunement à se soustraire, et se laissaient aisément approcher. Image, hélas, trop peu durable de ce beau temps qui sans doute pour eux était vraiment l’état de pure nature, comme il était pour l’homme l’état d’innocence ; ce bel âge, beaucoup plus précieux, il est vrai, que celui de l’or et du fer, où, rangés autour de leur roi clément alors et juste, lui formant un nombreux cortège, tous ses sujets dociles et charmés lui tenaient compagnie et ne songeaient pas plus à nuire qu’il n’y songeait lui-même ! Mais quel est le fruit de leur touchante sécurité dans ces paisibles Déserts ? L’homme, à la première fois qu’il en approche, l’homme y débarque avec lui l’injustice ; avec lui s’y répandent la désolation, le carnage et tous les fléaux… fuyez, malheureux, fuyez, hâtez-vous… [28] cette figure, qui vous arrête, cette figure imposante, vous est encore inconnue sans doute : et peut-être vous l’admirez ? En effet, il était formé pour mériter vos hommages et votre amour, mais prenez garde : sous ce front si doux et si noble est cachée trop souvent la noire perfidie !…
Hélas ! En effet le voyageur, dit-on, les assomma à ses pieds à coups de bâtons !…
Injustes humains, que gagnez-vous ? De combien au contraire d’agréments et de grandes utilités peut-être (vous pouvez en juger par quelques uns de ceux-mêmes que vous avez été forcés de subjuguer), de quels avantages vous ont privés vos fureurs ! Mais n’est ce pas déjà beaucoup, fût-ce le seul, d’y perdre une société sûre, douce, commode, facile à trouver, facile à cultiver, sans apprêts, sans manque, sans prétentions dont eussent été bannis les vices de la votre et qui ne vous en eut offert ni les chagrins ni les dangers ? S’il n’y a pas jusqu’aux animaux les plus féroces, le lion, la panthère[22] ,les serpents même, qui ne se montrent sensibles aux bienfaits comme aux injures ; qui n’aient plus d’une fois donné des preuves de la plus vive reconnaissance, du plus sincère attachement pour l’homme, que serait-ce [sic], s’ils pouvaient croire également, eux et tant d’autres de naturel moins âpre, moins fougueux, à sa bienveillance, à sa sincérité ? Si, par une constante expérience, ils s’étaient convaincus qu’ils pouvaient, sur son caractère et sa conduite, établir une solide confiance ?
Au lieu de cela qu’avez-vous fait ?… par votre despotisme exclusif et cruel, par votre noir machiavélisme, vous transformez votre riche domaine en un désert nu, monotone, muet, flétri par l’esclavage, désolé par vos ravages, séjour maudit, couvert de deuil, inondé de larmes et de sang, empire de douleurs et de destruction ! Vous seuls, prétendus rois de la nature, l’appauvrissez, la morcelez, vous la tuez !… Plus dissipateurs qu’elle n’est libérale, c’est par vous qu’elle est frappée de stérilité et de mort. Vous surtout qui, par système, pressés de jouir de votre éphémère et précaire empire, faites tout le contraire, lâches apologistes du néant, égoïstes, glacés, n’ayant que si peu de jours pour en user, vous en abusez. Selon vous, sans conséquences comme sans remords, condamnés par vos propres vœux au néant comme les Brutes, vraiment hommes de néant, qui n’êtes que fort peu au dessus d’elles, machines seulement un peu mieux organisées, à force de parler de matière et de néant, tristes raisonneurs, vous répandez en effet l’inertie et le néant sur toute la Création : c‘est alors que tout y devient ombre, chimère ; tout y devient indifférent, crime, vertu ; bienfait, injure ; ordre, confusion ; beauté, difformité ; meurtre ou naissance ; âmes, atomes ; immortalité, destruction !… Et qu’est-ce qu’un pareil Monde, digne seulement de ses architectes ? A votre voix sépulcrale tout rentre au cahot.
Et ne nous vantez pas, comme un nouveau droit de propriété, c’est-à-dire de Tyrannie, les soins intéressés que prodigue une industrieuse avarice à des victimes engraissées pour les supplices et la mort. Est-ce pour la brebis que vous cherchez des moyens d’embellir sa torson, que vous réchauffez ses tendres agneaux ? Pas plus que ce n’est pour lui que, de ses secours, le bœuf fertilise vos champs ; pas plus, que ce n’est pour l’intérêt de ses féconds et si chastes amours que vous préparez au pigeon ces [29] ces demeures commodes, où vous le nourrissez, aux dépenses de sa famille, dans une trompeuse abondance ; pas plus que le ver ne file pour lui sa soie, et que vous ne lui fournissez pour lui ses aliments : vous le soignez, il est vrai, jusqu’à sa mort apparente, ou plutôt son tombeau, et lui donner ensuite une mort réelle ; comme l’ingrat et parricide héritier, pressé d’envahir la succession de son bienfaiteur[23] ; vous ne l’avez fait éclore sous vos yeux, vous n’avez favorisé son développement et son travail que pour l’usurper et l’étouffer ensuite, lui et sa postérité, dans le germe de sa résurrection féconde ! Tel est le but et dernier résultat de tous vos soins pour les animaux qui s’y confient.
Mais si c’est en effet le vrai but de leur existence et l’intention de la Nature ? Elle-même ne semble-t-elle pas les livrer à la discrétion du plus fort ? La plupart d’entre eux ne vivent que de proie : le vautour, l’épervier dans les airs, le requin, le brochet dans les eaux, le lion, l’ours, l’hyène sur la terre et tant d’autres ne subsistent qu’aux dépens de leurs inférieurs ; tous, de la baleine à l’insecte s’entredévorent ; l’homme n’a-t-il pas, sur tout ce qui vit, des droits beaucoup plus réels ? Oui, c’est en effet ainsi que doivent raisonner le surin ou la tigre : laissez à de telles autorités une logique si concluante… Tu ne rougis pas, philosophe, de donner à l’homme de pareils modèles ? Au moins étoilent-ce des Dieux que se faisait l’idolâtre, pour autoriser par leurs exemples ses désordres. Quelques peuples en délire ont sacrifié même à des bêtes féroces. Mais pour les apaiser, non pour les imiter. Vous nous comptez les innombrables ennemis des faibles : où n’en ont-ils pas ? Mais c’est une raison de plus pour qu’ils trouvent, hommes sensibles, au moins en vous des protecteurs.
Voilà votre privilège vraiment royal, le rôle digne de vous [sic] ! Songez au moins à votre dignité d’homme ; et ne vous avilissez pas au-dessous de ces êtres, dont vous semblez faire si peu de cas ! Si l’aboutissement et les emportements de l’ivresse sont censés dégrader et déshonorer l’humanité, que dire des emportements de l’aveugle rage et de l’ivresse du sang ?
Mais des raisons de justice, d’ordre et de décence doivent-elles suffire ? Et ne serait-ce pas un peu trop exiger, de prétendre que vous dussiez vous en contenter, êtres raisonnables et justes par excellence, à qui, dit-on, sont essentiels l’amour de l’ordre, le sentiment des convenances, vous seuls capables des idées de l’honnête et du beau ! Ne faudrait-il pas pour vous persuader peut-être des motifs d’intérêt plus pressant ? L’intérêt public, l’intérêt des humains, façons de parler solennelles d’une certaine philosophie ! Grands mots, de certains hommes étrangement sensibles sur le papier, où leurs expansives affections embrassent en 4 syllabes toute l’humanité, mais au fond tendres uniquement pour-eux ! Eh ! Bien, souriez donc, sublimes esprits, forts en bien d’autres choses, souriez à nos puériles faiblesses pour les bêtes : mais sachez que c’est pour l’intérêt de la société que nous [30] réclamons ; que c’est en son nom, que nous demandons pour elles des égards ; que c’est votre intérêt propre, très prochain, très intime qui vous commande le respect pour leur vie.
Autrement, parlerait-on de Morale, de Lois, mettrait-on à la question proposée une si grande importance, s’il ne s’agissait de ceux mêmes à qui conviennent les lois et la morale, de vous, ô hommes, bien plus que des animaux ?
Oui, ce mépris de leur repos et de leur vie, ces déprédations du luxe, de la gourmandise, par qui s’avance avec une alarmante rapidité la réduction des espèces utiles, menacent le repos et l’existence des Sociétés, menacent l’univers d’une disette générale et prochaine, peut-être d’une dépopulation totale. Hommes sans frein et sans bornes, dans tes impatientes fantaisies, tu ne recevras que trop tôt peut-être le prix de ton intempérance et des folles dissipations de ta vanité !
Déjà le bœuf, en plus d’un endroit, manque au labourage. Dans vos palais somptueux, où, pour satisfaire à votre luxe progressif, l’or s’accumule en même proportion, et semble croître avec vos caprices en raison des besoins toujours croissants du peuple, vous vous apercevez encore assez peu de ce vide, mais quand le pain, fruit des secours de ce laborieux animal, et la chair, fruit de sa mort, commenceront à manquer à toutes les autres tables, sera-t-il temps de vous avertir que la vôtre ne tardera pas à avoir le même sort ?
Ces offices, fabriques de doux poissons, où se travaillent ces mélanges irritants, dangereux aiguillons d’un appétit trompeur, germes de maladies, assaisonnements de la mort ; ces ateliers d’assassinats, vrais sarcophages remplis de hideux lambeaux hachés, meurtris, sanglants, gouffres où s’absorbe en un jour la substance de peuples entiers ; vos cuisines enfin, hommes de plaisir, ou, pour parler plus juste, hommes de douleurs, vos cuisines, immenses tombeaux de la nature vivante, engloutissant successivement les espèces entières. Si la plus vigoureuse, et celle qui, par le nombre et la masse, devrait le plus résister à vos excès, commence elle-même à s’épuiser sensiblement, jusqu’à quand pourra-t-on nous garantir le maintien des autres ? Souffrez donc, il en est temps, souffrez qu’on songe aux moyens d’en conserver les restes.
De tous les temps, chez tous les peuples civilisés, on a regardé les lois somptuaires comme une des bases les plus importantes sur lesquelles reposent la tranquillité, le bonheur, la durée de l’association. Toujours on a cru fort essentiel de donner quelques entraves à la dévorante activité du luxe usurpateur de sa nature et qui, par son mouvement propre, va toujours croissant, du luxe nécessairement destructeur et corrupteur. Or, de toutes les passions qui le favorisent, l’intempérance n’est elle pas la plus corruptrice et la plus destructive ? Vous chargez [31] d’impôts et tâchez d’élever au prix le plus inaccessible certains objets de consommation plus rares et moins indispensables, dont souvent l’opinion fait le plus grand mérite, tels que les épiceries, liqueurs, soieries etc. ; c’est fort bien fait : de bonnes lois directes et positives feraient mieux peut-être ; des lois réglant, autant qu’il est possible, la nature des aliments, vêtements, meubles d’ornement ou d’usage, & ; en un mot le maximum des dépenses[24] permises à chaque classe de citoyens. Enfin, qui marquassent un terme fixe à l’espèce de vanité et de fantaisie propres à chacune. Car le plus simple bourgeois va, pour sa table privée, consommer, gâter, perdre autant de viande de boucherie, d’œuf, gibier, volaille, marée, qu’il lui plaira, bravant à son gré la misère publique, les murmures de l’indigence, ou de l’envie, sans d’ailleurs craindre aucune censure authentique si par supposition il n’existe pas de défense précise quoique dans le fond coupable de forfait majeure envers la société : et l’on n’osera faire à cet égard des lois répressives ?
Que de bœufs et moutons de plus égorgés au-delà du nécessaire, que de poulets détruits dans leurs germes, que de lapins, martres, hermines etc., pour fourrure et effets, parures superflues, pour souliers fins, pour des consommes[25] , des jus, des sauces etc. ! Mais l’extravagante fantaisie n’en reste pas là : connaît-elle des raisons ou des bornes ? Il est des goûts bizarres, goûts de vanité, plus que de sensibilité, friands (pour ainsi dire) du rare et du singulier plus que de maquis et du délicieux ; et ceux là vont bien plus loin encore, leurs dégâts sont bien plus étendus, leurs ravages plus rapides toujours prompts à contrarier ou corrompre ceux de la simple nature, l’imagination nous en impose au point de substituer la fide et le détestable acheté plus cher à l’excellent, commun [sic] précisément parce qu’il est salutaire. L’ostentation est surtout, alors, ce qui pique notre ambitieuse convoitise. On a vu d’inutiles mais superbes cadavres destinés uniquement à décorer la table de ces romains qui, après avoir atteint dans tous les genres le grand et le sublime, voulant toujours aller en avant, poursuivent enfin l’extraordinaire et le gigantesque. Ton plumage, superbe oiseau, enrichi de toutes les couleurs d’Iris, ne te défendra pas ; ni ta voix, chantre aimable des forêts, n’attendrira pas ces voluptueux cruels !… Qu’un Paon vienne étaler sur un plat, pour l’appétit des yeux, sa poitrine orgueilleuse, son aigrette, sa queue étincelante, ce n’est qu’un bel individu, et seul, immolé sans nécessité : mais que, pour composer un plat dont l’assaisonnement le plus flotteur est l’idée d’une grande destruction[26] ,
on se soit avisé de ramasser des langues de paons ! Et bien pis encore ! Des langues de cet oiseau sans beauté, sans saveur, dont l’unique mérite, mais en effet très supérieur, est dans la langue, que ces langues destinées au plaisir d’un sens bien différent de celui du goût, ces langues, organes si variés, si brillants des plus mélodieux concerts, on les arrache à mille Philomèles, pour offrir au palais blasé d’un Crassus imbécile un morceau neuf encore, qui ne peut avoir d’autre sel que le plaisir malin d’avoir pu d’un mot faire taire mille voix, [32] charmantes[27] , c’est ce qu’on ne pourrait croire, si l’on ne savait que lorsqu’une fois la dépravation des mœurs est venue à bout d’effacer ou pervertir les idées saines, il ne reste plus de point fixes auxquels elle puisse s’arrêter, rien de monstrueux qu’elle ne puisse en farter ? Mais, pour trouver de pareils exemples, il n’est pas même besoin de remonter à ces Romains à qui rien ne rassemble et que nous devrions essayer de copier sans doute en toute autre chose, s’ils étaient imitables. J’ai moi-même assisté à des repas, où certaines assiettes, très légers entremets, prouvaient aux convives, que pour leur en présenter à chacun une mince bouchée il avait fallu mutiler les crêtes, ou même des morceaux plus tentateurs encore… au goût de certaines gens !
Cependant, à ne considérer en de pareils abus que l’énorme excédent de consommation qu’ils supposent, il est très facile à démontrer que ces pertes entraînent (ce pourtant à quoi l’on ne songe guère) et nécessitent par suite inévitable l’appauvrissement successif, enfin la dépopulation et la ruine de l’espèce humaine elle-même. Car si, par votre prodigalité vorace, par votre luxe extravagant et sans pudeur, vous absorbez tous les moyens de subsistance plus vite qu’ils ne peuvent se réparer, il est nécessaire que les individus existants diminuent en même proportion ; il n’est plus de balance entre le renouvellement et l’épuisement ; et la Nature court à sa ruine.
Ce n’est pas d’aujourd’hui seulement que l’on observe que la population d’un pays est toujours en raison de son produit, ou de la consommation à laquelle il peut fournir : lors donc qu’elle excède de plus en plus les ressources, que doivent devenir les consommateurs ? Les produits ne suffisant plus, on vit quelque temps sur les capitaux : chaque jour en morcelle et retranche quelque chose ; enfin, ils sont eux-mêmes dévorés : réduite à une indigence absolue, il faut que la société périsse.
Oserais-je vous avertir, indolents sybarites, que les premiers pas vers cette effrayante catastrophe sont faits ; que vous seuls avez donné le branle à la masse entière ; et que si vous ne vous réveillez de votre ivresse dans les bras de la volupté, si vous ne vous retenez dans la pente rapide qui vous entraîne et nous à votre suite, nous roulons tous ensemble dans un abyme plus profond que celui d’où tant de prodiges nous ont à peine tirés ? Car, tandis qu’au poids de l’or les dignes émissaires et nobles pourvoyeurs de votre gourmandise, bouchers, rôtisseurs, pâtissiers etc., vont enlevant de tous côtés dans les campagnes les troupeaux fécondateurs et tous les aides vigoureux de l’agriculture, les matières de vos délices vont aussi, comme de raison, toujours diminuant, et toujours enchérissant pour le Peuple. Vous, il est vrai, toujours comptant sur vos trésors, ne vous en inquiétez en aucune manière : c’est un soin que vous laissez à vos intendants. Mais que la charrue vienne à manquer enfin des leviers nécessaires, les bras de vos élégants maîtres d’hôtels ou les vôtres, convives délicats des sillons, ces bras énervés y suppléeront-ils ? Ceux de ces robustes et patients villageois, accoutumés à se sacrifier pour vos jouissances, s’excéderont aussi bientôt eux-mêmes à des travaux sans relâche et pour lesquels ils n’auront plus de secours. La peine doublera ; leur force et leur nombre s’affaibliront tous les jours [33] par la fatigue et le besoin : alors, qui fera les frais de ces tables somptueuses dont vous ne pouvez plus vous passer ? Affamés auprès de votre superbe vaisselle, malheureux Midas, y vivrez-vous de votre or ? Vos jouissances anticipées, exclusives, finiront par des privations absolues et sans remède qui ne seraient que justes, il est vrai, si seuls vous en deviez souffrir ; mais c’est la Patrie qui surtout est punie de vos désordres : votre châtiment est joint à sa ruine ; et, causes premières, uniques, de la calamité générale, vous n’en serez peut-être encore que les dernières, comme les moindres victimes.
Gourmands assassins de vous-mêmes et de la société, il ne faudrait, pour vous corriger et vous rebouter de vos dégoutants excès, qu’en voir en nature la matière première : entrez un moment dans vos cuisines : et si la sensualité vous laisse encore quelque sensibilité, soutenez, s’il se peut, le hideux spectacle de tous ces meurtres s’agréablement déguisés sur vos tables !… Là[28] , un faible agneau est poursuivi, assumé lentement à coups de bâtons : ainsi battue et mortifiée sa chair (prétend votre habile cuisinier) en sera plus molle et plus délicate ! Ici, sous le fer qui la coupe en tronçon frémit la Carpe vive : plus loin, précipitée dans l’eau bouillante s’agite pêle-mêle un peuple d’écrevisses ; tandis qu’écorchée et jetée dans la Peule, l’Anguille y bandit encore : ainsi les chairs vives étant saisies tout-à-coup et comprimées par l’action du fluide brulant, l’évaporation des esprits et la perte de sels précieux en seront moins considérables ! Oh ! Qu’un peu de physique est utile en tout ! Près de là, devant le foyer, une oie vivante, enchaînée, présente au brasier[29] ardent sa poitrine tendue : ainsi dilaté par la raréfaction de l’air, gonflé par la douleur, le foie va s’amollir, s’étendre et figurer plus noblement sur un plat, dont il pourra seul couvrir la capacité !… Et ce sont là vos délices grand Dieu ! Et, quand vous avez de pareils morceaux, vous ne les entendez pas gémir dans votre sein ?
Je me souviens, non sans frémissement, du récit d’un homme qui me peignait avec transport ses plaisirs et sa méthode, quand il voulait manger un poulet. Vivant, il le saisissait par les pieds et les ailes, et tirant de droite et gauche, le déchirait !… ainsi, me disait-il, écartelée et plumée toute chaude, la volaille expirante pouvait être accommodée et servie sur le champ : parcourue par le frisement de la douleur la chair en était infiniment plus tendre, plus succulente et, mise en fricassée[30] , lui donnait un festin de roi ! Et ce savant gourmet c’était (le croirait-on ?) un médecin, un Encyclopédiste ! Quoi, sage du 18e siècle, voilà votre humanité ! Docteurs, voilà votre science ? Est-ce donc à vous d’ignorer l’effet des passions vives sur la masse des humeurs ? Toutes n’ont-elles pas un venin plus ou moins actif, plus ou moins corrosif, qui pénètre dans la masse du sang, dénature les fluides et cause dans l’économie animale plus ou moins de désordre ; grâce à votre invention nouvelle, l’effet que vous avez produit sur le corps supplicié passe dans vos veines : le châtiment suit de près l’action ; avec le sang fermenté par la fièvre que doit causer l’excès d’une horrible souffrance, vous vous incorporez cette espèce de rage ; et (juste vengeance de la nature !), dans vos meurtrières délices, vous trouvez la mort ! Puisse, malheureux, votre sensualité bizarre, puisse votre goût atroce exalté sans cesse par la réparation des actes et l’irritation des organes, ne jamais devenir l’appétit des Terrées, des Atrées, la faim du Tigre !
[34] Il est triste d’être forcé de remarquer que ce n’est pas précisément dans ces siècles appelés de barbarie, que les hommes sont le plus odieusement et le plus froidement cruels. C’est dans l’un de ces temps et chez l’un de ces Peuples, où l’on se piquait en tous genres des raffinements de la plus exquise délicatesse, qu’un de ces arbitres du bon goût, Arbiter elegantiarum, ayant à sa table le maître du monde, lui servait galamment de ces poissons engraissés dans ses viviers de la chair des esclaves qu’il y faisait jeter !
C’est à la fin de ce siècle voluptueux commencé par la Régence, continué sous Luis XV, qu’on a vu des voluptés neuves, des débauches à la fois de plaisir et de sang. Ils avaient imaginé bien d’autres assaisonnements à leurs festins que ceux usités jusqu’alors, ces novateurs inventifs en tant d’autres choses, ces hommes à qui, jusque dans leurs joyeux banquets, il fallait une guillotine, ou moins en miniature, proportionnée à la mesure de l’animal, dont ils se ménageaient d’abord le plaisir d’abattre, sous leurs yeux et de leurs propres mains, la tête ! À l’aide de cet ingénieux emblème doublant leur volupté, ils savouraient, en idée et par réminiscence, la chair humaine, tout en mangeant une aile de poulet. On n’oubliait rien pour réunir à cette table toutes les jouissances analogues : elle était dressée, autant qu’il se pouvait, en face d’un échafaud ; et, pour l’honneur de l’égalité, l’un d’eux avait soin d’y faire asseoir à ses côtés le bourreau son confrère : c’est alors que la fière épouse du proconsul demandait gracieusement à l’aimable convive combien pour le lendemain, il lui fournirait de Têtes de veaux ! Pardonnez, lecteur, mais vous le voyez : les unes, à certains hommes, ne coutent pas plus que les autres !
Non, ce n’est plus par superstition (ne nous le reprochez plus, philosophes) que nous sommes cruels : ce n’est plus en l’honneur du Ciel que nous verserons le sang : mais nous le sommes, et bien autrement, par égoïsme : c’est à nous-mêmes que nous l’offrons, ce sang ; nous le buvons ! Nous le sommes, par suite de notre corruption extrême, de nos habitudes et goûts dépravés, de nos besoins factices d’autant plus exigeants qu’ils sont plus bizarres, par suite de nos vices monstrueux, car tout vice est essentiellement, souverainement égoïste ; tout vice est une idolâtrie exclusive qui se sacrifie tout. Nous le sommes envers les animaux tout à la fois par mollesse et par dureté (car rien de moins incompatible) ; envers les hommes par cupidité, par impiété. Jamais le sombre fanatisme des Adorateurs de Moloch, de Teutatès, ou des Dieux du Mexique n’arrosa de tant de sang leurs Autels, qu’en a répandu l’athéisme dans le plus beau siècle et chez la nation du monde la plus polie. Non, nous n’irons plus, par l’organe d’un prêtre, dans le cœur palpitant d’une brebis, d’un enfant, consulter les Dieux ; mais en haine des Dieux, on ira dans le cœur du prêtre même, étendre, s’il se peut, la mémoire et l’idée de la divinité qu’il annonce !
Sans multiplier les observations et les faits de cette [35] nature, que j’eusse bien voulu épargner à mes lecteurs, si je l’eusse pu sans affaiblir ma cause, il n’est que trop évident, je crois, que la cruauté envers les Animaux tient de très près à celle envers les homme ; que non seulement l’une est un préparatif à l’autre, mais qu’elles vont de pair et se rencontrent presque toujours dans les mêmes individus et les mêmes circonstances ; que par conséquent, sous le rapport de la morale publique, la première doit être regardée au moins comme un apprentissage d’inhumanité et comme telle classée sous ce titre dans le Code criminel, ainsi qu’une des espèces sous le genre commun et parmi les délits contre la société.
Par ces actes de cruauté répétés sur les animaux, cette précieuse sensibilité qui fait tant de biens, empêche tant de maux, s’émousse, s’affaiblit par degrés et s’évapore enfin entièrement. Cette tendre pitié, principe conservateur des Sociétés, lien secret de tous les êtres qui s’identifie à toutes leurs affections ; ce ressentiment de douleur inévitable qui se gagne et se communique à la seule vue de la douleur d’autrui ; loi admirable de la nature[31] ,
Oui, indépendamment de la raison et avant toute réflexion, nous fait voler à l’être souffrant par un mouvement indélibéré aussi prompt que celui par lequel nous évitons nous-mêmes le coup dont nous sommes menacés ; ce précieux et secourable instinct perd insensiblement de son énergie : bientôt ce rapide ressort, qui se détendait aussitôt au moindre signe de souffrance étrangère, devient plus lent, plus faible, enfin même cesse d’agir ; ce qui coûtait d’abord devient facile et familier ; il ne faut plus qu’un mince intérêt, un léger mouvement de passion pour vous emporter à l’autre extrême, et vous faire aimer, désirer ce que vous eussiez auparavant abhorré. Dès qu’on peut voir de sang froid couler le sang, on est déjà bien loin ; on n’est plus physiquement (pour ainsi parler) et machinalement bon. Cet heureux tempérament, qui vous suggérait le bien et vous sauvait de l’injustice, ne domine plus ; il n’y a plus qu’un pas, pour devenir moralement et de propos délibéré méchant.
C’est ainsi que la barbarie envers l’animal est un degré pour aller jusqu’à l’homme[32] , degré même prochain. Tremper ses mains dans le sang de son semblable présente une image si révoltante, que l’horreur en paraît d’abord insurmontable. Il faut bien de l’exercice pour atteindre jusque-là ! Il faut s’être essayé longtemps sur des êtres sensibles, plus éloignés de notre nature, et s’être accoutumé par degrés à résister aux répugnances involontaires de la sensibilité.
Il n’est que les animaux carnassiers, et parmi ceux-là même un très petit nombre, et cela dans des circonstances très rares, telles qu’une extrême faim, une jalousie furieuse, etc., qui puissent se porter à détruire leurs semblables. Dans l’homme, cet instinct de sensibilité plus vif, plus raisonné, plus érudit, doit être aussi, par conséquent, infiniment plus impérieux, plus irrésistible, et cela de toute la distance qu’il y a de lui à ces monstres féroces. Comment donc concevoir qu’il ait pu se résoudre à lever sur son semblable un bras homicide, à moins d’avoir par des essais fréquents et répétés préludé longtemps à ce dernier effort et s’être acquis enfin une malheureuse facilité à vaincre en cela la nature ?
[36] Je serais assez porté à croire que ce fut là un des plus grands traits de différence entre le premier homicide, ce farouche coin maudit du Ciel et cet Abel si doux, objet de sa jalousie, parce qu’il l’était des complaisances de leur Maître commun. Je me figure ce dernier naturellement tendre et sensible ne donnant qu’avec grand regret la mort aux innocentes créatures qu’il avait nourries, et ne les sacrifiant au dieu qui les lui donnait et les multipliait autour de lui, que comme une preuve de son absolu dévouement ; ce qui même augmentait d’autant plus le mérite du sacrifice qu’il était plus coûteux et plus pénible : comme il s’efforçait comme il combattait, comme il gémissait ! Comme il s’efforçait de racheter par les plus riches offrandes de ses moissons et de ses plus beaux fruits, la vie de quelques uns de ces chers compagnons ! Il me semble au contraire voir l’autre toujours possédé du Démon de l’envie, de la rage et du désespoir, versant sur tout ce qui l’entourait le fiel dont il était dévoré, assouvir longtemps sur ces pauvres animaux les sentiments haineux et colères contre cet aimable frère. Ne respectant que malveillance, est-il étonnant qu’il parût haï, mal voulu de toute la Nature ?
Ses troupeaux maigres, languissants, peu nombreux, ne réussissent pas : le pouvaient-ils, sous ce maître avare atrabilaire ? La terre ne répond point à ses efforts : je le crois, mais sans doute ces premières gouttes de sang humain, si fécondes depuis en crimes, en douleurs, sans doute jamais elle ne les eut bues, cette Terre effrayée, si, longtemps avant, elle n’eut fumé, sous le poignard de la fureur, du sang des animaux !
Mais sans aller, depuis cette fatale époque, parcourir à travers les continents et les siècles toutes les traces sanglantes, tous les funestes effets de ce germe colérique[33] du cœur de l’homme, lorsqu’il est développé, activé, nourri par l’exercice, mis en jeu par les passions, je m’arrête sur une partie du globe, qui me fournit un exemple trop frappant et trop analogue à mon sujet ; et je demande, qu’est-ce qui a dépeuplé l’Amérique ? Le même principe qui a fait disparaître plusieurs espèces d’animaux, dont il ne reste aucune trace ou tout au plus quelques individus épars, inaccessibles ; le même qui a rendu si impitoyables dans ces contrées les chasseurs du castor, que bientôt on regardera comme une fable leur existence et celle de quelques autres trop précieux pour leur malheur, ainsi que l’histoire et les merveilles de leur industrie ; ce même principe, l’insatiable cupidité n’a-t-il pas fait poursuivre avec le même acharnement les hommes qui peuplaient ces vastes régions, où l’on peut faire aujourd’hui 4 ou 500 lianes sans en rencontrer un seul. Que la passion commande et que pour la satisfaire il faille un sang ou l’autre, qu’il faille saccager les cités des Incas, ou celles des castors, égorger par millions les habitants des unes ou des autres, il n’en coutera pas davantage ; c’est ainsi que les premiers conquérants de l’Amérique sont devenus chasseurs aux hommes : ils avaient dressé des chiens exprès pour cette espèce de gibier ; et, comme nous leur abandonnons le cerf abattu, ils leur donnaient en carrée, ce qu’ils appelaient un sauvage. C’est ainsi qu’ils [37] ont détruit jusqu’aux vestiges d’immenses et d’innombrables nations, ou par une longue suite de guerres à mort pour s’approprier sans retour leur territoire ; ou par les travaux des mines et tous les tourments du plus dur esclavage pour profiter de leurs secours, et, sans travail, aux dépens de la vie de ces malheureux, exploiter des richesses qu’ils méprisaient eux-mêmes et cédaient si volontiers à leurs vainqueurs. Car ceux-ci ne seront pas plus avares de leurs souffrances que de leur sang, si l’intérêt l’exige encore : ô de l’infortuné Montezuma ministre bien plus malheureux, tu seras, s’ils ont faim de son or, généreux Guatimozin, tu seras aussi sur les charbons ardents, rôti comme nos poulets.
Puis, pour justifier ces abominations, leurs sophistes assassins prouveront que les habitants du nouveau Monde ne sont pas des hommes, et n’ont avec nous de commun que la figure !
Pour nous, dont les écrivains philosophes les ont si souvent et si complètement vengés, nous, bien plus humains (sans doute !), ne donnons pas dans l’excès opposé et n’allons pas, avec certains observateurs profonds, par intérêt en apparence pour les animaux, par mépris en effet pour l’homme, les élever jusqu’à lui ; des singes, des Pungos, faire des hommes, pour le ravaler lui-même à la condition des brutes. Mais plutôt, par respect pour sa supériorité, apprenons-lui à se respecter lui-même dans ses relations avec eux ; à sentir assez sa dignité, pour ne point la dégrader par d’indignes emportements contre des êtres qui sont si fort au-dessous de lui, et sur lesquelles il a tant d’avantages ; avantages qu’il ne doit qu’à son intelligence, dont la justice fait partie essentielle, et qu’il lui convient par conséquent de mériter par la sagesse et l’équité de sa conduite envers eux.
Car si les animaux partageaient avec leurs tyrans le dangereux privilège de la raison, s’ils usaient des lumières et des secours qu’elle peut fournir pour se liguer contre l’ennemi commun, que deviendrait bientôt l’espèce humaine ? Quoi donc ? Cette faculté par laquelle nous leur sommes si supérieurs et devrions l’être surtout en douceur et modération, sera-ce donc elle, cette raison-là même, qui nous rendra les plus féroces, les plus intraitables et les plus destructeurs des êtres vivants ?
C’est dès la première enfance qu’il faudrait l’instruire et la plier, cette Raison naissante, à des habitudes douces, l’exercer à la clémence, ô la générosité ; c’est dès lors qu’il faudrait s’emparer du cœur de l’homme, le façonner, le repétrir, pour ainsi dire ; s’attacher à ramollir ce que des divers alliages qui le composent il peut avoir de trop âpre et trop rude, surtout cet orgueil que fomentent de fausses idées d’empire, pour l’imprégner d’affections nobles et tendres, en tourner la précieuse sensibilité vers la compassion, l’indulgence, fortifier en un mot son aversion naturelle pour tous spectacles, tous actes d’injustice et de méchanceté, et lui bien intimer par ses propres épreuves le prix et le charme de la bienfaisance.
Il est à cet âge mille actions prétendues indifférentes que les parents regardent comme purement physiques, comme des jeux innocents, et qui ne sont rien moins que cela. Je souffre cruellement de voir entre les mains d’un marmot un pauvre animal, un faible oiseau [38] en vain criant, se débattant ; un insecte déchiqueté pièce à pièce ; infatigablement et sans relâche tourmentés jusqu’à ce qu’ils expirent, ce que l’enfant au reste n’avait aucunement prévu ; car pour lui, il ne voit, il ne sent rien encore de ce que j’éprouve à cette vue ; il ne s’en doute même pas ; il ne voit dans son Moineau qu’un hochet, dans ses agitations convulsives que du mouvement qui plait à sa vivacité ; en lui-même et dans son action, que l’exercice de son pouvoir absolu, dont il est d’autant plus flatté que la sphère en est plus étroite et l’usage plus rare. Ainsi donc alors ses cruautés irréfléchies et matérielles ne sont encore que des essais de ses forces ; des épreuves suggérées par la curiosité ; et dont il devine si peu le résultat, qu’il en sera probablement tout le premier désolé, quand il se verra, par sa propre faute privé de la petite société qui lui convenait si bien. Ce n’est point encore là de l’inhumanité ; mais seulement l’inaction ou le sommeil d’une sensibilité, qui dans la virtuelle, pour ainsi dire, et passive, n’est pas encore veillée, développée par sa propre expérience. Les importunités, les tourments qu’il cause, il ne les a pas endurés lui-même ; il ne sait pas assez ce que c’est que souffrir ; il n’a nulle idée de la mort, presque point de la douleur, qu’il ne connaît que par quelques sensations rapides, qui ne laissent aucune trace et n’ont produit encore aucune comparaison.
Non, ce n’est pas votre enfant, pères insoucieux[34] , c’est vous, qui êtes injustes et barbares : et ne dites pas : « ce ne sont là que des enfantillages et c’est là ». Pourrait à meilleur droit vous répliquer un instituteur éclairé, c’est une de vos sottises, et l’une des plus funestes à l’humanité on en a des preuves récentes[35] . Ignorez-vous qu’il n’est rien d’indifférent à cet âge et qu’elle est l’étendue du précepte : maxima debetur puero reverentia ? Un geste alors, un mot peuvent avoir les plus funestes conséquences par cela même qu’on n’en sent point encore les conséquences. Rien, assurément, n’intéresse de plus près la société que les soins des pères pour leurs enfants et les moindres détails de leur éducation ; rien n’importe davantage que les premières impressions et la tournure qu’alors on leur laissera prendre. Vous avancez à votre terme : vos erreurs et vos vices, si vous les renfermez en vous seuls et n’avez point la maladresse ou la fureur de les provigner dans vos enfants, vont avec vous s‘ensevelir dans le tombeau ; mais à votre ombre et sous vos ailes croît et s’élève la génération suivante ; vous avez entre vos mains le germe et le moule de leurs vertus, de leur bonheur et malheur pour bien des siècles peut-être ! Ils ne seront que ce que vous aurez fait de vos enfants : tremblez donc, chargés d’un dépôt si saint ! Il ne faut qu’une légère inadvertance, un coup d’œil indiscret pour le violer et tout perdre…
Ce que vous pouvez tenir pour certain, c’est qu’il n’est pas de maxime plus pernicieuse, que de croire pouvoir abandonner l’enfant à tous ses petits caprices tyranniques, avec cet absurde prétexte : ce n’est qu’un enfant. Plaise au ciel (vous m’en arracheriez le vœu), oui, plaise au ciel, que tel que vous le faites ou le laissez être, il ne devienne jamais homme ! Car si ses inclinations enfantines grandissent et se fortifient avec l’âge, je plains ceux qui prendront autour de lui la place du petit moineau !
[39] Vous n’autoriserez jamais en lui la rudesse, les manières dures, grossières, impérieuses envers les autres hommes, je le veux croire. Vous ne lui pardonnerez jamais une impolitesse envers les honnêtes gens ! Pour cela j’en suis convaincu ; et je puis m’en fier à votre vanité. Mais envers les animaux, pensez-vous pouvoir sans inconvenance lui tout permettre ? Ce serait une erreur grossière : et puisse-t-il ne jamais vous en punir vous-mêmes ! J’oserais vous soutenir que vos inattentions à cet égard, vos imprudentes négligences, vos indiscrètes complaisances (disons tout), vos exemples peut-être sont aussi préjudiciables, je dirais presque aussi coupables que maladroits. Oui, je crains fort que ces duretés et mépris habituels, ces cris, ces éclats, ces coups frappés sans raison, et toutes ces brusqueries fantasques dont les enfants sont témoins, n’agissent sur eux, comme l’objet sur le miroir, comme le cachet sur la cire ; et ne les accoutume à manier et mener de même tout ce qui les entoure, surtout ceux que l’on a grand soin de leur apprendre de bonne heure à regarder comme leurs inferieurs. Car l’enfance, à proprement parler, n’a aucune manière de voir, aucune façon d’agir déterminée, qui vienne d’elle, et soit véritablement à elle ; elle n’a rien que d’emprunt et par imitation ; elle pense comme ceux qui l’environnent, et fait ce qu’elle leur voit faire ; c’est de nous seuls que l’enfant apprend à mépriser, craindre, haïr certains objets, pour lesquels d’ailleurs, à n’écouter que la Nature, il se sentirait de l’affection peut-être et de la bienveillance. C’est par imitation encore plus que par inexpérience qu’il les fuit, les poursuit, les maltraite : il ne battra pas plus le chien de la maison que sa nourrice, avant qu’on ne lui en ait imprudemment suggéré la fantaisie ; et ne frémira pas plus à la vue d’une araignée qu’à l’arrivée du précepteur avant qu’on ne lui ait sottement fait peur de l’un ou de l’autre. C’est pitié de voir de niais amuseurs leur mettre un bâton, une pierre à la main, et les exciter : frappe celui-ci, jette à celui-là, moque-toi d’un tel etc… et l’on ne fait pas attention que ce qui pour nous, graves personnages, n’est que pure singerie, est le plus souvent pris au sérieux par l’enfant moins badin et plus réfléchi peut-être que ses meneurs ; car tandis que tout est de notre part mines et mensonges, tout est de la sienne franchise et vérité. Du reste, on voit que cet âge naïf aime et recherche les animaux, en prend de tendres soins ; et la conquête d’un nid d’oiseaux est pour lui de plus grande importance peut-être que pour un souverain celle d’un empire.
Il ne sait pas d’ailleurs encore faire une distinction précise entre l’Animal homme et l’Animal brute, il ne peut avoir de toute abstraction des idées nettes et claires ; et certes on peut lui pardonner de ne pas concevoir encore ce que c’est que l’être intelligent, et l’être purement sensitif, quand de très grands philosophes affectent de les confondre ! L’un comme l’autre ne sont tout au plus à ses yeux d’abord que des machines animées, organisées, mouvantes. Ainsi fait, à votre exemple, à se jouer des souffrances et de la vie d’êtres alors beaucoup plus rapprochés de lui et ses premiers camarades, comment un jour traitera-t-il des êtres [40] qu’il croira homme fait à une distance de lui beaucoup plus grande que ne l’étaient autrefois ces premiers amis de son enfance, je veux dire, ce qu’il aura de vous appris à nommer ses valets, ses gens ?... celui qui, dans ses loisirs solitaires, s’amusait à mutiler des insectes, comment dans le Sénat et sur le Trône du monde disposait-il des hommes ? Las d’enfiler des mouches dans son cabinet, ou de brûler des papillons à la chandelle, le Tyran adulte empalera des Chrétiens, ou les corps enduits de poux les fera servir de fanaux aux portes de ses palais ; et finira par regretter de ne pouvoir, en une seule tête et sous un seul coup de hache, réunir l’espèce humaine entière !... Croyez-vous que Sénèque, ou Burrhus eussent ri, comme vous, de ses premières espiègleries ? Hâtez-vous, coupez les racines : ce germe funeste se développerait, s’étendrait avec les forces : et bientôt Frère, Mère, Sœur, Ami, Précepteur pourraient avoir le sort de Germanicus et d’Agrippine.
A côté de l’éducation de vos Enfants, oserai-je vous parler de celle des Animaux ? Car ils ont aussi la leur. Peut-être l’intérêt de vos plaisirs ou de la cupidité me le fera-t-il pardonner : car il n’est pas rare de trouver certains hommes occupés de leurs meutes, de leurs chevaux ou leurs bœufs plus que de leur famille. Or assurément il ne serait pas difficile de vous prouver, si c’était ici un traité d’économie rurale et le lieu d’entrer dans des détails à ce sujet, que votre conduite, je dis même morale, envers les animaux n’est point du tout indifférente à leur conservation, leur propagation, leur perfectionnement. Si par des traitements avares, injustes, déraisonnables on ne détruit pas entièrement les espèces, on les altère au moins, on les déprave et les fait dégénérer ; et s’il est reconnu qu’une éducation convenable vient à bout de les perfectionner, il est très naturel d’en conclure que la mauvaise ne peut que les abâtardir et les abrutir davantage. Susceptibles aussi d’imitation, la continuelle expérience de notre dureté rend mutins, indociles, farouches ceux même qui, de leur nature, sont les plus doux et les plus maniables. Ils semblent même la plupart, par une espèce de moralité et comme s’ils avaient quelques notions du juste et de l’injuste, susceptibles de ressentiment comme de reconnaissance, n’oublier de longtemps le souvenir du bien ou du mal qu’on leur a fait[36] : plusieurs traits fort connus, anciens ou modernes, le prouvent. On les voit souvent sécher, maigrir de dépit et du chagrin causé par de mauvais traitements, comme de regret et de douleur du changement d’une condition bonne pour une plus dure. Il est plusieurs exemples d’éléphants morts de honte ou de chagrin pour un passe-droit ; entr’autres d’un éléphant d’Antiochos, accoutumé de le porter lui-même, et comme tel chef de brigade ayant le pas sur tous ceux de la suite du Prince. Un jour, sous la charge ordinaire, il refusa de passer une rivière ; pour l’en punir, on lui ôta sa préséance et l’on en mit un autre à son poste. Il fut si sensible à cet affront, qu’en vain par la suite, à force de caresses, on essaya de dédommager. Toutes les réparations furent inutiles ; il s’obstina à refuser toute nourriture, tous bons [41] offices, et se laissa consommer de désespoir, le chien irrité par les rebuts et les querelles devient plus hargneux, plus querelleur, et se résout même quelquefois à fuir enfin pour aller chercher quelque autre fortune, ou du moins attendre plus doucement, sous quelque buisson écarté, dans quelque antre paisible, la fin de ses misères. Je ne rappellerai pas les autres inconvénients qui s’ensuivent, et l’horrible maladie dont laquelle si souvent, chez ce trop sensible animal[37] et l’un des plus malheureux parce qu’il a le plus de rapports avec l’homme, se résout la fièvre du chagrin ; car il en est (j’ose l’affirmer) plus fréquemment la cause que le besoin.
Voyez ces malheureux squelettes, épuisés de jeûnes, le dos, la croupe et les flancs rongés d’ulcères, les jambes raidies de fatigue et de maigreur, haletant jour et nuit sous le poids d’un massif carrosse que de quartiers en quartiers ils traînent sans repos sur le pavé de la capitale et sous le fouet impitoyable d’un grossier mercenaire plus stupide qu’eux, roués de coups jusqu’à leur dernier soupir ! S’il n’est rien de plus superbe qu’un fier coursier, qui sous un héros bondissant de plaisir et d’orgueil, vole à sa voix, au soin des trompettes, à travers mille dangers et semble d’avance présager et partager le triomphe de son maître, est-il rien au contraire de plus hideux que ces Chevaux de fiacre, dont le nom est passé en proverbe ? Est-il rien de plus dur, de plus revêche, de plus inflexible ? C’est de leurs conducteurs qu’ils semblent prendre un surcroît de brutalité qu’ils n’auraient pas d’eux-mêmes. Quelquefois même (et les exemples en sont beaucoup plus rares que des mauvais maîtres) ces tristes esclaves deviennent enfin traîtres et vindicatifs, il s’en trouve qui laissent dans le danger ou même y précipitent le guide cruel, qui, au lieu d’encourager et d’aider leurs efforts, ne veut s’en tirer qu’à coups de bâton. Tel animal, poussé à bout par l’injustice, risque tout ; il aimera mieux périr qu’obéir ; troublé d’ailleurs par l’indignation et l’effroi, par les cris et les fureurs capricieuses de son aveugle tyran qui ne se possède plus, le pauvre serviteur n’entend plus : et qu’a-t-il à perdre ? Le néant vaut mieux qu’une existence qui n’est toute que de douleur.
C’est pour eux au reste à peu prés le même principe que pour nos enfants, s’en faire aimer et craindre, mais le premier surtout ; car ce moyen, bien plus que la force, captive toute la Nature ; et leur instinct naïf et droit en abusera moins que notre sophistique raison. S’ils n’aiment pas le maître, appliqueront-ils volontiers leur attention à ce qu’il voudra leur enseigner ? Pour faire avec zèle ce que vous désirez d’eux, il faut qu’ils s’y plaisent. S’ils n’aiment pas leur condition, y prospéreront-ils ? Les Indiens, les Arabes, les Hottentots même, selon Buffon, nous donnent à cet égard des leçons précieuses, à nous autres humains français. Chez eux, dit-il, soignés, caressés, pensés trouvant toujours une[38] nourriture abondante et choisie, les bœufs y paraissent être d’autre nature que les nôtres, qui ne nous connaissent que par nos mauvais traitements ; l’aiguillon, le bâton, la disette les rendent stupides, récalcitrants et faibles.
J’ai déjà parlé de l’Helvétie : je ne sais quel [42] enchantement reporte sans cesse vers ces heureuses vallées ceux qui les ont une fois connues. C’est le pays où les pasteurs sont le plus honorés, justice qui leur est bien due puisque c’est celui où ils sont les plus doux, les plus tendres, les plus soigneux[39] ; où ils connaissent mieux leur devoir et le chérissent davantage, le devoir des rois, celui de n’exister que pour leurs sujets. Aussi est-ce le pays où les troupeaux sont les plus beaux de l’Europe, parce qu’ils y sont les plus heureux. Mais c’est trop nous écarter : revenons à l’éducation de l’homme, à qui nous avons jusqu’ici tout rapporté, et pour qui seul nous prenons l’intérêt des animaux.
Au sortir de la première enfance, à ses hochets on substitue pour la jeunesse des amusements plus ingénieux et plus nobles, dit-on ; quels en sont les instruments, les objets ? Encore les animaux qui, de leur sang et de leur vie en font les frais ! Alors on s’exerce aux diverses espèces de chasses, que, pour en pallier l’odieux, la gourmandise et la vérité de concert ont élevées à la dignité d’Arts : c’est ainsi qu’en raffinant la cruauté et en perfectionnant ses moyens, elles prétendent l’anoblir ! Déjà l’homme doit être aguerri, au-dessus des craintes et faiblesses puériles, et savoir massacrer d’innocentes créatures avec un sang-froid plus viril, un plus robuste courage !
Voyons donc ces nouveaux agréments dont on embellit son éducation, ces honnêtes et mâles réactions qu’on lui prépare ! On lui met en mains un de ces tubes imitateurs de la foudre : comment en usera le petit Jupiter ? En étourdi qui, fier de son pouvoir et du tonnerre si nouveau dans ses mains, ne voit plus de gloire qu’à tuer et pour en faire l’essai dépeuplerait la terre et les airs si la force ou l’adresse répondaient à sa fougue impatiente. Surpris au milieu de leurs charmants concerts, les chantres les plus gracieux des forêts tombent sans voix : les amours se changent en deuil : on multiplie sans pitié les veuvages. Condamnés à la mort, toute une famille désolée d’orphelins nus encore et sans force, étendue sur le duvet, appelle en vain par ses cris perçants la tendre mère… qui ne viendra plus les y réchauffer ! Du milieu de ses compagnes éperdues, précipitée du haut des airs, la perdrix palpitante, les ailes et les jambes fracassées, vient expirer aux pieds du cruel… qui tressaille de joie. Haletant, épuisé de ses longues courses, le lièvre arrêté tout à coup, pirouette et trouve à ce moment la voix pour reprocher à l’homme par un dernier cri de douleur, son injuste férocité !… Et toute la maison, au retour du vainqueur, applaudit en chorus à ces barbares triomphes !
Encore parmi les innombrables genres de mort inventés contre les animaux est-ce un des plus doux que celui donné par ces traits que porte le feu. Mais voici bien d’autres spectacles ! Au milieu de vos divertissements, des appareils de supplices ! Et pour qui donc, bon Dieu ? Pour la faiblesse, la douceur et les grâces !… Là c’est l’élégant pinçon, le brillant chardonneret, qui, les yeux crevés, pour qu’ils ne puissent rien soupçonner de ce qui se passe autour [43] d’eux, appellent dans leur triste abandon de la compagnie, c’est-à-dire de nouvelles victimes, appellent environnés de grains et du sein de l’abondance, comme à de joyeux banquets, leurs frères, hélas ! Qu’on les force à tromper… Ici, au contraire d’un large filet enchaîné par le milieu du corps un autre, à chaque fois que la machine joue, accablé du poids des filets et de l’oiseleur qui tombe sur sa proie, pour comble encore à la douleur d’entendre autour de lui les cris plaintifs de sentir les mouvements convulsifs, de partager la frayeur d’une infinité d’autres de son espèce arrêtés avec lui dans le piège fatal, jusqu’à ce que lui-même enfin, avec les armées ailées qu’il s’efforce d’appeler à son secours, il expire brisé. Je traverse dans l’extase d’une douce mélancolie une forêt majestueuse : quels accents, en interrompent le silence ? De funèbres soupirs… Ceux, je crois, de l’oiseau de la nuit ? En plein jour !… J’approche : mille cris aigus, lamentables sortent d’un toit de feuillage au loin environné d’un vaste échafaud de gluaux perfides… quels monstres sont donc cachés sous ces antres verts ? Toutes les tortures des Phalaris y sont, je crois, déployées ! Les premiers oiseaux pris payent cruellement leur imprudente curiosité : on les dépouille plume à plume ; on leur tiraille les membres, on leur froisse les ailes l’une contre l’autre ; leurs os sont brisés, leur sang ruisselle, leur poitrine épuisée n’a plus de voix : jusqu’au dernier soupir on leur arrache des cris : ciel ! Et pourquoi donc ?... pour en attirer d’autres, plus pitoyables, oh ! Sans doute, que l’homme, mais non moins dupes, hélas, que leurs pareils !
Plus cruels encore, j’ai vu souvent des troupes d’enfants parcourir les buissons, les bois, ne pas laisser passer une épine, un coin, sans y fouiller, pour découvrir les retraites des oiseaux, briser leurs nids, casser les œufs : malheur à[40] la trop courageuse mère, qui ne pourrait se résoudre à les quitter ! Elle sera étouffée sur sa famille sanglante… Et d’imbéciles parents ne trouvent rien là de répréhensible ? Cette puérile expédition attaque cependant la société : car dans une seule battue ils vont dépeupler des forêts entières : ils en détruisent dans leur germe les générations futures. Quant à moi, je gagerais, à voir le barbare plaisir de ces petits assassins, que ce ne sont là ni leurs coups d’essais, ni les uniques exploits auxquels un jour se bornera leur trop précoce audace.
L’hiver suggère d’autres inventions contre ces aimables habitants de l’air : on profite alors malignement de leur misère et leurs besoins : on leur offre des aliments que la Mère commune la terre ne fournit plus ; et ils trouvent dans la perfide pitié de l’homme une mort que l’aquilon moins cruel ne leur eut point donnée.
Si quelques-uns des innombrables prisonniers qu’avec tant de stratagèmes on ne peut manquer de [44] faire viennent à bout par leurs charmes touchants d’obtenir au moins la vie, aux dépens de leur liberté, heureux s’ils tombent entre des mains plus douces ! Ils n’auront au moins que les maux de la captivité : mais combien encore, pour lesquels une prompte mort n’eut été qu’un bienfait ! Que vois-je au haut de cette fenêtre ? Un de ces agiles habitants de l’air, forçat enchainé par le milieu du corps, tantale innocent, ne peut ni boire ni manger, sans tirer laborieusement par une longue chaîne un seau suspendu loin de lui, qui le plus souvent se répand en chemin, et le laisse mourant de faim et de soif. Pour surcroît de douleur, on ajoute souvent à la machine un miroir, pour qu’il croye y voir son semblable… Qu’il ne peut jamais s’approcher ! Et ce pénible spectacle vous amuse, barbare ?... Gardez-le du moins pour vous et ne l’étalez pas : il me déchire !...
Il est dans le même genre des amusements plus relevés, plus nobles (ne serait-ce pas à dire un peu plus cruels de quelques degrés ?) des amusements, non pas seulement d’hommes faits, mais de héros, de princes ! Quel mort doux et paisible, si la curiosité ou plutôt le hasard le conduit une fois sur les traces de ces meutes impitoyables excitées par les corps et les cris des chasseurs contre les hôtes des forêts, n’a pas senti ses paupières prêtes à s’humecter, à la vue des pleurs de ce bel animal aussi doux que fier, immolé aux plaisirs des grands ; et n’a pas dit au fond de son cœur, comme se le dit sans doute dans le langage de la Nature ce cerf dévoré tout vivant ? Ô hommes, que vous êtes inhumains ! C’est parce qu’il est superbe que de plus illustres ennemis mettent de la gloire à l’abattre, et s’en réservent le meurtre ! Son mérite, comme pour bien d’autres, fait son malheur, mais à cette espèce d’hommes, dispensés de l’être à notre manière, il faut de ces sortes de spectacles, pour les aguerrir à des scènes bien plus tragiques, plus sanguinaires (et par cela-même bien plus héroïques !) auxquelles leur condition les expose : appelés à détruire des hommes, ils en étudient sur les animaux l’art important !
Mais comment soutenir, pour peu que l’on ait de cette délicatesse que donne une certaine éducation, un spectacle grossier, ignoble, qui n’a rien d’attrayant, qu’aucun prétexte n’excuse, aucune illusion ne relève, vrai divertissement de Cannibale, très commun cependant dans les environs de cette capitale fameuse, où les étrangers viennent étudier la politesse et l’humanité ? Un malheureux oiseau[41] enfourché par le cou dans l’ouverture d’un pieu fondu, ainsi suspendu durant deux ou trois heures, le considérer able du corps tiraillant la tête, reçoit dans cette posture et cet espace de temps plus de mille coups peut-être de gros et courts bâtons qu’on lui jette, jusqu’à ce qu’enfin le bras le plus adroit de ces Rustauds joueurs lui donne le coup heureux de la mort ; et pour prix de son triomphe le glorieux vainqueur emporte en long cortège de ses dignes [45] rivaux le cadavre meurtri, dont il court au cabaret les régaler !… Acteurs et spectateurs, vous êtes tous des barbares ! Et si votre cœur ne vous le dit pas, il faut donc qu’une voix plus énergique vous l’apprenne ; il faut que l’autorité parle… Quoi ? Toute l’industrie de notre siècle ne saurait suppléer à de pareils amusements ? Et la police regarderait comme indigne d’elle d’en suggérer d’autres ?
Mais personne n’y voit de mal : tant pis ! Les âmes sont donc déjà bien dépravées, bien blasées et les malades bien désespérés, puisqu’ils ne sentent plus ? Serait-il donc malheureusement vrai qu’il y a d’autant moins d’humanité dans les mœurs des hommes qu’il y en a plus dans leur langage ? Et c’est alors précisément, alors plus que jamais, qu’il est temps de faire des lois puisque la conscience publique cesse d’en tenir lieu ; des lois qui gravent sur l’airain les maximes qui ne sont plus que sur les lèvres, et remettent en circulation, pour ainsi dire, en activité réelle, ce qui n’est qu’en oisive morale. C’est quand la Nature n’est plus entendue, que la loi doit tonner, la force exiger et la crainte arracher, ce que ne prescrit plus l’honnêteté générale. S’ils ne voient de mal à rien, il faut donc un avertissement authentique, une leçon précise et forte, qui les frappe, fixe leur attention et le leur fasse remarquer où il est. Du moment que les mauvaises actions ne font plus horreur, les menaces, les supplices deviennent nécessaires pour imprimer au moins la Terreur. Ainsi, contre le parricide même, tout incroyable qu’il dût paraître d’abord, a-t-il fallu des lois, quand il s’est trouvé des hommes sourds à la voix de leur propre sang[42] .
Mais si vous faites un crime du meurtre des animaux, faudra-t-il donc n’en détruire aucun ? Voilà bientôt nos forêts impraticables, nos montagnes inaccessibles, nos champs, comme autrefois l’Egypte, inondés et dévorés ; ils se rendront les maîtres jusque dans nos maisons ; et nous allons être partout opprimés de leur nombre… Arrêtez : je vous entends : tuer !… Que je voudrais m’épargner ce mot, qui fait bondir mes entrailles !... Pardonnez, lecteur : peut-être la sensibilité m’égare : mais j’y laisse à l’abandon entraîner ma plume, et ne sais point lui résister ; je parle naïvement de conviction, comme j’en suis affecté ; il ne dépend pas de moi de voir et sentir autrement ; et si elle donne quelques plaisirs de plus, n’en soyez pas jaloux, hommes flegmatiques, elle m’en punit assez ; la douleur a sa revanche. Mais enfin, nous voilà au point critique : il faut prendre un parti ; et mon embarras redouble…
Eh ! Bien, faites donc comme vous avez toujours fait : aussi bien mes difficultés ne retiendraient personne. Détruisez donc puisqu’il le faut ; ou plutôt foudroyez, anéantissez, s’il est possible : usez à cet effet de toute la supériorité de vos forces ; et dans la triste [46] nécessité de donner la mort, donnez-la du moins si rapide, que l’être vivant ne puisse en avoir le sentiment, ou plutôt qu’elle ne soit en lui que la subite cessation du sentiment de la vie ; qu’en un mot le passage immédiat de l’existence au néant soit aussi prompt qu’il serait à peu près sous la main même du Créateur, à qui de fait appartient seul le véritable droit de destruction, dépendance nécessaire de celui de création ; ou si vous voulez, aussi prompt qu’il l’est pour ce faible insecte, que je presse de ma main, foule sous mon pied, que de toute l’action de ma toute puissance sur lui, de tout mon poids j’accable… Et qui tout à coup ainsi, de matière organisée vivante, n’est plus qu’une poussière inanimée.
Hors cela, quiconque passe les bornes de l’absolue nécessité va au-delà de la simple mort, ajoute aux souffrances inévitables de la victime, aggrave son malheur ou le prolonge, il n’est pas innocent, j’ose l’affirmer : non certes, il ne l’est pas. Retenez vos rires, impassibles moralistes des clubs et des cafés : celui qui ménage à ce point la vie même des animaux, soyez sûrs qu’il respectera le repos, l’honneur, les jours des Citoyens : qu’il saura, s’il le faut, ce cœur si faible, être mille fois plutôt victime que juge d’un Tribunal Révolutionnaire.
Est-ce donc trop de vous conjurer, ô hommes, d’éviter au moins ces raffinements de cruauté, ces entretenions[43] de la Mort, quand par elle seule votre but est rempli ? Quelle nécessité, par exemple, que ce bœuf tremblant au milieu de la fange et des flots d’un sang trop sympathique avec le sien, endure plusieurs heures, plusieurs jours de suite une longue mort d’autant plus amère qu’il semble la prévoir et par ses pressentiments douloureux, ses meuglements plaintifs en reprocher à l’homme toute l’injustice. Celui qui le voit dans cet état d’angoisse à la porte d’une boucherie ne devrait-il pas être à jamais dégoûté de pareils mots ? Quel dérangement ne doit pas causer dans les humeurs de l’animal cette longue et déchirante agonie ? Et n’est-il pas à craindre qu’une si violente commotion, que ce bouleversement de tout son être ne dénature les sucs nutritifs que vous allez faire passer dans vos veines ?
Fût-ce un insecte importun, nuisible, dont il est à propos de prévenir la multiplication, qui vit de votre sang, si vous ne lui devez que la mort, vous vous devez à vous-même la modération, la générosité, ce n’est qu’un chétif, un insolent atome ; mais vous êtes un homme ! Et s’il vous cause quelque dommage, quelque sensation désagréable, s’ensuit-il que vous ayez droit d’exercer contre un moucheron une basse vengeance, qui même contre un ennemi votre égal serait encore honteuse ? Je ne veux pas qu’au lieu de l’écraser[44] , on le tue partiellement, qu’on le dépèce membre par membre, comme ferait ce marmot despote, barbare à plaisir. Vous l’êtes encore davantage, vous apprentis naturalistes, qui, pour conserver un beau papillon, un scarabée curieux, le clouez vivant avec une épingle ! Quoi ! C’est pour l’admirer plus à votre aise que vous le torturez ? Il est victime de votre ravissement ? Sa beauté, ses grâces lui valent des [47] supplices[45] ?
Physiciens, disséqueurs, anatomistes, savants, observateurs de la circulation du sang dans une Grenouille, la soustraction de l’air du corps d’une pauvre colombe sous la machine pneumatique : toutes vos expériences sont fort belles !
Fort utiles surtout, je le veux croire ; car il est pour l’homme tant de choses essentielles, avant l’obligation d’être humain ! J’applaudis de tout mon cœur à vos découvertes, à votre sagacité ! Mais je ne les envie pas à ce prix ; car vous faites là, à mon avis de fort tristes opérations ; et j’avoue qu’à votre place je serais à la torture autant au moins que le Patient que j’y aurais soumis.
Mais il est clair cependant aussi (n’en déplaise à ces anciens Rigoristes[46] (quais paria esse fere placuit peccata) que ces divers actes, lors même qu’ils sont évidemment blâmables, ne peuvent l’être au même degré ; et que des milliers d’insectes détruits sans motifs[47] , ne sauraient être comparés à la perte d’un animal utile, d’un chien, par exemple, d’un chevreau, d’un serin, d’un coq, etc., ainsi, de même, qu’à la suite de ce premier degré de classification entre les natures vivantes, je veux dire celui de l’homme à la bête, il en est une infinité d’autres de l’animal le plus parfait jusqu’au dernier degré de matière animée, ainsi, il est évident qu’il doit y avoir diverses gradations dans l’usage de ce droit de vie et de mort que l’homme s’attribue ; divers degrés de désordre, ou, si l’on veut, de délits dans l’abus, qui demandent par conséquent une certaine gradation dans les lois[48] conservatrices des espèces, ou coercitives de l’injuste oppression.
Suivez donc cette échelle des êtres ; et vous mettant à la place du créateur primitif administrateur perpétuel, qui vous a comme établi son lieutenant, et vous laisse l’intendance générale, usez du pouvoir qui vous est délégué, mais comme il le ferait lui-même, mais avec les sages dispensations de sa Providence, dont il vous laisse les ministres, non comme des régisseurs infidèles, qui dessèchent, détériorent, épuisent le bien du maître, trop pressés d’en exprimer toute la subsistance ; et n’allez pas, contrariant ses vues et dégradant son ouvrage, exercer pour la destruction le pouvoir qu’il emploie à la production ; je pourrais ajouter, puisque des espèces entières ont disparu, appauvrir sa création même.
Usez de ce droit absolu de vie et de mort, mais n’abusez pas ; usez avec ménagement et réserve sans doute ; et de plus, en raison du mérite intrinsèque et des facultés relatives de chaque espèce, en raison de leur utilité, de leurs talents, de leur degré de sentiment ou d’intelligence, car, par exemple, la vie d’un animal stupide et grossier, qui ne se plait que dans la fange, n’a d’appétit que pour l’ordure, d’instinct que la gourmandise, et de destination par rapport à nous, que de servir à satisfaire la nôtre, tel que le pourceau, sa vie, dis-je, ne peut nous [48] paraître aussi précieuse que celle de plusieurs animaux domestiques et autres, qui semblent par leurs facultés plus rapprochés de nous. L’insecte, l’huitre, le polype, etc., paraissent avoir moins de vie ; et par conséquent le tort que nous leur faisons en les en privant est moindre en proportion de la mesure départie à chacun. On doute même avec quelque fondement s’ils sont sensibles à la douleur, et si la mort est autre chose en eux que la cessation du mouvement.
Il est des animaux dont la nature même semble indiquer la destination : ils nuisent pour détruire, et par conséquent pour être détruits ; pour nous harceler, nous inquiéter, nous attaquer, mais aussi pour mourir de notre main ; encore ceux-là même ne sont-ils pas inutiles : la Nature les arma de force et de ruse, à dessein apparemment d’aiguillonner notre courage et nous tenir en haleine, d’exciter notre vigilance, notre industrie, éveiller notre activité, et lui fournir de l’exercice ; elle voulut empêcher l’homme de s’amollir dans un dangereux repos, le forcer d’être sur ses gardes, le rendre inventif en moyens de défense ; sans doute aussi prévenir la trop grande multiplication de certains animaux plus faibles, mais plus nuisibles peut-être par leur nombre ; surtout retarder, je pense, la destruction trop prompte des bois si nécessaires ; car ce sont, pour ainsi dire, nos gardes-forêts. Peut-être les a-t-elle créés pour l’humiliation de notre orgueil et la punition continuelle de l’homme coupable ; pour punir sa révolte contre les lois divines par la révolte de ses propres sujets ; enfin pour mille autres raisons très convenables sans doute, que sa sagesse en tout le reste doit faire présumer.
Je pourrais vous dire même que c’est pour leur propre intérêt et par une espèce de justice qu’elle les a créés tels : en fallait-il moins en effet pour les défendre contre vous, tyrans universels, à qui rien ne résiste, à qui rien n’échappe, qui détruisez par la perfidie ce dont ne peut venir à bout la force ou le courage ? Vous qui, malgré toutes les ormes dont elle les a pourvus, êtes parvenus cependant à les faire disparaître de tous les lieux que vous habitez, et confiner le peu qui reste dans des rochers inaccessibles ou des déserts impraticables ; vous qui trompez les desseins du Créateur, combattez sa magnificence, démembrez ce grand ouvrage si complet et si beau, dont l’ensemble fait l’harmonie ; et qui, vous hâtant d’en replonger d’avance autant qu’il est en vous des parties considérables ou néant, semblez prévenir même les décrets de l’Auteur et Maître Souverain de la Nature. Pourquoi, par exemple, un grand nombre d’animaux, même rampants, tels que le crapaud, la vipère, le scorpion etc., outre des formes hideuses et repoussantes, sont-ils munis de défenses plus dangereuses et plus inévitables ? Pour vous contenir, ennemis plus dangereux qu’eux tous, parce que, se trouvant sans cesse sous vos pieds, ils sont plus exposés à vos insultes. Encore tous, depuis l’insidieux reptile, jusqu’au [49] fier monarque des forêts, ménagent-ils celui des Animaux dont ils sont le moins ménagés, l’homme plus qu’aucun autre et ne l’attaquent que lorsque leur propre danger les y contraint, presque toujours provoqués les premiers. C’est à eux qu’appartient par conséquent le droit de défense et de représailles. Rarement portent-ils leur audace plus loin, à moins que la rage de la faim, de l’amour, de la colère, ou quelque autre frénésie ne les mette hors de leur état naturel. Mais au moins peuvent-ils, ceux là, vous opposer une résistance vigoureuse ; et, vainqueurs dans un juste combat, vous terrassez alors des adversaires dignes de vous. Mais ce ne sont pas ceux auxquels s’adresse le plus ordinairement votre bravoure : il y a trop à risquer, trop peu à gagner. Ce sont les plus admirables comme les plus faibles, que vous choisissez pour les immoler de préférence. Le tigre a ses griffes, l’éléphant sa trompe et sa masse, le rhinocéros la pique de son front, le sanglier ses défenses, le crocodile, le requin leur gaule effroyable, l’aspic son dard, etc., mais cette brebis, pour arrêter votre bras, n’a que sa douceur et sa toison qu’elle vous offre, cette génisse, que sa docilité et son lait ; cette pole sa fécondité ; cette alouette l’éclat du chant matinal dont elle salue l’astre du jour ; ce chardonnet l’élégance de sa parure et de son corsage etc., mais rien de tout cela ne vous touche, ne les garantit, et la plupart, du moins ceux que ne retiennent pas nos fers, ou que ne propage pas notre cupidité, disparaissent insensiblement des régions que l’homme habite. Cette main, dont plusieurs tels que le bœuf, le chameau, le cheval aident la faiblesse, cette main qui les flatte traîtreusement qu’ils caressent amoureusement, c’est elle-même qui leur plonge un couteau dans le sein ! Et tel est la digne paix de leur tendre abandon !… Mais toujours la sensibilité m’emporte et m’écarte de mon sujet : revenons.
J’accorderai donc que l’instinct féroce ou perfide de quelques-uns, ce fiel, ce venin, cette soif de sang, l’extrême importunité de quelques autres, ou leur insatiable voracité, certaine obstination et persévérance à nuire, en un mot cette disposition à nous attaquer nous-mêmes ou ce qui nous est cher, sont comme les signes de réprobation que leur imprima la Nature, et non seulement une permission pour nous, mais un avertissement de nous en garantir à leurs dépens et risques en ravageant nos terres, nos troupeaux, menaçant notre vie, ils scellent eux-mêmes leur arrêt de mort. La loi contre eux existe depuis longtemps ; celle qui autorise la défense personnelle ; qui m’ordonne de veiller à la conservation de mes jours, dont je ne dois le sacrifice qu’à la société ou à Dieu ; Loi, qui justifie même en pareil cas la résistance à mon semblable, et la violence opposée à la violence pour repousser ses injustices : membre pour membre, dit-elle[49] , et vie pour vie. Echange rigoureux pourtant, qui doit paraître pénible au cœur bien fait, et ne peut être légitime que dans l’impossibilité de se sauver autrement.
Mais en ce cas-là même, point de forme ni d’intention vindicative : perdite, si qua nocent ; verum haec quoque perdite tantum (Ovid. Met).
Ne prétendez pas punir, dans des êtres nuisibles par tempérament et nécessité, une malice qui dans le fait n’existe point. Une plante venimeuse s’offre devant vos pas : vous l’arrachez ; un tison va tomber sur votre main : vous le repoussez, sans vous emporter contre [50] l’un ni l’autre : ainsi, une guêpe vous court au visage ; un serpent siffle et se dresse ; un loup frémit autour de la bergerie ; un milan fond sur votre colombier : armez vous contre l’agresseur ; exterminez le brigand, mais sans colère, sans vengeance, uniquement pour prévenir un plus grand mal.
Plusieurs animaux, sans paraître aussi redoutables pour l’homme, nous forcent cependant à leur faire la guerre. S’ils ravagent nos fruits, nos grains, nos denrées, nos meubles, et tout ce qui nous est le plus nécessaire à la vie, ils causent un dommage bien plus grand que ne ferait un meurtre particulier d’une brebis, ou même d’un homme. Des sauterelles, des grenouilles, de simples moucherons ont affamé, tué des peuples entiers. La Nature nous a donné des amis domestiques, que nous ne ménageons pas, et dont nous nous hâtons de nous défaire ; en revanche, elle nous entoure d’ennemis qui ne nous respectent pas et dont nous ne pouvons nous délivrer. Ainsi le rat importun et ses nombreuses familles, qui rongent nos provisions, minent nos murailles, ainsi le vorace moineau, autre brigand ailé, destructeur de nos greniers, de nos maisons, nous font plus de mal peut-être que nous ne leur en pouvons rendre et malgré les torts réciproques ont moins à se plaindre de nous que beaucoup d’espèces bienfaisantes.
Ainsi le lièvre, le lapin, le chevreuil et plusieurs autres habitants des champs et des bois, d’un naturel paisible et doux quoique sauvage, semblent néanmoins, par les dommages qu’ils nous causent, légitimer quelquefois jusqu’à certain point nos hostilités contre eux, non cependant nos cruautés. Encore est-ce bien à regret[50] , je le confesse, et par une sorte de respect humain pour des fantaisies trop générales, que je souscris, hommes implacables, à votre sentence. La Nature est si vaste, si riche ! En quel lieu de la Terre n’est il donc pas assez de place ou de produit, pour les divers hôtes qu’elle a soin de n’y placer d’ordinaire qu’en nombre équivalent ? Où n’aurait-t-elle pas de quoi suffire à tous, si jamais votre despotisme exclusif pouvait consentir à partager ?
Mais tant d’autres au moins, contre qui vous n’avez que faux prétextes ? La perdrix des montagnes (par exemple) vivant en grande partie d’insectes dans nos forêts et rarement de quelques grains tombés des épics dans nos champs ? Mais la caille, la bécasse, qui reviennent à temps délivrer nos prairies de familles dévorantes ; mais la tourterelle, exemple pour vous si nécessaire des vertus conjugales ; ce merle même si vif et si gai, quoi que solitaire ; ces fauvettes mélodieuses, tant d’autres qui ne se nourrissent que de vermisseaux, de fruits de buissons et de graines sauvages, quel crime peut donc leur attirer la mort ? Mais cet oiseau voyageur, messager du printemps, qui revient chaque année avec une sécurité si touchante nous demander l’hospitalité sous nos toits, nous [51] confier leurs pénates suspendus à nos fenêtres et, pour loyer de l’asile que nous leur cédons, épure l’air autour de nos habitations, oiseau d’ailleurs dont la chair ni le goût ne peuvent nous tenter, et qui mort ne peut servir à rien, sous quel prétexte l’abattre dans son vol, le bec tout plein de aliments qu’il porte à ses tendres petits ? Et ne pouvons-nous trouver à notre adresse des exercices moins barbares ? Oserai-je demander grâce au moins pour vous, innombrables tribus aussi douces qu’innocentes et persécutées précisément à ce titre avec d’autant moins de ménagement que vous êtes plus faibles et plus timides ?[51]
Mais enfin, dira-t-on, prétendez-vous donc interdire les differentes espèces de chasses, de penches et autres exercices ou commerces, si généralement et depuis si longtemps en usage parmi les hommes ? Si je n’écoutais que la voix intérieure de mon sentiment propre, je serais peut-être assez embarrassé de répondre, dirai-je, que je ne saurais me les permettre à moi-même ? Que ces plaisirs si vifs, si séduisants pour d’autres sont pour moi des supplices ; et que si d’ailleurs à table, ne pouvant ressusciter tant de malheureuses victimes, je m’efforce de m’accommoder à l’usage, j’aimerais mieux cent fois ne jamais goûter de chair, que d’abattre de ma main une seule pièce de gibier ? Je ne serais pas au reste le seul de mon parti. Ce n’est pas seulement Pythagore, qui s’empressait d’acheter aux oiseleurs de malheureux captifs, pour leur donner la liberté : c’est une scène que j’ai vu souvent se renouveler sous mes yeux ; plus d’une fois j’ai vu des personnes sensibles se rendre à prix d’argent propriétaires d’un animal, uniquement pour le tirer des mains de ses tyrans ou ses bourreaux ; et payer, en s’épargnant à eux-mêmes une sensation douloureuse, le droit et le plaisir de l’arracher aux fers, aux tortures, à la mort qu’on lui préparait et ceux qui faisaient très sérieusement cette bonne œuvre, ce n’était point des enfants, mais des personnages tout aussi graves que le silencieux philosophe de Samos ; mais en même temps, comme lui, d’autant plus affectés des cruautés dont ils se trouvaient les témoins, qu’ils étaient eux-mêmes plus réfléchis et plus honnêtes.
Mais enfin, une manière de sentir personnellement et particulière à quelques individus ne peut être donnée pour règle : c’est à une question d’ordre et d’intérêt public qu’il s’agit de répondre : eh ! Bien, pour nous dispenser de faire nous-mêmes cette pénible réponse, n’en donnons donc pas d’autre que le texte même de cette permission de si ancienne date : tout ce qui vit et se meut en l’air, sur terre, sous les eaux, je le mets à votre disposition ; faites-en votre nourriture (Genes, cap. 9). Assurément la décision doit suffire puisqu’elle émane d’un oracle suprême ; et sans doute et n’aura pas de peine à intenter mes lecteurs. Mais prenez garde, insatiables héritiers de celui à qui furent accordés ces pouvoirs, ne croyez pas que vous ayez [52] sujet d’en triompher ; ni que sans prévarication et sans danger vous puissiez au gré de vos caprices vous prévaloir de toute leur étendue.
Souvenez-vous d’abord, comme nous l’avons déjà remarqué, que ce n’est qu’après le Déluge, cette époque si désastreuse et si honteuse à votre race, à la suite du bouleversement universel de la Nature et de ses lois, qu’il est fait pour la première fois mention de ce triste privilège, souvenez-vous que ce n’est que l’homme criminel et dégradé, dont le sang, si pur dans sa source première, est déjà profondément altéré par des ferments vicieux, aigri par un poison physique et moral, l’homme devenu passionné et paisible, cruel et sensible, à l’homme que ces animaux, sujets auparavant affectueux et dociles, ne chérissent et ne respectent plus, comme autrefois, dont enfin son auteur lui-même vient d’être forcé de se venger d’une manière si terrible, qu’il est dit mangez-les, terme déjà dur en lui-même et conforme à ses goûts abrutis et dépravés. Tuer et mourir, prolonger sa vie en donnant la mort, jusqu’à ce qu’il la reçoive à son tour, et souvent même violente aussi comme il la donne, c’est une partie de son supplice : il le boit, il se l’incorpore avec le sang et la chair des animaux.
Car, en vous les abandonnant, observez en autre que leur Créateur et conservateur ne vous a pas ôté les répugnances de la Nature, frein toujours subsistant, je dirais volontiers punition inséparable et perpétuelle de vos fureurs. Ainsi, même avant les souffrances corporelles et tant de maladies, fruits ordinaires de vos jouissances, se trouve la peine, parce que presque toujours s’y trouvent le désordre et le crime. Et, preuve encore que cet abandon n’est point aussi absolu que vous le supposez, le Législateur en a-t-il moins dans la suite, par l’organe de Moïse, spécifié et précisé certains articles, exceptées certaines espèces d’animaux expressément interdites et très sagement de l’aveu même de plusieurs savants naturalistes et médecins qui l’ont reconnu depuis ?[52]
Cette expression si générale de la loi n’en suppose donc pas moins un sage discernement de la part de l’homme pour y faire les réserves et restrictions nécessaires ; et, de même qu’elle ne peut raisonnablement être prise à la lettre, de manière à comprendre une infinité d’espèces qui ne sont pas de nature à servir d’aliments à l’homme, elle ne peut sans doute aussi avoir une application illimitée pour toutes les autres, sans admettre bien des exceptions de raison, de santé, de convenance. Il en est d’ailleurs à peu près ainsi de toutes les choses de ce monde : leur auteur les abandonne à l’homme, et l’homme à sa liberté ; mais, en même temps, il place dans son propre cœur un tribunal infaillible, où toutes les questions sont portées, tous les doutes résolus sur le champ ; un juge toujours présent à tout, donnant son avis sur tout, toujours prêt à décider entre le désir et le droit ; et dont la voix intérieure, plus prompte et plus expressive que la parole, lui dit à chaque circonstance : tu n’iras que jusque là.
[53] Je reviens, comme on voit, sur mes pas : je cède du terrain, hélas ! Oui : il le faut bien ; comment faire autrement avec les hommes et dans ce monde imparfait et malheureux ? Il faut bien capituler avec nos faiblesses : une rigueur mathématique n’est pas plus possible en morale que pour les surfaces ou quantités matérielles, quand les préjugés sont invétérés, les abus[53] universels c’est beaucoup d’en arrêter quelques effets, ou d’en diminuer l’influence. Vivez donc, mortels, de la mort : recevez en chaque jour une parcelle en votre sein, et pénétrez-vous en en détail, jusqu’à ce que la dose enfin soit complète. Hâtez-vous d’exécuter l’arrêt qui vous y condamne : vos trompeurs appétits, vos aveugles travers en sont une. Suite fatale : puisse chaque bouchée en être aussi pour vous un mémorial continuel !
Comme cependant une latitude indéfinie, dans l’interprétation du texte précité, est sujette à tant d’inconvénients qu’elle a donné lieu déjà à des abus si préjudiciables ; que loin de reculer jamais en arrière, l’homme ne sait pas s’arrêter dans le mal ; qu’au contraire dans sa pente malheureuse il tend toujours au pire, avec une accélération effrayante, ne serait-il pas à propos qu’au point où nous en sommes déjà, et surtout en France, l’autorité publique s’occupât elle-même de l’objet dont nous parlons, et prit enfin des mesures efficaces, pour retenir et suspendre au moins les progrès d’un désordre, qui mine sourdement la subsistance de l’Etat ; et, tout-à-coup, plus vite que les guerres du dehors ou les troubles intérieurs, peut amener sa ruine et la dissolution entière de la société ?
Mais faut il à cet égard des lois expresses solennelles, précises, et sont-elles indispensables ? Voilà le point de la question le plus embarrassant peut-être. Il arrive si souvent que les plus sages lois suggèrent, enseignent et provoquent par la défense-même le mal que l’on veut éviter. Je ne sais par quelle fatalité le frein-même du devoir, et l’espèce d’irritation que produit le contrainte, stimulent le caprice, inspirent la fantaisie, augmentent le penchant à la révolte et semblent ajouter un nouvel attrait à la transgression.
Il ne faut pas faire de lois sans doute pour des objets dont le plus grand nombre ne pourrait assez concevoir l’importance ; des lois dont il semble que la sanction ne puisse être que dans le sentiment, et même dans la finesse la plus exquise du sentiment. La loi ne peut ni ne doit atteindre certaines convenances délicates, qui ne sauraient être aperçues ni senties du commun des hommes ; elle ne peut statuer que sur ce qui blesse évidemment et essentiellement les grands principes de la morale, trouble l’ordre civil, nuit à la société ; sur des objets d’intérêt public [54] dont l’utilité frappe tous les esprits. Trop multipliés, ses oracles en sont moins augustes ; et descendant à de trop minces détails, elle perd de son imposante gravité. A force d’être subtils et spiritualisés, certains règlements échapperaient au bon sens ordinaire ; et telle observation pourrait être sublime aux yeux du sage, qui ne serait que ridicule à ceux du vulgaire, pour qui cependant les lois surtout sont faites.
Mais dans le cas où l’abus intéresse au plus haut degré l’humanité et ses besoins les plus essentiels, intéresse le repos, la durée, l’existence-même des sociétés, sans doute on peut, on doit même faire des lois.
Quelles doivent-elles être ? On ne nous le demande pas ; et la question proposée ne va pas jusque-là. Ce n’est pas à nous à prévenir l’auguste Aréopage, qui refond aujourd’hui avec tant de sagesse et de maturité ces antiques éléments si confondus jusqu’alors du bonheur public ; ce n’est pas à nous à tracer devant lui la route qu’il s’ouvre et suit d’un pas si ferme, si mesuré, si sûr ; et sans doute on n’a pas voulu faire d’un léger essai de littérature, ou si l’on veut de morale, un code des nations. Il faut avouer d’ailleurs que, pour la rédaction même de la loi, le point juste ne paraît pas facile à saisir, le point où commencerait le délit digne de l’aversion publique.
L’espèce des lions est, dit-on, fort diminuée, réduite à un assez petit nombre d’individus repoussés dans les déserts brûlants d’Afrique ou d’Asie : assurément je ne réclamerai pas, pour ce bel et noble animal, en faveur de la curiosité, des Lois qui mettent à l’aise dans les forêts de Lybie sa férocité ; des lois semblables à celles qui engraissaient aux frais de l’Etat, sur les autels, des singes, des serpents, des crocodiles, protégeaient aux dépens des humains des êtres malfaisants et punissaient, comme sacrilège, l’attentat à leur vie.
La tête du loup est mise à prix dans nos contrées : je n’irai pas intercéder par compassion en sa faveur, et pour épargner un sang ignoble autant qu’odieux, sacrifier des milliers de brebis.
L’espèce des éléphants la plus forte comme aussi la plus douce, la plus intelligente, la plus sensible, est de beaucoup moins nombreuse qu’elle ne le fut du temps de Pyrrhus ou d’Annibal : l’intérêt pour eux ne m’engagerait cependant pas à réclamer des lois protectrices, qui missent en sûreté ce qu’il en reste ; leur donnassent le temps de repeupler l’Asie et d’en chasser les hommes. Je ne regretterai point l’usage auquel on les fit servir autrefois : nous avons bien assez de fer et du souffre pour nous entredétruire.
Les sociétés de l’industrieux castor ; ses travaux, ses cités ne se retrouvent presque plus, il est vrai, que dans les relations des anciens voyageurs. Quelques individus [55] sans art, sans talents, ou plutôt sans la faculté de les mettre en œuvre, uniquement occupés à chercher sur les bords des mers glaciales quelques recoins ignorés, ou dans les entrailles de la terre on ne vienne point encore les surprendre, ne peuvent donner une idée de ce qu’ils furent autrefois et seraient encore, si à côté de l’homme il était permis d’être quelque chose. Sans doute leur disparition bientôt totale et cet état de dispersion et de misère où ils sont réduits peuvent faire quelque peine ; et l’on a lieu de regretter ces estimables républicains, qui ne méritaient de notre part que l’admiration, non des persécutions gratuites. Je n’appuierai cependant pas sur ces faits et ces motifs la nécessité de lois somptuaires contre le luxe de nos manchons ou de nos chapeaux.
Mais il est clair cependant que, par rapport à certaines espèces si utiles à l’humanité que leur destruction entraînerait la sienne, ou diminuerait au moins étrangement ses forces et ses ressources, il est, dis-je, très certain que leur épuisement et rareté de plus en plus sensibles sont pour les chefs des Etats un avertissement des plus pressants de faire à cet égard des lois répressives. Il en faut au moins contre le luxe extravagant de vos tables, voluptueux barbares, qui croyez par quelques soupes économiques expier ces dissipations monstrueuses, où dans un seul dîner vous dévorez la subsistance d’un million de pauvres.
Il était moins nuisible que vous à l’humanité, ce Lucullus dont les cuisines consumaient pour un seul repas jusqu’à 10[54] et 15 sangliers, s’il le fallait, afin qu’il s’en trouvât un prêt à servir et cuit à point pour le moment juste de son arrivée, dût-il rentrer seul et qu’ainsi le dédaigneux maître en humât ou moins le premier fumet au sortir de la broche ; car il ne fallait à ces palais orgueilleux rien de réchauffé. Elles étaient moins dangereuses les folies de ces Apicius dont la sensualité allait interrogeant les forêts, les fleuves, les lacs et les mers, envoyait des flottes à la découverte d’une friande bouchée ! Au fond on pouvait absolument se passer de sangliers, de paons, de faisans, de phénicoptères, d’oiseaux et poissons rares ; mais la sagesse des lois romaines n’eut, certes, pas souffert ces consommations et gaspillages énormes de chair de bœufs et de moutons, d’œufs, huiles et autres denrées de première nécessité pour des jus, des coulis, et les simples apprêts de vos ragoûts fins ; et l’opinion publique chez ce peuple si sensé, eut avant toute loi fait justice de si condamnables excès.
Que deviendriez-vous, tranquilles épicuriens de la capitale, si la sage prévoyance de ces gouvernements, que dans vos politiques orgies vous calomnierez toujours quels qu’ils puissent être, ne s’occupait, pendant que vous buvez, dissertez, censurez, à prendre des mesures pour fournir [56] tout à la fois aux besoins de ce peuple immense que sans cela vous affameriez bientôt et à vos solitaires délices ? Aujourd’hui surtout on en prend de plus efficaces que jamais : et vous avouerez qu’il était temps. Le nombre des animaux[55] nécessaires à la consommation, les portes par lesquelles ils doivent entrer dans l’absorbante ville et les jours du sacrifice, les emplacements destinés à l’immolation, l’étalage et la distribution des victimes, le nombre et les noms des sacrificateurs dévoués à ce triste ministère et autorisés pour ce commerce convenable à peu d’hommes qui demande une surveillance plus exacte peut-être qu’aucun autre, tout en un mot est réglé, calculé, fixé ; L’administration veut tout connaître ; elle descend aux plus minces détails ; parce qu’elle est enfin bien convaincue que la science des détails (et non pas seulement les généralités) est la partie la plus essentielle de l’art de bien gouverner.
Mais ce n’est pas assez peut-être encore. L’or, toujours si puissant et si subtil, circulant à son aise dans les magasins et les marchés, ne saura-t-il pas toujours éluder la loi, détonner encore la plus grande partie des provisions préparées pour la masse commune et faire ainsi retomber sur le peuple même toute la rigueur des dispositions faites en sa faveur ? Il faudrait qu’elle pénétrât, cette loi vigilante, jusqu’à la table du riche et que la verge censoriale en main, son Ministre en fit enlever tout le superflu, pour le répartir à ceux qui n’ont pas le nécessaire ; ou plutôt il serait trop tard le mal est déjà fait et la nourriture de cent familles peut être déjà fondue en un seul plat. Mais il faudrait arrêter aux portes même de leurs Hôtels ces énormes accaparements de comestibles encore en nature, il faudrait que, dans chaque marché de cette grande ville, des édiles préposés à cet important objet de la circulation des vivres, y tinssent compte des marchandises exposées, de celles enlevées ; y fissent décharger ces hottes, ces voitures ambitieuses qui, dans un moment, à quelque prix que ce soit, dégarnissent la place, où le pauvre timide, arrivé lentement avec son obole, ne trouve plus même de quoi la dépenser et puisque aujourd’hui l’on se pique d’imiter les Romains, croit-on que ce vieux Caton Censeur si respecté, s’il eut été chargé de cette inquisition salutaire, en eut dédaigné ou mal exécuté l’emploi ?
Si vous regrettez, hommes fastueux, ces jouissances, cherchez-en d’autre genre et de plus brillantes : semez avec une ostentation plus noble, semez votre or, je n’ose dire au sein des indigènes, [57] (l’emploi serait souvent obscur : votre vanité croirait y perdre quoique vous en ayez aujourd’hui même de grands exemples ; c’est l’éclat surtout que vous ambitionnez), mais semez dans les ateliers, dans les manufactures ; environnez-vous des chefs-d’œuvre et de la pompe des Arts : payez-les pour qu’ils vous fassent remarquer ; étalez-nous, à la bonne heure, la magnificence de vos chars, de vos meubles, de vos parures, de vos palais ; ou plutôt imprimez, s’il se peut, votre souvenir à des monuments aussi superbes qu’utiles et durables ; et soyez, par le privilège de vos richesses, les décorateurs de nos villes, plutôt que les ordonnateurs d’un festin. Alors peut-être on pourra pardonner votre luxe, on pourra l’admirer : même trouver des raisons spécieuses à l’appui de la thèse de ceux qui le prétendent avantage et profitable aux empires. Mais n’enviez pas un méprisable et dangereux éclat, qui disparaît avec les services de votre table, sans laisser aucune trace d’estime ni de reconnaissance dans la mémoire de vos convives. N’allez pas, en un mot, par une sotte et criminelle profusion assassinant à la fois les animaux, les hommes et les peuples, prodiguer pour de grossiers plaisirs un sang précieux l’état, le sang de ses nourriciers et de ses Bienfaiteurs !
Sexe plus doux, plus sensible et bien plus délicat sur les convenances, vous qui présidez aux détails domestiques avec tant d’intelligence et de dignité, avec tant de grâces à nos yeux, nos fêtes et nos cercles, qui partout êtes si bien placés et faites si bien ; vous nées pour dispenser les lois du gout dans les Arts, du goût à nos tables, du goût dans nos mœurs, du décorum, en tout, c’est à votre Tribunal que nous en appelons de pareils abus et s’il faut des lois contre eux, daignez seulement être nos législateurs : chargez-vous de cette partie de la police, et le gouvernement pourra s’en reposer sur votre discrétion, sur votre pouvoir ; vous ferez cesser sans efforts, sans rigueur, par l’unique effet de votre sage influence, des scandales aussi honteux que pernicieux à l’homme ; il vous convient, il vous importe de ne rien souffrir en lui de ce qui peut ou l’endurcir ou l’avilir ; de ce qui peut ramener parmi nous la rudesse et la barbarie ; il en serait plus rebelle à votre aimable empire fondé sur la décence, sur la douceur et la bonté ; il serait moins digne de vous.
A ces idées, quelle nouvelle confiance m’anime ! Ô vous, que je défends avec tout le zèle et l’intérêt dont je suis capable, espérez tout : je vous l’annonce avec joie en ce moment. Que d’intercesseurs vous avez, bien plus puissants que nous, bien plus éloquents ! Toute cette partie la plus intéressante du Genre Humain ne peut manquer d’être pour vous. Et l’auguste personne, qui, dans ce moment souveraine des cœurs, donne le ton à tout ce monde charmant, qui lui donne l’exemple de tous les genres de biens à faire, si quelque aimable créature de votre espèce put jamais l’intéresser, ou l’intéresse encore, si [58] par son suffrage elle veut mettre pour vous un poids dans la balance, dire seulement un mot en faveur du projet qui se prépare, oh ! Que désormais votre sort sera digne d’envie ! Sans doute il doit s’améliorer avec celui des humains ! Profitez du retour à la raison, à la justice ; partagez le repos et le bonheur de l’univers : et qu’une philosophie plus digne de ce nom, après avoir persécuté jusqu’aux anges du Ciel, descendant enfin de sa marque effrayante, et sûre alors de nous intéresser, s’efforce, par une douce expiation, de rendre heureux jusqu’aux derniers habitants de la Terre.
Et vous qui les premiers avez mis en avant le projet de cette réforme salutaire, vous chargés en commun du précieux dépôt de toutes les idées et découvertes intéressantes à l’humanité, lumières du corps politique, magistrature du savoir toujours subsistant à côté du pouvoir, image auprès du gouvernement de cette sagesse assise aux conseils de l’éternel, achevez l’heureux ouvrage que vous paraissez méditer : il est digne de vous ; puisqu’il n’est pas indigne de cet être si grand de prendre du dernier des insectes le plus tendre soin :
Aux petits des Oiseaux il donne leur pâture
Et sa bonté s’étend à toute la Nature.
Oui, c’est à vous, l’Assemblée de savants en tous genres la plus complète qui fut jamais, de tenir ici bas la place et de remplir les fonctions de cette Intelligence Suprême qui abandonne à l’homme les détails administratifs de ce monde dont elle s’est réservée la surveillance universelle, c’est à vous d’approfondir et d’étendre de plus en plus les connaissances utiles pour arriver à des résultats plus sûrs ; à vous de découvrir de plus en plus aux humains les intentions, les bienfaits, les ressources, les pratiques de la Nature, pour qu’ils sachent mieux en seconder les vues et les opérations ; et de leur indiquer enfin de jour en jour de nouveaux moyens de conservation et de perfectionnement.
Et qui méritait plus, après les sociétés humaines d’être l’objet des recherches et des méditations de ces hommes de génie, que vous, êtres intéressants, à qui plusieurs d’entre eux ont déjà consacré leurs loisirs ? Oui, voilà le moment de vous relever de cet état d’abjection où vous a si longtemps retenus un despotisme avilissant et cruel. Osez reporter sur l’homme des yeux assurés : reprenez auprès de lui ce rang, cette confiance en lui et dans vous-mêmes que vous aviez aux premiers jours de la création. Que de sujets vous avez aujourd’hui de concevoir un juste orgueil ! Du haut de sa gloire un héros dispensateur des empires daigne lui-même jusqu’à vous abaisser des regards bienfaiteurs, comme Auguste, il a pacifié l’Univers ; comme lui, il a honoré le Pasteur de Mantoue, relevé la gloire de cette [59] ville célèbre par des souvenirs si touchants ; il a plus utilement travaillé à la gloire de ses cultivateurs ; mais surtout, mieux que lui, il daigne s’occuper des troupeaux eux même, et de son bâton consulaire appuyer la houlette du berger bien plus éclairé d’ailleurs que celui d’autrefois, un nouveau Mécène, à qui rien n’échappe de tout ce qui peut contribuer à la splendeur et la prospérité de cet empire, un digne ministre exécute ses plans avec la supériorité du génie France, l’élite des Nations, tu auras aussi l’élite des troupeaux : ce ne sera, certes, pas le moindre de tes avantages.
Ainsi donc tout le beau sexe, tous les hommes sensibles, les premiers savants de l’Europe, les principaux agents du gouvernement, le chef de l’État, son auguste compagne, voilà, mes chers clients, les patrons sur qui vous pouvez compter ! Et dût ce travail entrepris pour vous être sans succès, votre cause triomphe ! Dans cette unique certitude j’ai d’avance le prix de mes efforts.
Notes:
[1] ou tout au plus des extraits de substance animal, obtenus sans violence, tels que lait, œufs, etc.
[2] à qui sans doute encore la gourmandise ne manque pas de murmurer au fond du gosier, quand il avale un bon morceau : « Vous leur faites, seigneur, en les croquant, beaucoup d’honneur ! »
[3] Voilà tout ce qu’il m’en faut, je ne m’engagerai pas, pour étendre la matière d’ailleurs assez féconde, dans la question de l’Ame des Bêtes. Ont-elles son principe de vie plus noble que la matière, ou la matière peut-elle sentir ? Tout cela me paraît étranger au sujet : ce qu’il y a d’évident, c’est qu’elles sont sensibles. Cela doit suffire pour dicter à l’homme ses devoirs envers elles. Je m’en tiens au mot de Juvénal : il dit tout : « Dedit mundi conditor illis quantum animas, nobis animum quod »
[4] un peu froid cependant encore : on voit qu’il travaille sur une nature d’animaux peu propres à l’attendrir. Car pourquoi par exemple en partant de la dureté de ceux qui maltraitent ou détruisent sans nécessité, pourquoi ce correctif : espèce d’insensibilité ? C’est bien vraiment une insensibilité réelle, très marquée, révoltante, odieuse et non pas seulement une espèce.
[5] et ecce dedi vobis omnem
[6] quodeunque movetur et vivit, erit vobis in cibum (genes, cap. 9)
[7] nauseat anima nostra super cibo isto levissimo, disaient ils en murmurant.
[8] lettres édifiantes des missionnaires dans les Indes.
[9] Je ne veux pas ici parler d’une infinité de pratiques de cette espèce employées dans le gouvernement des animaux par l’ignorance souvent très cruelle sans s’en douter ; abus qui fourniraient à des in folio, et contre lesquels s’élèvent avec force en ce moment-même des voix plus savantes que la mienne, et surtout puissantes. D’ailleurs, ces cruautés sont involontaires, et par conséquent n’intéressent pas, ou moins directement, la morale ; ainsi cela n’est pas de mon sujet.
[10] Je gagerais bien qu’il en est à peu près de même de ces Chauffeurs (par exemple) qui font encore aujourd’hui frémir nos Tribunaux criminels ; et je ne doute pas, si l’on en comptait les registres, que l’on ne reconnut que la plupart de ces monstres de nouvelle espèce sont des hommes accoutumés dès longtemps à hacher et rôtir des chairs palpitantes.
[11] On en cite encore beaucoup d’autres pareils, notamment contre un Athénien qui avait écorché vivante une brebis.
[12] Je parle ici surtout des cantons les plus pauvres et les plus agrestes, dont les vices et les passions approchent le moins.
[13] ces indignes manières d’abuser en tous genres de nos esclaves, me rappellent une autre espèce de caprice non moins bizarre : fut-il jamais de Tyrannie plus absurde que cette proscription générale des coqs chez les sybarites, de peur qu’ils ne troublassent par leurs chants le sommeil de ses voluptueux ? Il faut être homme pour imaginer de pareilles folies !
[14] Voyez dans Buffon l’article de l’agami, celui du Rossignol par Mr. de Montbéliard &&. J’ai eu dans mon cabinet d’étude deux Chardonnerets libres : égarés par une tapisserie de verdure très fraîche, qui leur rendait quelque image de la campagne, ils firent 3 couvées dans les pieds même de la tapisserie. Quand je revenais de la promenade, je leur apportais quelques brins de foin ou de gaz fin. Dès que je les semais sur le carreau, ils les ramassent, promenaient, brandissent dans l’air repassant tournant mille et mille fois sur ma tête et rasent mes cheveux avec des tressaillements : impossibles à peindre, ils étaient si convaincus de ma bienveillance qu’ils venaient jusque sur mon pied tirer la bourre des mules fourrées que je conservais encore de l’hiver.
[15] Celui, conté par Pline le jeune, de ce dauphin qui se laisse mourir sur le rivage n’y voyant plus reparaître l’enfant qui venait y jouer avec lui ; celui raconté par Xlien, de cet énorme serpent qui délivre, des voleurs dans une forêt, celui qui l’avait nourri tout petit encore etc.
[16] Dans ma jeunesse élevé fauvettes prises dans le nid lorsqu’elles mangèrent soutes et commencèrent à faire usage de leurs ailes, en quelque lieu qu’elles se reposassent, le jouet la nuit, sur ma tête, sur mon épaule, sur quelque meuble, ou dans leur cage, c’était toujours toutes trois ensemble serrées l’une contre l’autre, mais de manière que la plus faible se trouvât au milieu. C’était plaisir de voir comment par de tendres querelles, de petits coups de bec caressants les deux Ainées la pressaient, jusqu’à ce qu’elle eut pris entre elles sa place ! Voyez aussi les articles Bouvreuil alouettes de Mr. De Montbéliard et autres.
[17] Eloigné depuis longtemps de la capitale, vivant à la campagne dans une solitude profonde, je n’avais point l’avantage de connaître Mr. Hogard, ni ses chefs-d’œuvre et j’y perds beaucoup, non seulement des jouissances pour mes yeux et mon cœur, mais des lumières et des secours pour cet ouvrage : la copie en était déjà faite lorsque j’ai lu dans le poème de La pitié le nom et l’éloge de cet artiste. Grâces soient rendues, au nom de l’humanité, à ceux qui emploient les plus vives couleurs de la peinture et de la poésie pour frapper davantage les hommes difficiles à émouvoir, offrir à leurs yeux sous des traits plus choquants leurs propres excès, et les forcer d’en rougir !
[18] vade ad formicam, o piger ! (Solon). C’est ce sage par excellence, qui a dit : novit justius jumentorum suorum aimas : visera autem inperium crudelia. Le juste (ou l’homme sensible : car la pitié est justice) connaît l’âme (ou prend un intérêt intime et de cœur au bien être) des animaux, mais les entrailles de l’empie (l’homme sans pitié) sont cruelles.
[19] Le terrible Oracle de la bouche de fer, le fameux Fouchet se mettait fort sérieusement en colère, si l’on faisait mine devant lui de vouloir écraser une Araignée.
[20] à la vue d’une scène et d’un forcené de cette espèce, qui pourrait donc m’empêcher de me dire en moi-même : voilà un être immoral, dangereux… avec qui certes, il faut se garder d’avoir affaire, cornu ferit ! Jugement sévère et prompt direz-vous ! Mais est-il téméraire ? Ou lequel, à votre avis, est le plus juste, lequel fait plus d’honneur à la nature humaine, celui qui ne voit, ainsi que moi dans ces procédés que le fait d’un méchant et le déteste ; ou celui qui les voit avec indifférence et dit : il fait comme tout le monde. Comme tout le monde ? Ah ! S’il était ainsi, c’est alors qu’il nous faudrait donc équitablement, tous hommes sensibles, fuir bien loin de ce monde et courir suivant le conseil d’un écrivain fameux, nous enfoncer avec ces prudents animaux dans le plus profond des forêts : nous y serions en meilleure compagnie !... mais non : rassurons-nous : ce sujet même, cette discussion publiquement ouverte suffit seule pour donner une toute autre idée de l’esprit du siècle où nous vivons. Il est cependant encore des restes du 18° : et rien, certes, à négliger, rien qui doive paraître minutieux [sic] de tout ce qui peut en ressusciter l’influence ! Rien qui ne soit très important, de tout ce qui peut prévenir le retour des atrocités qui le souillèrent ; rien de plus pressé, de plus sage, que de réunir à cet effet toutes les lumières, toutes les précautions, toutes les forces morales et politiques.
[21] J’ai rencontré un jour dans une rue de la capitale un de ces mendiants, dont les chiens semblent être non seulement la compagnie habituelle, mais quelquefois même les guides, les surveillants et comme les protecteurs. Celui-ci, soit qu’il ne voulut plus du sien, soit qu’il crût avoir à lui reprocher quelque tort notable, avait en ce moment contre lui je ne sais quel caprice qu’il n’était pas facile d’expliquer ; et chaque fois qu’il [26] le pouvait atteindre, lui enfonçait avec une espèce de rage tranquille son talon dans les flancs. Le tendre et malheureux animal, qui se présumait encore utile, ne pouvait cependant se détacher et retournait toujours au devant de ce pied assassin qui le relançait bien loin. Que vous a-t-il donc fait ? Demandaient les passants révoltés ! Cela ne vous regarde pas, répondait-il : je suis le maître de mon chien, déjà les flancs brisés, la langue pendante il vomissait le sang et se retrairait encore vers le Bourreau, qu’il s’obstinait à regarder comme son maître ; et le jeu recommençait, le Monstre redoublait […] pour ne pas voir la fin, je m’éloignai promptement et l’excellente raison ce n’est qu’une bête ne put de longtemps calmer en moi les sens émus.
Des agents de la police auraient sur le fait saisi, et conduit en prison ce misérable, eussent-ils été répréhensibles ? De très honnêtes gens étaient souvent, à moins, exposés à des pareils affronts.
[22] Il n’y a pas jusqu’aux insectes les plus vils, les plus odieux même, qui ne donnent des preuves de ces sentiments, dont les hommes n’ont que les apparences. Tout le monde connaît l’anecdote de l’Araignée du fameux Pellisson. Cet insecte, partout haï, partout poursuivi, le seul être vivant qu’il pût rencontrer dans son cachot, était son compagnon, son convive, son consolateur, son ami sincère… c’est un homme et sans doute un homme du beau monde, du monde poli, Mr. Le Gouverneur, qui lui arracha cette unique consolation et d’un coup de pied anéantît tout ce qui lui resta au monde.
[23] autant en arrive aux Abeilles, dont en bien des endroits le paysan, toujours esclave des anciennes routines, détruit à chaque fois un bon nombre, pour leur enlever tranquillement leur miel.
[24] Et cela non pas tant en raison du rang ou des titres qu’en raison du nombre des consommateurs, que suppose, nécessite, attire la dignité : car l’homme en place n’est pas un être simple, mais un composé de plus ou moins d’individus, qui s’étend avec la place qu’il occupe. Il existait à Rome de pareilles lois, sauvegardes de la fortune des particuliers comme de celle de l’état ; et dont le censeur surveillait très sévèrement l’exécution ; il en existait sur les anciens Perses etc.
[25] Encore se trouvera-t-il des gens (ô génie inventif autant qu’économe de la philosophie !) qui vous diront : tuez toujours, tuez : on n’en nourrira que plus de pauvres des os qui resteront.
Il est des contrées en Amérique, où, dans un jour et d’une seule chasse, on abat plusieurs milliers de bœufs, mais de ceux-là ni la chair, ni les os ne servent ; et quoiqu’il y eut de quoi nourrir peut-être plus d’un jour tous les habitants du Nouveau Monde, on laisse le tout pourrir et leur porter les germes de la peste. Qu’importe ? Les entrepreneurs y trouvent leur avantage : on enlève les Cuirs : et quelques marchands qui ne font d’autre commerce et n’ont débarqué que pour cela, remontent, bien fournis, sur leurs vaisseaux, emportant l’espérance d’un gain considérable acquis à peu de frais : il n’a couté que la vie de quelques milliers d’hommes et bœufs sauvages !
[26] et de la destruction la moins présumable des choses les moins faites pour être détruites ! Le paon est, par la beauté, le roi des oiseaux ; le rossignol l’est par le chant ; qualités qui devraient les garantir du sort commun. Dans plusieurs Pays il fut défendu, sous de graves peines, de les tuer, et cela pour leur seul mérite. Mais certains esprits croient voir toujours quelque chose de grand à se mettre au-dessus des règles et braver les obstacles ! Tel devrait être l’attrait de pareils morceaux, à qui d’ailleurs l’art seul du cuisinier pouvait donner du goût : nitimur in vetilam.
[27] Même aussi des langues de cygne, de phénicoptère, flemmant, autre superbe oiseau, des cervelles de faisan, etc.
[28] Je n’ai point, Dieu merci, moi-même été témoin de ces opérations et n’ai point fait mon cœur de gastronomie : mais j’en ai trouvé les précieuses recettes dans ces livres (car sur quoi n’y en a-t-il pas ?) où se traite la science des cuisines ; et sans doute ceux qui conseillaient ces méthodes les pratiquaient.
[29] Joignez à cela ce que rapporte Buffon, à l’article de l’oie : il était réservé à notre gourmandise plus que barbare de clouer les yeux de ces malheureuses bêtes, en les gorgeant en même temps de boulettes et les empêchant de boire pour les étouffer dans leur graisse !
Il ajoute quelque chose, mais seulement en note, de plus horrible encore, que je n’ai pas le courage de transcrire.
[30] C’est fort enchérir sur les épicuriens dont Horace indique la méthode :
Ne gallina malum, responset dura doctus eris vivam musto mersare hoc teneram faciet !
[31] Mollissima corda gumano generi dare se Natura fatetur, cum lacrymas dedit, haec nostri pars optima sensus ; mutuus ut nos affectus petere auxilium et praestare pubere (juven. Sat. 14)
[32] Un jour, dans la capitale, je fus forcé de soutenir le spectacle, qui n’est pas rare d’ailleurs, d’un garçon boucher maltraitant une pauvre brebis, qui le suivait avec peine à la mort, de manière à lui faire à chaque pas endurer mille morts : il lui donnait coups de pieds, coups de bâton, la soulevait de toute sa hauteur et la frappait contre terre, etc… Vous êtes bien dur ! Osa lui dire quelqu’un qui souffrait comme moi : que ne la tuez-vous d’un seul coup ? Je te tuerai bien aussi, réplique le bourreau : le sensible citoyen fit très bien de ne pas en attendre une nouvelle preuve. Que manquait il à cet assommeur pour être homicide ? Une révolution qui l’affranchit des craintes de la grève.
[33] Qu’un Poète appelle en son langage un extrait du fiel du Lion.
Fertur Prometheus… et insani leonis… vim stomacho apposuisse nostro. (Hor.)
[34] Qu’on me permette ce mot, le seul qui rend exactement mon idée. Je sais qu’il ne se trouve point dans le Dict. de l’academ. Mais soucieux s’y trouve en y ajoutant la négative in, est-il moins coulant, plus dur à l’oreille, moins expressif ? Il répond à l’incuriosus des latins, qui n’a point d’équivalent dans notre langue.
[35] L’excessive liberté de l’éducation à la J.J. n’est pas moins pernicieuse pour la tète de l’enfant que le Contrat Social dans la tète des demi-philosophes ; et je ne doute pas que l’Emile n’ait contribué à la Révolution autant au moins que l’autre roman politique.
[36] On en a cité plusieurs p. 22, on peut voir dans Buffon celui d’un de ces oiseaux que l’on croit les plus stupides, d’une oie appelée Jacquot (Histoire de l’Oie en note) celui même d’un des oiseaux les plus farouches d’une buse (article Perroquet en note, tom. II).
[37] Quant à la force de son attachement, il y en a tant de preuves, il y a tant d’exemples de chiens inconsolables de la perte de leurs maîtres et mourant sur leurs tombeaux, que je n’ai pas le soin de les rappeler : ils sont journaliers. Mais on me permettra quelques mots sur un fait, dont j’ai moi-même été témoin, avec tout un peuple, sur un des quais de la capitale.
Un étranger logé en chambre garnie en avait emporté la clef, laissant la fenêtre ouverte. Son chien, superbe animal, après l’avoir longtemps appelé du haut de la fenêtre avec des cris douloureux qui arrêtaient les passants, s’en jeta enfin, d’un 5° au 6° étage, au milieu des spectateurs, attroupés, impuissants à le satisfaire : il resta mort sur la place.
[38] Cela est très différent de la plupart des pratiques en usage parmi nous, mais très conforme aux principes insinués autrefois à ce peuple administré par Dieu même. Le législateur voulait que les animaux fussent nourris, non pas avec cette mesquinerie barbare qui ne leur donne qu’autant qu’il faut pour qu’ils n’expirent pas sous le faix, mais largement en raison de leur travail : non alligabis os Bovi trituranti (Deuteron, c. 25). Et de peur qu’on ne les excédât aussi de fatigue, un des motifs expressément allégués pour la fixation d’un jour de repos dans la semaine est la nécessité de les reposer eux-mêmes, ainsi que les autres serviteurs de la maison. Sex diebus operaberis : septimo cessabis, ut requiescat Bos et Asinus tuus, et filius ancillae tuae.
N’ai-je pas droit de conclure de toutes ces précautions prises pour leur repos et leur bien-être, que l’intention du Créateur lui-même est qu’ils soient ménagés ? (Exod. cap. 23)
[39] Il faut avouer que le temps employé de cette manière l’est beaucoup plus que celui de cette populace corrompue et corruptrice de grandes villes ; celui qu’elle passe dans les lieux de débauche, ou à voir des forces de baladins, ou même à fabriquer tous ces objets de luxe que l’on croit des aliments si nécessaires au Commerce, qu’on les remplace par le commerce des Bestiaux ; et, l’on verra si la prospérité des états dépend du luxe. Pour moi, je suis forcé par mon intime conviction d’avouer que je crois une journée de ces bons Pasteurs beaucoup plus sagement employée et plus utilement aux mœurs et à la société que toutes celles consacrées (je n’oserais dire à composer les Géorgiques), mais à la composition de ce discours, entrepris cependant à si bonne intention.
[40] Si ambulans perviam, inarbore vel in terra nidum avis inveneris et matrem pullis vel ovis incubantem, non tenebis eam cum filis, ut bene sit tibi et longo vivas tempore (Deuterom. Cap. 22, vers 1).
Lorsque le divin Législateur des hébreux non seulement daigne entrer dans de pareils détails, mais juge même à propos d’en faire des devoirs pour son peuple, et d’attacher à leur observation une promesse de bonheur et de longue vie, quel lecteur frivole aura le droit de trouver qu’ils sont de peu de conséquence et mes scrupules minutieux ?
[41] Combien d’injustices entraînent pour une longue suite de siècles quelquefois, et que de sottises nous font faire de fausses idées une fois établies ! A jamais donc sans pitié, sans remède et l’Ane et l’Oison doivent être bernés, lutinés, tourmentés par ce qu’il a plu d’attacher à leur nom je ne sais quelle idée mépris et de ridicule ?
[42] Jura inventa metu injusti fateri necesse est (Horac.)
[43] Les diverses espèces de phoques ont, dit-on, la vie très dure, de sorte qu’on ne peut avoir leur dépouille (le cuir, la graisse) sans leur faire souffrir des tourments inouïs. N’importe : l’intérêt y trouve son compte ; dès lors tout est légitime. Qu’on l’écorche vivant, puisqu’on ne peut le tuer. L’animal pousse des cris lamentables : d’effroyables contorsions étalent une effroyable image de sa douleur !... Mais les écorcheurs vont leur train, le seul exposé de ces détails déchire le lecteur : ils trouvent cependant des exécuteurs : et ce sont des hommes !... Quels autres en seraient capables ! La rage révolutionnaire a fait, dit-on, de pareilles exécutions en Amérique sur des hommes ! Les exécuteurs n’étaient-ils pas ceux qui s’exercent sur des phoques ?
[44] Lorsqu’un Poète dit : informe Limaçon toi-même que ma haine écrase avec raison, je saurais aux derniers mots de cet arrêt : s’il avait dit : mutile, déchire, torture avec raison, le terme serait impropre, le sens faux, injuste, contradictoire ; car il ne peut y avoir de raison pour faire un mal inutile, mais de la haine ! Pour le coup ce langage est peu philosophique, c’est celui d’un Poète.
[45] On voit souvent aux portes des chasseurs d’autres plus grands animaux cloués aussi vivants : triste enseigne, au but de laquelle je lis, sans qu’on l’écrive : à la cruauté ! Une chauve-souris est laide : est-ce un crime à vos yeux assez grand pour la crucifier ? Un hibou est hideux, malfaisant : soit ; purgez-en la Nature. Mais ce surcroît de barbarie lui donnera-t-il des remords de la sienne ? Et l’homme cruel, n’est-ce pas une difformité plus grande encore ?
[46] Ils assimilaient le meurtre du plus vil animal à celui d’un homme.
[47] C’est ici le lieu de négliger les infiniment petits : minima pro nihilo reputanda ; pas cependant tout-à-fait au moral, où, comme nous l’avons remarqué, les plus petites choses ne sont pas quelquefois de petite conséquence.
[48] Comme on serait condamné pour des animaux tués ou blessés au préjudice d’autrui, à un dédommagement proportionné envers le maître, plus grand pour un cheval, un taureau, que pour un agneau, et pour celui-ci plus grand que pour un poulet, ne pourrait-il pas y avoir pareillement un tarif pour les injures et mauvais traitements faits aux animaux, je ne dis pas seulement en raison de leur valeur intrinsèque ou relative, ni seulement en raison du mal physique qui aurait été commis ; mais surtout en raison du mal moral, du degré de malice, d’injustice ajouté à l’action ; de manière qu’il y eut aussi, en de pareils cas, une espèce de question intentionnelle : a-t-il été plus ou moins cruel, injuste etc. ? Ce qui ne me parait, certes, pas si fort indifférent, ni par rapport au prévenu, ni par rapport à la société. Et le maître lui-même de l’animal offensé pourrait être soumis à des pareilles corrections pour sa conduite envers son domestique maltraité.
La peine pourrait être une sentence judiciaire, un court emprisonnement, surtout une amende au profit des pauvres, ou des troupeaux de la commune ; une ou plusieurs journées de travail pour le service public, etc.
[49] Dentem pro dente, oculum pro oculo, animam pro anima (Exod. Cap. 21). Ce même chapitre finit par une loi contre l’homicide, dans laquelle il y a quelque chose de remarquable. Un bœuf même frappant de la corne et qui tue un homme, est condamné à la mort ! (verset 28) Passage, qui présente, à mon avis, une observation très importante ; à savoir que de la part de juge universel et souverain il y a une justice, même pour les brutes : s’il y a une justice de rigueur et de punition, il doit y avoir une justice de récompense et de protection.
[50] On ne manquera pas de trouver cette réflexion de ma part ou cet amendement fort déplacés, et ma complaisance outrée, de vouloir, comme on dit, que tout le monde vive. Cependant ce Législateur, qui sans doute en valait d’autres, aidé de lumières plus qu’humaines, dit-on, mais pour le moins aussi vastes, aussi sûres que celles des philanthropes du dernier siècle, le Législateur des Hébreux va bien plus loin. Il prend des mesures pour assurer contre l’avidité des propriétaires un fond de subsistance non seulement aux pauvres, mais encore aux animaux, même sauvages ; il assigne même pour ces derniers une espèce d’aumône à perpétuité et de peur qu’épuisée par les plus riches et les plus forts, la Terre ne manque à cette autre portion de ses habitants, qui pour leur indigence et leur impuissance sont toujours sacrifiés, il fait sur ses produits une réserve expresse et périodique en leur faveur : il ordonne qu’elle soit tous les 7 ans abandonnée par ses possesseurs au profit des pauvres du pays, et des bêtes de champs.
Anno 1° dimittes eam et requiescere facies, ut comedant peuperes popoli… et bestiae agri (exod. cap. 23, vers. 12)
[51] Il est que pour cette raison-là même on traite de stupides, à qui même on en donne le nom. La faiblesse n’excite, au lieu de la pitié, qu’une raillerie cruelle ; et chez elles comme parmi nous, est la douceur, la débonnaireté qui passent pour bêtise.
[52] En quoi surtout l’est à remarquer que le Législateur, qui toujours a soin par rapport à ce peuple grossier d’entrer dans les plus grands détails, non seulement fait pour eux une distinction exacte des animaux purs et impurs, c’est-à-dire malsains et insalubres ; mais lorsqu’il en vient au dénombrement des animaux permis pour nourriture, ne manque jamais d’ajouter : mais vous vous abstiendrez du sang et répète cette formule à chaque article ; ce qui sans doute suppose de sa part des raisons très essentielles, des vues profondes, et non seulement le dessein d’en inculquer l’horreur, mais encore d’en prévenir les dangers tant pour le physique que pour le moral de l’homme.
[53] Je continue d’appeler abus ce qui l’est en effet et ne peut cesser de l’être ; car il s’en faut beaucoup que ceux que j’ai décrits soient autorisés par le passage de la Genèse que je viens de citer ; concession postérieure à la loi naturelle, qui par conséquent la suppose et ne l’abroge pas. Mais toujours chez l’homme la permission dégénère en licence.
[54] Ces énormes amas n’étaient pas en pure perte : le superflu de la table du maître se partageait ensuite entre un nombre infini d’esclaves, ou d’affranchis ; et un nombre plus considérable encore de chiens, autre espèce de Domestiques encore à ses gages. Chacun de ces grands de Rome avait de plus grosses maisons, que les princes d’aujourd’hui ; il nourrissait des peuples entiers : et Crassus nourrit en effet durant plusieurs mois celui de Rome dans un temps de famine. On peut pardonner des richesses ainsi employées.
[55] Ne serait-il pas possible d’établir même dans chaque commune de la République un ordre fixe à cet égard ? De régler, par exemple, relativement au nombre des habitants et aux besoins ordinaires de la commune, sur un rapport du Conseil municipal, approuvé par le Conseil général de département arrêté par le gouvernement, de régler, dis-je, le nombre de bêtes à cornes ou à laine qu’il serait permis de sacrifier, de statuer que le boucher ne pût d’une pièce de Bétail, sans un bon, imprimé, signé du maire, pour un bœuf, pourtant de moutons etc., de manière que par semaines ou par mois, on ne pût excéder un certain nombre marqué ; et que s’il se trouvait des vendeurs ou acheteurs contravention, l’excèdent fût confisqué par le Magistrat qui le ferait porter aux hôpitaux, avec amende plus ou moins forte à la charge du délinquant, au profit des pauvres. On pourrait étendre même cette Police à de moindre objets, à la quantité d’œufs, de volaille, de poisson portée au marché etc.